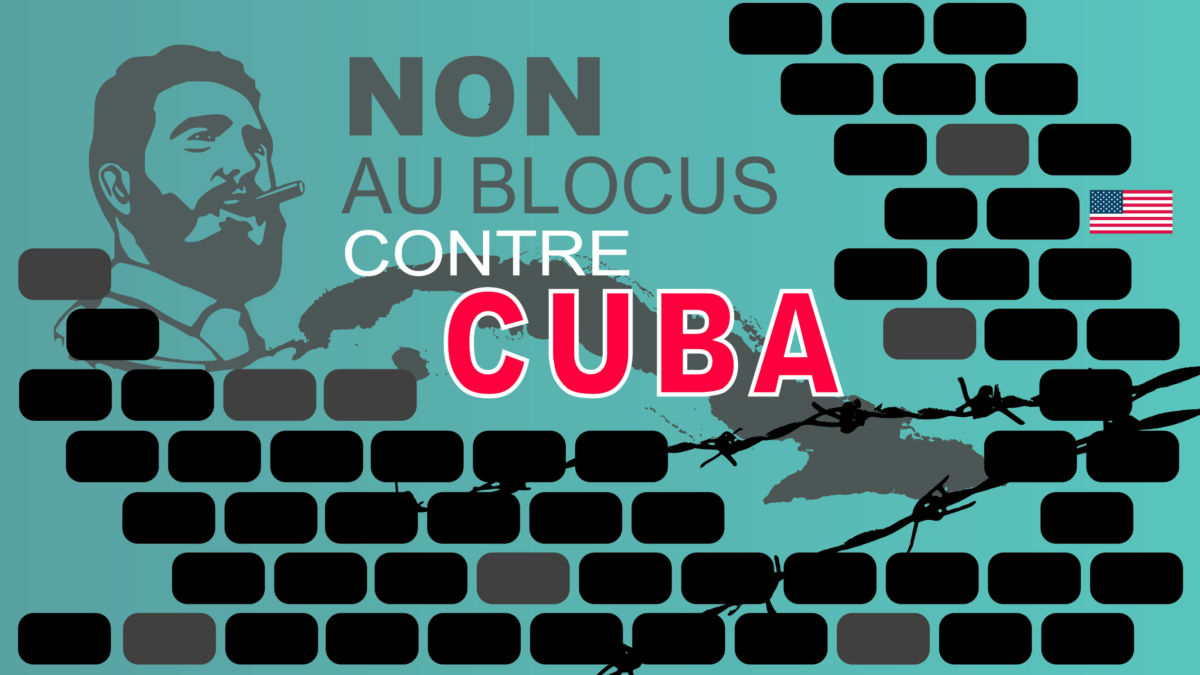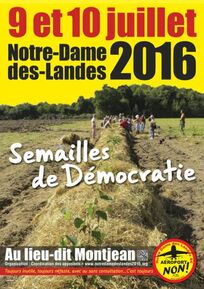-
Après la Bolivie, un coup d’État au Pérou ? par Denis Rogatyuk (lvsl 18/07/21)
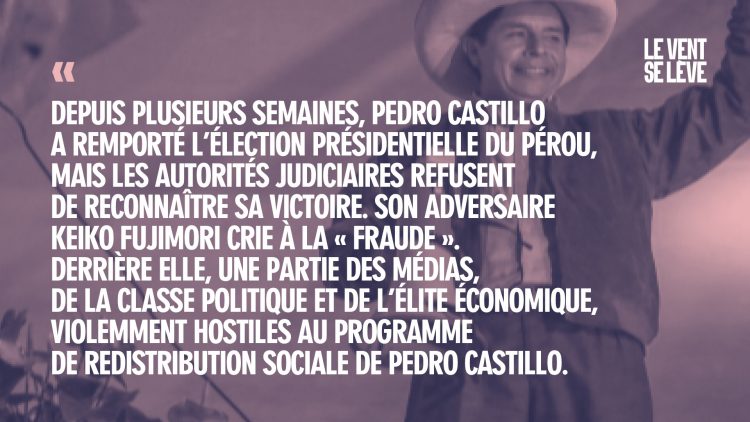
L’élection présidentielle du Pérou fera date. On imaginerait difficilement pays plus polarisé : d’un côté Keiko Fujimori, fille du dictateur Alberto Fujimori, à la tête d’une coalition libérale et pro-américaine. De l’autre Pedro Castillo, instituteur modeste issu d’une région rurale, défenseur d’un programme de redistribution des richesses, d’étatisation des ressources et de convocation d’une assemblée constituante. Élu président depuis début juin, il fait face à un blocage institutionnel : les autorités judiciaires du pays refusent de reconnaître sa victoire. Le camp de Fujimori crie à la fraude, soutenu par une partie des médias, de la classe politique et une poignée d’officiers. Un an et demi après le coup d’État bolivien, Pedro Castillo subira-t-il le même sort qu’Evo Morales ?
Les élections péruviennes du mois dernier ont fait l’objet d’une lutte féroce. Les résultats définitifs ont vu Pedro Castillo, enseignant catholique de la région de Cajamarca (dans l’extrême nord du Pérou), devancer son adversaire Keiko Fujimori. La candidate perdante a crié à la fraude et a lancé une bataille juridique pour annuler le résultat.
Les élites péruviennes ne sont pas habituées à subir de tels revers. Il s’agit, après tout, d’un pays qui a traditionnellement fait partie de « l’arrière-cour » des États-Unis. Aucun gouvernement « progressiste », de gauche ou « nationaliste » n’est parvenu au pouvoir depuis le régime militaire du général Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Le résultat du 6 juin a annoncé une rupture radicale par rapport aux quatre dernières décennies, résolument conservatrices.
Tout au long de la campagne, d’immenses panneaux d’affichage ont projeté des images où l’on pouvait lire : « Oui à la démocratie ! Non au communisme ! » ou « Nous ne voulons pas être un autre Venezuela ! »
Les présidents de l’Argentine, de la Bolivie, du Nicaragua et du Venezuela ont tous félicité M. Castillo en tant que président élu. Mais même plusieurs semaines après le vote, le camp de Fujimori semble déterminé à s’emparer du pouvoir. Un air de déjà vu pour un pays frontalier de la Bolivie ?
Ndlr : pour une mise en contexte du coup d’État qui a renversé Evo Morales en novembre 2019, lire sur LVSL l’article de Baptiste Albertone : « Des coups d’État à l’ère de la post-vérité ».
Castillo v Fujimori
Les deux candidats représentaient des alternatives radicalement différentes pour le Pérou — tant sur le plan social et culturel qu’idéologique. L’image renvoyée par Castillo, celle d’un humble enseignant rural et leader syndical, a trouvé un écho considérable dans les zones rurales. Ce « Pérou profond » a également un caractère profondément indigène (notamment à Cusco). Le vote en faveur de Castillo peut s’expliquer par une volonté de rejeter la domination de l’oligarchie basée à Lima.
Fait notable de cette campagne de premier tour : elle a fait fi de la plupart des réseaux sociaux (Castillo n’avait pas de compte Twitter ou Instagram jusqu’à la fin de ce premier scrutin) et privilégié des modalités traditionnelles de militantisme.
Durant les meetings de masse organisés par Peru libre [le parti de Castillo], Castillo a martelé la nécessité de mettre fin au cercle vicieux de la corruption, de renationaliser les industries clefs et de doter le pays en services publics (en particulier dans le domaine de l’eau). M. Castillo a également fait sienne la demande populaire d’une nouvelle Constitution et de la création d’une Assemblée constituante — comme celle qui a été récemment fondée au Chili.
Pendant sa campagne, il s’est également opposé à l’intervention américaine au Venezuela et a promis que le pays quitterait le « Groupe de Lima », entité géopolitique constituée des principaux gouvernements pro-américains de la région et poussant au renversement de Nicolás Maduro.
Keiko Fujimori a riposté à l’aide d’une féroce rhétorique anti-communiste — et de généreuses dépenses publicitaires dans les médias privés. Cette campagne a été particulièrement intense à Lima et dans sa zone métropolitaine, ainsi que dans les régions côtières du pays. Tout au long de la campagne, d’immenses panneaux d’affichage ont projeté des images où l’on pouvait lire : « Oui à la démocratie ! Non au communisme ! » ou « Nous ne voulons pas être un autre Venezuela ! ».
L’héritage du père de Keiko Fujimori a lourdement pesé sur son image. Son sinistre legs inclut l’organisation d’assassinats de syndicalistes via l’escadron de la mort Grupo Colina, la stérilisation forcée de plus de deux cent cinquante mille femmes indigènes, la privatisation d’industries d’État et le vol de centaines de millions de dollars — le dernier de ces crimes ayant valu à Alberto Fujimori une peine de vingt-cinq ans de prison.
L’arrivée d’Alberto Fujimori dans le palais présidentiel en 1990 s’est accompagnée d’une série de réformes parmi les plus emblématiques de la décennie néolibérale qui s’annonçait. On lui doit, entre autres, la privatisation du service public de l’eau — face à laquelle Keiko Fujimori a promis durant sa campagne une « prime à l’eau », visant à permettre aux plus pauvres d’y accéder
Un nouveau coup d’État ?
Sitôt que l’autorité électorale du pays, le Jury national des élections (JNE), a annoncé les résultats, Fujimori a dénoncé ce processus comme « frauduleux » et entamé une bataille juridique. Exigeant l’annulation de près de deux cent mille votes dans les régions rurales, elle a réclamé un « audit international », présenté près d’une douzaine de recours pour l’annulation de l’élection et avancé que sa défaite était due à une « conspiration » mondiale de « la gauche ».
Dans le même temps, une lettre signée par d’anciens militaires appelait à une « intervention militaire » visant à empêcher Castillo de former un gouvernement. La polarisation du pays s’est ensuite intensifiée, à mesure que les partisans de Pedro Castillo ont commencé à organiser des marches pour défendre le résultat des élections, tandis que les militants fujimoristes se mobilisaient — à grands renforts de pancartes alertant sur un prétendu danger « communiste ».
Alors que la situation semblait de plus en plus désespérée pour la candidate Fujimori, de nombreuses personnalités de droite, à l’intérieur et l’extérieur des institutions judiciaires, ont soutenu son assaut contre M. Castillo et les autorités électorales.
Plusieurs membres de l’Office national des processus électoraux (ONPE) ont été attaqués par des partisans de Fujimori. Des agressions physiques et des menaces de mort ont également été signalées à l’encontre d’autres membres des institutions judiciaires, comme le chef du parquet anticorruption, José Domingo Pérez. Des groupes pro-Fujimori ont également attaqué les groupes de paysans et de militants indigènes qui se rassemblaient devant le siège du JNE.
Cependant, près d’un mois après le jour de l’élection, les options juridiques de Fujimori se sont sérieusement réduites. Presque toutes les missions d’observation, des États-Unis à l’Organisation des États américains (OEA) et à l’Union européenne, ont reconnu que l’élection avait été libre, équitable et transparente.
Pour Keiko Fujimori, l’enjeu n’est pas seulement politique. Les accusations qui pèsent sur elle pourraient la conduire à passer jusqu’à 30 ans en prison pour pots-de-vin, corruption et financements illégaux de campagnes antérieures. À la mi-juin, les procureurs de l’État ont recommandé la détention préventive à son encontre, invoquant un risque élevé de fuite.
Alors que la situation semblait de plus en plus désespérée pour la candidate Fujimori, de nombreuses personnalités de droite, à l’intérieur et l’extérieur des institutions judiciaires, ont soutenu son assaut contre M. Castillo et les autorités électorales.
Le cas le plus emblématique est celui de la démission de l’un des juges du JNE, Luis Arce Córdova, contre ce qu’il considère comme un « manque de transparence » au sein de l’organe judiciaire. Comme le JNE a besoin d’un quorum complet de quatre juges pour prendre la décision finale sur les résultats de l’élection, sa démission a été considérée comme une tentative d’entraver le processus et d’ouvrir la possibilité d’une nouvelle élection. Si aucun président n’a été reconnu d’ici le 28 juillet, un nouveau président intérimaire choisi par le congrès devra organiser un nouveau processus électoral.
Le cas de Vladimiro Montesinos est tout aussi symptomatique. Cet ex-chef du Service national de renseignement (SIN) du Pérou, proche allié d’Alberto Fujimori, a contacté d’anciens officiers de l’armée péruvienne pour leur proposer de corrompre au moins trois membres du JNE afin qu’ils se prononcent en faveur d’une victoire de Fujimori. Cette tentative de putsch fait actuellement l’objet d’une enquête de la part de la marine péruvienne et du procureur général.
Rafael López Aliaga, un autre candidat ultraconservateur et membre de l’Opus Dei qui a terminé troisième au premier tour des élections, a également participé aux marches pro-Fujimori, reprenant les théories du complot à propos du « péril communiste ». Lors d’une apparition à la télévision, il a même déclaré que les électeurs de la classe ouvrière de Castillo devraient être « punis » par une dévaluation du Sol (la monnaie nationale du Pérou) et les dommages économiques qui en résulteraient. De même, Jorge Montoya, le député le plus en vue de son parti et ancien officier de la marine, avait dénoncé des « irrégularités » dans le processus électoral et demandé l’annulation des résultats.
Sur la scène internationale, plus d’une douzaine d’anciens chefs d’État latino-américains et espagnols, conservateurs ou libéraux, ont fait pression sur les autorités électorales péruviennes afin qu’elles n’entérinent pas la victoire de Pedro Castillo. Parmi eux, l’ex-président colombien Álvaro Uribe, l’ex-premier ministre espagnol José María Aznar, ou encore l’ex-chef d’État argentin Mauricio Macri.
Cette dynamique a été renforcée par un commencement d’offensive médiatique contre Pedro Castillo dans les principaux médias américains et espagnols. Si on ne trouve pas contre lui la plupart des poncifs qui sont habituellement réservés aux leaders de la gauche latino-américaine (en cela, les médias occidentaux se distancient pour le moment des fujimoristes), il n’est pas rare de lire que Pedro Castillo s’est « autoproclamé » vainqueur.
Mario Vargas Llosa, le plus éminent des critiques libéraux des gouvernements de gauche d’Amérique latine, autrefois adversaire de Keiko Fujimori, s’est à présent rapproché d’elle. Figure d’opposition à Alberto Fujimori, il n’a pas hésité à apporter son soutien à sa fille pendant la campagne du second tour, reprenant à son compte le slogan du « choix entre démocratie et communisme » — ajoutant que la présidence de Castillo conduirait le Pérou sur la voie du Venezuela…
Ceci étant dit, confrontées à l’évidence du résultat électoral, plusieurs figures issues de la droite et du centre ont pris leurs distances avec la version des faits défendue par Keiko Fujimori ; certaines se sont même réunies avec Pedro Castillo pour discuter de la possibilité de former des coalitions au Congrès. George Forsyth, du parti de droite Victoire nationale (NV), a condamné la crise au sein de JNE en la qualifiant de tentative de « coup d’État », tandis que le parti de l’actuel président intérimaire Francisco Sagasti a reconnu Pedro Castillo comme président légitime du Pérou.
Cette absence d’accord commun entre les forces politiques de droite et libérales du pays a donné à Pedro Castillo le temps et l’espace nécessaires pour continuer à organiser des rassemblements de masse, tout en multipliant les rencontres avec les autorités locales et régionales.
Dans le même temps, Keiko Fujimori a échoué à donner une quelconque cohérence à une coalition qui s’étendrait des libéraux les plus centristes aux secteurs les plus fascisants de l’armée et de la police. Il lui a manqué la planification stratégique que l’opposition bolivienne a déployé.
Sur la scène internationale, sa victoire a été reconnue par de nombreux chefs d’État de gauche, anciens ou actuels, dont les noms ne surprennent pas : Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Alberto Fernández, Luis Arce, Fernando Lugo, Lula da Silva, etc.
Les leçons de la Bolivie
La similitude entre la situation actuelle et celle qui a précédé le coup d’État de novembre 2019 en Bolivie est frappante. Refusant les résultats du scrutin qui avait donné Evo Morales en tête, la coalition libérale de Carlos Mesa, soutenue par les activistes d’extrême droite de la région de Santa-Cruz et une fraction de la police et de l’armée, avait organisé un putsch qui avait contraint le président bolivien à donner sa démission. L’OEA y avait joué un rôle fondamental en fournissant un faux rapport faisant état d’irrégularités lors des élections, enhardissant l’extrême droite, tandis que les États-Unis ont fourni au régime issu du coup d’État une nouvelle légitimité internationale.
Ndlr : Pour une analyse du rôle de l’OEA dans le coup d’État bolivien, lire sur LVSL l’article de Denis Rogatyuk : « Bolivie : anatomie du coup d’État »
Keiko Fujimori et ses alliés ont manifestement cherché à initier un processus similaire. Cependant, le camp de Pedro Castillo a tiré des leçons de la Bolivie. La nuit de l’élection, Castillo a été le premier à proclamer « non à la fraude ! » pour s’assurer que les votes soient comptés de manière transparente. Le lendemain, il a pris la décision cruciale d’organiser des rassemblements de masse à Lima pour défendre le vote populaire, suivis de marches similaires dans tout le pays.
L’équipe juridique de Castillo a également joué un rôle clef dans la délégitimation des allégations de Fujimori. Parallèlement, avant même sa reconnaissance officielle en tant que président élu, son équipe économique a entamé des négociations avec les syndicats d’une part, l’élite et le monde des affaires de l’autre. Castillo lui-même a commencé à parcourir activement le pays, rencontrant les maires, les gouverneurs et les représentants des provinces, ainsi que les représentants des États-Unis, de l’OEA et de l’Union européenne.
Dans le même temps, Keiko Fujimori a échoué à donner une quelconque cohérence à une coalition qui s’étendrait des libéraux les plus centristes aux secteurs les plus fascisants de l’armée et de la police. Il lui a manqué la planification stratégique que l’opposition bolivienne a déployé. Sa dernière tentative a consisté à exiger un « audit international » des résultats par l’OEA… Sans que cette demande ne recueille le soutien international qu’elle escomptait.
La voie n’est pour autant pas libre pour Pedro Castillo. Même investi, il devra faire face à une Assemblée législative hostile (mais également impopulaire), où son parti ne dispose actuellement que de trente-sept sièges sur cent trente. Avec ses alliés, il dispose d’un peu moins d’un tiers des sièges.
Le parti Fuerza popular de Keiko Fujimori dispose actuellement de vingt-quatre sièges, mais la coalition dont il est le cœur en dispose d’une soixantaine — pas loin de la moitié du total. Entre les deux, un marais centriste et néolibéral.
D’autres menaces pèsent sur les plans de M. Castillo. L’armée et la police péruviennes sont dirigées par d’innombrables cadres ayant fait leurs armes à l’École des Amériques basée aux États-Unis. Les médias privés, de leur côté, ont passé les trois derniers mois à dépeindre Pedro Castillo à l’aide des traditionnels poncifs anticommunistes, alimentant un climat de guerre civile. Ainsi, l’élite économique de Lima et les États-Unis possèdent des relais institutionnels non négligeables.
Plusieurs signaux indiquent que Fujimori a échoué à reproduire au Pérou un scénario à la bolivienne. Mais si Pedro Castillo parvient à être investi président, c’est durant tout son mandat que planera sur lui l’épée de Damoclès d’un coup d’État.
source: https://lvsl.fr/
« Manifestations monstres à Cuba pour soutenir la Révolution, exiger la fin du blocus criminel (IC.fr-17/04/21)Morbihan : 200 € de plus pour 3 200 aides à domicile (LT.fr-16/07/21-17h29) » Tags : International, Amérique Latine, Pérou, Coup d'Etat ?
Tags : International, Amérique Latine, Pérou, Coup d'Etat ?
-
Commentaires
le blog franchement communiste du finistère-morbihan