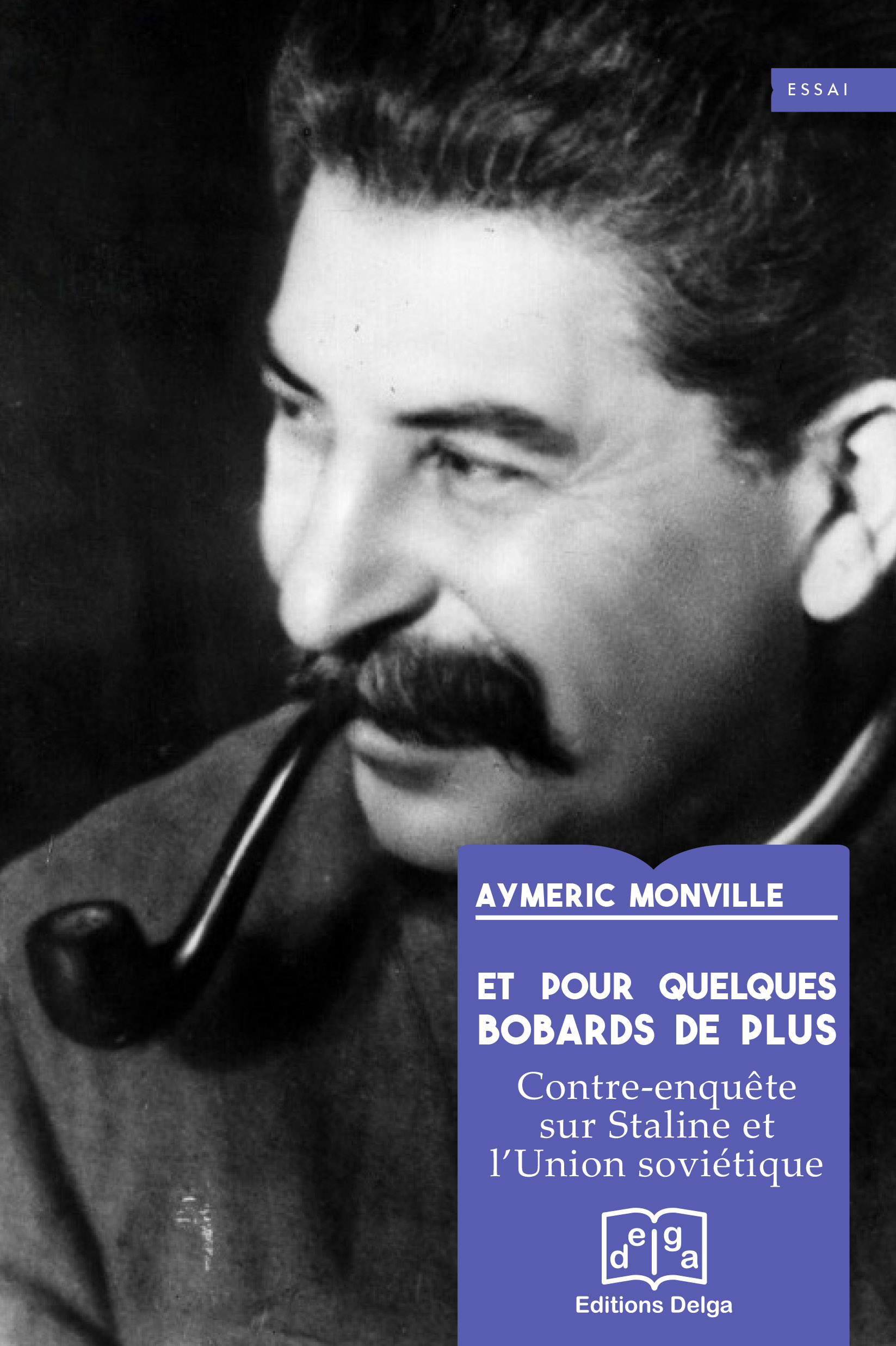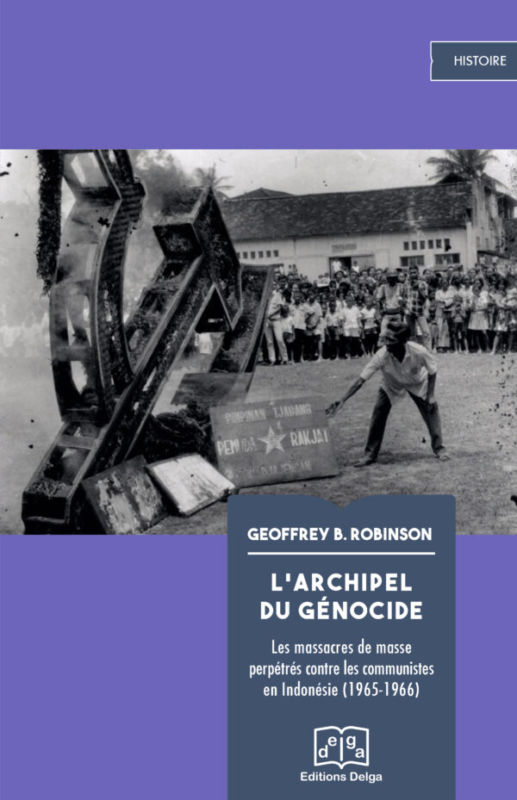par Maurice LEMOINE
2019 et 2020 ont été, en Bolivie, deux années explosives. Dans un premier temps, du fait des accusations de fraude portées par la droite et l‘Organisation des Etats américains (OEA) lors de l’élection présidentielle, et de la démission forcée d’Evo Morales – en d’autres termes un coup d’Etat. Ensuite, dans le suivi (beaucoup moins médiatiquement tonitruant) des exactions du gouvernement de la présidente autoproclamée Janine Añez. Enfin, avec un dénouement qui en a surpris plus d’un : un an après avoir perdu le pouvoir, le Mouvement vers le socialisme (MAS) le récupérait en la personne de Luis Arce, ex-ministre de l’Economie de Morales, avec 55 % des voix.
Pour beaucoup d’observateurs, quelle qu’en ait été la cause, « la crise bolivienne » était désormais terminée. Funeste fourvoiement…
En octobre 2021, depuis Santa Cruz, où vit l’élite blanche de la riche province de l’est du pays, la droite néolibérale ainsi que son aile néofasciste, raciste et putschiste ont entrepris de se réarticuler au sein d’un Bloc d’unité pour la liberté et la démocratie. S’opposant aux légitimes poursuites entamées par le pouvoir contre l’usurpatrice Añez, certains de ses « ministres » ainsi que quelques policiers et militaires incarcérés, l’opposition nie l’existence du « coup d’Etat », exige la fin de la « persécution politique », réclame la libération immédiate des prisonniers (eux aussi « politiques »), à commencer par Anez, s’agite, menace ouvertement le pouvoir et a annoncé, pour le 11 octobre, une paralysation totale du pays – le « paro cívico ». Pour nombre des ténors de cette opposition, et au-delà des arguties, il s’agit d’empêcher la poursuite des auditions et des enquêtes susceptibles de mettre en évidence leur rôle dans le « golpe » de 2019. En réponse à ce qui apparaît comme une nouvelle tentative de déstabilisation, les travailleurs et secteurs populaires ont organisé de leur côté une mobilisation massive, le 12 octobre, en défense de la démocratie et du gouvernement Arce. Tout se trouve donc en place pour une nouvelle confrontation.
Si la situation devait dégénérer, la Bolivie risque de revenir sur le devant de la scène. Avec, comme on a pu le constater lors des séquences précédentes, un important lot d’approximations et d’erreurs médiatiques. Car tout ce qui échappe à la norme intrigue, inquiète ou déconcerte. Donne même souvent lieu à désinformation. Et s’il est un pays qui sort de l’ordinaire, c’est bien la Bolivie. Nul ne peut comprendre un phénomène l’affectant à un moment donné, s’il laisse de côté la genèse ou l’évolution de celui-ci. S’il n’entre pas, par exemple, dans les arcanes du MAS-IPSP (instrument politique pour la souveraineté des peuples), mouvement fondé en 1997, dirigé par Evo Morales, et au sein duquel convergent et divergent, en fonction du moment, des logiques allant de l’ethnique au culturel en passant par le politique et le syndical.
C’est blanc, c’est noir, c’est bon, c’est mauvais ? Comprendre la Bolivie est plus complexe qu’on ne le croit. Toutefois, aux journalistes et universitaires trop souvent approximatifs (mais aussi aux citoyens politiquement engagés ou même simplement curieux), on signalera qu’il existe désormais une Bible pour appréhender au plus près la réalité du pays du condor et de la Pacha Mama : Altiplano, le dernier ouvrage du sociologue Franck Poupeau.
Grand avantage sur beaucoup d’autres : Poupeau n’a rien d’un intermittent de la Bolivie. Depuis plus de vingt ans, il sillonne les plaines arides et les périphéries urbaines des hauts plateaux – le fameux Altiplano. Pour tenter de comprendre la logique politique d’insurrections populaires devenues expérience de gouvernement, il entrelace – en 700 pages ! – quatre niveaux d’écriture : des enquêtes de terrain ; des analyses ; des textes d’intervention ; d’utiles (car généralement inexistantes) réflexions sur la position de l’enquêteur « immergé dans une réalité autre tout en restant engagé dans la vie académique ».
Histoire longue, instauration de l’Etat neoliberal, « guerre de l’eau, « guerre du gaz », émergence du MAS, vie et dynamique sociale des « barrios » (quartiers) d’El Alto, avancées populaires, réussites incontestables mais aussi errements du pouvoir, voire d’Evo Morales lui-même, rien n’échappe à l’examen mené en empathie critique par Poupeau. En substance, la « vision enchantée » des mobilisations confortées par les processus électoraux ultérieurs ne doit pas interdire un diagnostic des relations effectives entre Etat et mouvements sociaux. Tout au long de l’ouvrage, flotte comme en filigrane la question inhérente à ce type de processus de changements : un Etat peut-il se consolider en se dépossédant de ses attributions en faveur des formes d’auto-organisation qui ont originellement impulsé sa dynamique politique ? La réponse n’est en rien évidente. Mais, d’un autre côté, et répondant implicitement aux Savonarole de salon, Poupeau remet en cause les visions dichotomiques (et souvent manichéennes) d’une « trahison » de l’Etat face à la « pureté révolutionnaire » des mouvements sociaux.
On pourra sur tel ou tel point, tel ou tel moment (assez rares au demeurant), ne pas partager à 100 % les analyses de l’auteur. Mais de telles divergences s’inscrivent dans le registre du débat et de la fructueuse confrontation d’idées – jamais dans le rejet brutal d’arguments non documentés, mensongers, malhonnêtes et portés par l’ignorance ou la mauvaise foi.
De cet ouvrage d’une très grande richesse, aussi foisonnant que passionnant, nous publions un court extrait.
« Il fallait voir, sur l’avenue centrale du Prado et la place Murillo, en janvier 2006, les défilés et les rassemblements célébrant la victoire d’Evo Morales à l’élection présidentielle du mois de décembre précédent : l’émotion suscitée par ces marches, leurs explosions de couleurs – les damiers de la wiphala, les éclats des aguayos, le bleu intense des banderoles du MAS. L’enthousiasme des slogans repris en chœur, ou plutôt criés en rafale, entre les explosions de pétards qui remplacent, en ces temps de fête, les détonations de la dynamite apportée pour affronter les forces de police. Il fallait voir, alors, les sourires des cholitas, les regards intenses des cocaleros ou des mineros, animés de l’espoir que tout allait changer et que les promesses des insurrections allaient enfin s’accomplir, après tant de manifestations réprimées et de morts, relégués aux marges de la citoyenneté.
Plus solennelle, la cérémonie d’intronisation sur le site archéologique de Tiwanaku, au pied de la porte du Soleil et du temple de Kalasasaya, met en scène, un jour avant l’entrée au Parlement, un symbolisme précolonial en même temps qu’une rupture avec l’histoire de la Bolivie blanche et métisse. Les ponchos des milliers d’autorités communautaires présentes forment une barrière impressionnante autour d’Evo Morales, qui déclare : « Ce n’est qu’avec la force du peuple que nous en finirons avec l’État colonial et le néolibéralisme […]. Je demande à mes frères indigènes qu’ils me contrôlent et, si je n’avance pas suffisamment, qu’ils me poussent ! Nous assistons au triomphe d’une révolution démocratique et culturelle. Nous passons de la résistance à la prise de pouvoir [1]. »
En ce début d’année 2006, l’élection du « premier président indigène du pays » donne une légitimité à des forces sociales qui n’avaient jusqu’à présent pas droit d’entrée sur la scène politique [2]. Les insurrections boliviennes engendrent une expérience politique inédite : alors que le Chiapas se proclame autonome [3] et que le mouvement altermondialiste discute encore des thèses de John Holloway pour « changer le monde sans prendre le pouvoir », des groupes sociaux subalternes accèdent au gouvernement du pays. Comme les communes ouvrières qui ont émergé en Europe depuis la fin du XIXe siècle [4], elles posent la question du pouvoir et de son exercice : leur protagonisme politique, déjà évoqué lors de la « guerre de l’eau » à Cochabamba, ne vise pas seulement à mettre en place des mesures sociales, mais à refonder les pratiques politiques du pays et mettre fin à « cinq cents ans de domination coloniale ».
Cet objectif de « révolution démocratique et culturelle » peut évidemment se comprendre comme une forme de rupture avec le monde politique du passé. Selon Ivan Ermakoff, une situation révolutionnaire se produit « quand des groupes ne se conforment plus aux règles et que cette non-conformité rompt avec les attentes produites par les institutions [5] ». Le cycle d’insurrections des années 2000-2005 avait déjà fissuré l’ordre institutionnel du pays [6], au point de susciter la revendication d’une Assemblée constituante capable de produire une refondation politique et sociale. Et, de fait, on retrouve dans la façon dont les insurrections boliviennes débouchent sur la prise du pouvoir, et sur l’instauration d’un pouvoir constituant, les caractéristiques attribuées par Hannah Arendt aux révolutions : elles incarnent un « nouveau commencement [7] ». La révolution portée par Evo Morales représente cependant une rupture un peu particulière dans la mesure où elle passe par un processus électoral tout à fait légal. Bien plus, elle porte un héritage complexe, marqué par la « convergence de deux traditions de lutte [8] » au sein même du parti accédant au pouvoir, le Mouvement vers le socialisme (MAS), avec d’une part les insurrections indigènes qui, depuis le XVIIIe siècle, ont soulevé l’Altiplano et d’autre part le mouvement national-populaire qui structure les syndicats ouvriers et paysans depuis la révolution de 1952. Cette convergence des mouvements populaires (indigène, paysan, ouvrier) et de leur expression électorale dans le MAS est exceptionnelle dans l’histoire politique bolivienne : les moments insurrectionnels ont reconstitué les solidarités sectorielles passées (souvent mises à mal par les politiques néolibérales) autour de la revendication d’une souveraineté nationale articulée aux luttes indigènes.
Le déplacement des conflits dans les périphéries urbaines (Cochabamba, El Alto), à l’occasion des « guerres » de l’eau et du gaz, exprime bien plus que des transformations de la société bolivienne liées à des processus migratoires de la campagne vers la ville : il témoigne de nouvelles alliances forgées, dans les quartiers, par des formes communautaires d’organisation où la symbolique des insurrections indigenes « a entraîné d’autres groupes qui avaient des demandes sectorielles (comme les mineurs avec la réforme de leurs retraites) [9] » dans une perspective commune de luttes politiques. Cet héritage du passé dans un double processus insurrectionnel et électoral constitue la spécificité de la « révolution démocratique et culturelle ».Toute révolution a bien une « dimension cosmologique [10] », au sens où il y a dans le processus qui porte Evo Morales au pouvoir plus qu’un appel au passé pour produire du nouveau : une volonté de bouleversement, une inversion de l’ordre des choses, des richesses et des imaginaires, l’idée que le temps du « changement de la terre », le Pachakuti, est enfin arrivé [11]. La révolution se fait « processus de changement », en appelant une autre façon de faire de la politique.
Une partie de la Bolivie refuse pourtant ce changement, dès les résultats proclamés, avec une violente obstination. Les bourgeoisies urbaines, les propriétaires terriens de l’Oriente, les secteurs entrepreneuriaux vont bientôt tout faire pour rendre l’exercice du pouvoir impossible ; réclamant le « retour de la démocratie » par les moyens les moins démocratiques, ils vont jusqu’à tenter d’affaiblir le gouvernement et de rompre l’unité du pays avec la revendication des autonomies régionales. Evo Morales peut, déjà, crier au coup d’État, il sait, en ce début 2006, que sa victoire est incontestable. Elle sera confirmée par les élections suivantes, au moins jusqu’en 2014. Au-delà de la rhétorique décoloniale et de l’empreinte des mouvements sociaux, la légitimité politique de la « révolution démocratique et culturelle » est avant tout électorale, ce qui n’est pas dénué d’ambiguïtés : issu de l’alliance du syndicalisme cocalero et de la gauche partisane bolivienne dans les années 1990, le MAS constitue une tentative pour concilier le pouvoir des bases et la participation au jeu politique. Loin de se vouloir « représentatif » au sens où il porterait par en haut les demandes formulées par en bas, il est conçu comme « l’instrument politique [12] » des organisations sociales, dont il permet la participation directe aux processus électoraux – seule garantie que les engagements du pouvoir seront respectés.
Ce gouvernement des mouvements sociaux se présente comme une façon de résoudre les contradictions de la représentation politique, où le pouvoir du délégué tend d’autant plus à concentrer le capital politique qu’il s’inscrit dans une organisation permanente de profes sionnels de la politique (un appareil [13]). Il semble offrir des garanties à un contrôle des bases. Moins qu’un niveau intermédiaire entre le champ politique et la population, les organisations sociales représentent la force des formes d’auto-organisation, lesquelles posent le problème de l’articulation au politique. Il y a là une spécificité des mobilisations boliviennes et de la revendication d’autogouvernement qui les porte : alors que les lectures « néo- institutionnelles », telles que celles formulées par Ostrom en matière de gestion des ressources naturelles, les réduisent à des négociations locales entre communautés, la lecture « subalterniste », telle que théorisée par Toni Negri et Michael Hardt ou par Raquel Gutiérrez Aguilar, rejette les institutions publiques comme l’État pour situer l’origine de la production de commun « par en bas ». Le processus de changement ne répond à aucune de ces deux lectures : en tant que gouvernement des mouvements sociaux et instrument politique des organisations sociales, le parti au pouvoir s’appuie sur l’entrée en politique de groupes subalternes dont les formes d’auto-organisation ont constitué à la fois le ressort et le modèle d’action ; mais il s’inscrit aussi dans un processus de construction de l’État : celui-ci est nécessaire aussi bien pour mettre en œuvre le processus constituant (organiser des élections, etc.), rétablir la souveraineté nationale et enclencher le processus d’industrialisation – réclamations formulées dans « l’agenda d’octobre » par les mouve- ments sociaux [14] – que pour garantir le minimum de mesures de redistribution économiques, qu’un gouvernement de gauche au pouvoir ne peut qu’adopter pour lutter contre les inégalités.
Je n’ai sans doute pas, à cette période, une claire perception de l’étendue des contradictions engendrées par ce processus de construction de l’État. Mais je suis convaincu, au vu des premiers terrains réalisés à El Alto, que mes enquêtes m’offrent un point d’observation privilégié pour étudier les effets des politiques du nouveau gouvernement sur les populations défavorisées des périphéries urbaines, et surtout la consolidation de ces formes d’auto-organisation qui se présentent alors, pour moi, comme un renouveau concret des idéaux d’émancipation sociale et politique – la résurgence, ou plutôt la réinvention, d’une tradition oubliée des mouvements populaires [15]. »
Franck Poupeau, Altiplano. Fragments d’une revolution (Bolivie 1999-2019), Raisons d’Agir, Paris, 2021.













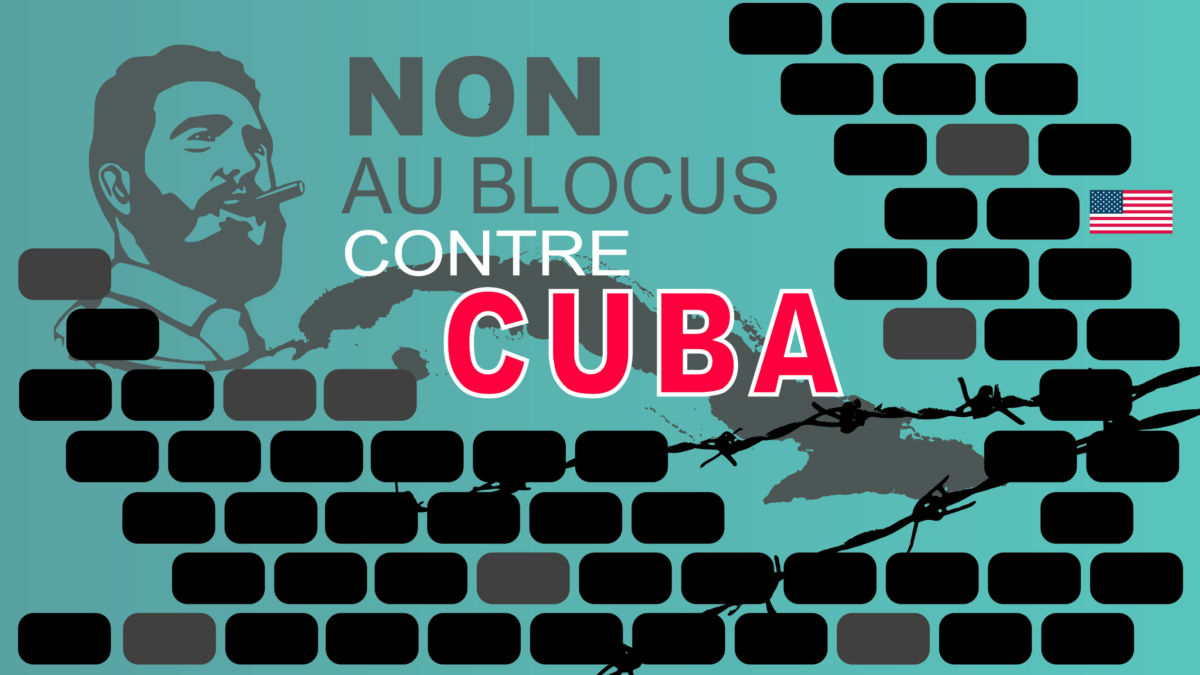










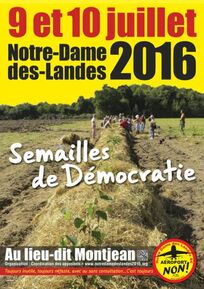







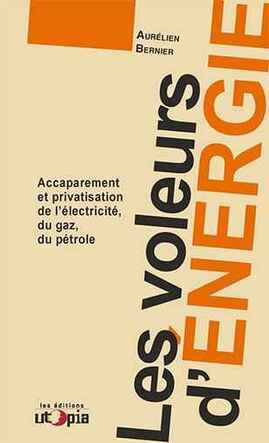

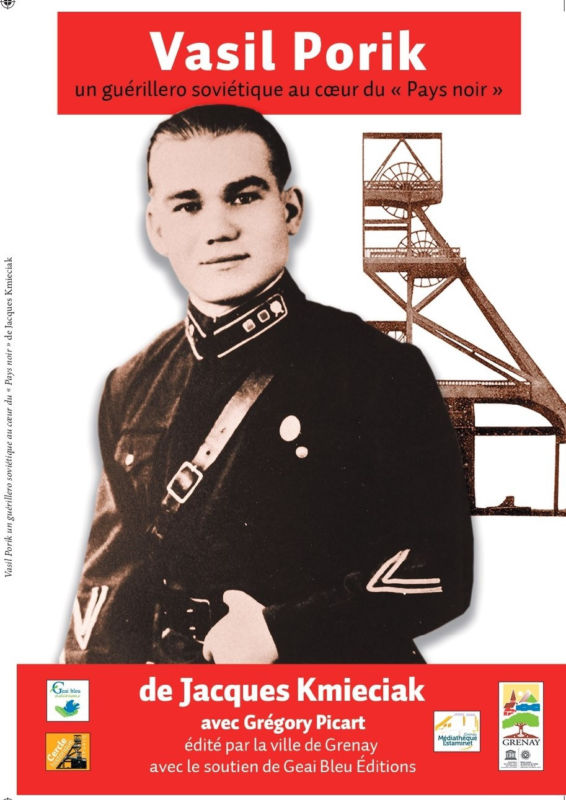

 Gaëlle Pairel : « Par leurs parcours de vie et d’écriture, toutes ces femmes ont contribué à la richesse culturelle de la Bretagne. »
Gaëlle Pairel : « Par leurs parcours de vie et d’écriture, toutes ces femmes ont contribué à la richesse culturelle de la Bretagne. »