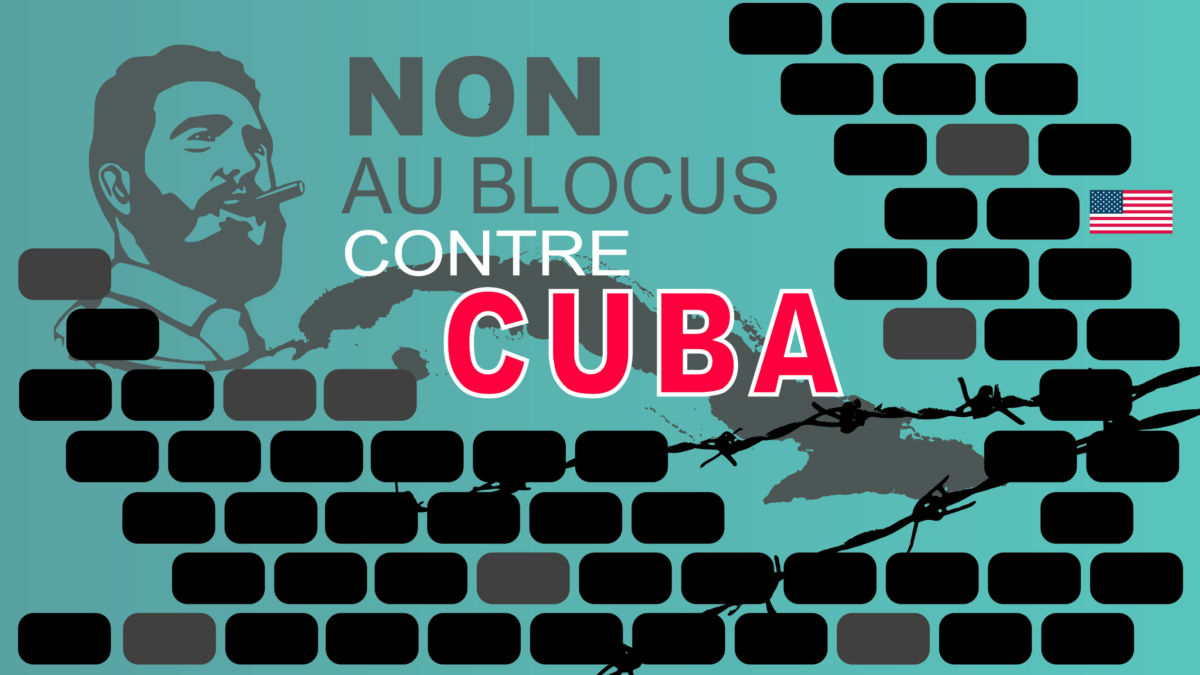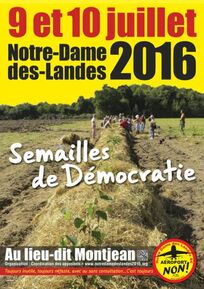-
Soutenu par Washington, le Massacre de la gauche indonésienne au nom de l’anticommunisme (lescrises.fr-23/02/21)
 1965 : un communiste présumé est interrogé sous la menace d’une arme par des soldats indonésiens. (Université de Melbourne)
1965 : un communiste présumé est interrogé sous la menace d’une arme par des soldats indonésiens. (Université de Melbourne)Le massacre de la gauche indonésienne en 1965-66, soutenu par Washington, a été l’un des grands crimes du XXe siècle. Une nouvelle génération d’universitaires a découvert l’histoire longtemps occultée du massacre de près d’un million de personnes au nom de l’anticommunisme.
Analyse du livre : Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia [non traduit en français : Des histoires enfouies : les massacres anticommunistes de 1965-1966 en Indonésie, NdT] par John Roosa (University of Wisconsin Press, 2020).
Dans la nuit du 30 septembre 1965, un coup d’État raté a entraîné la mort d’une poignée de généraux indonésiens, d’un lieutenant et de la fille de cinq ans d’un général qui avait échappé à l’enlèvement. En quelques jours, une figure militaire relativement inconnue, Suharto, a passé outre la chaîne de commandement. Suharto a accusé de ces meurtres le Parti communiste indonésien (PKI), le plus grand parti communiste en dehors de l’Union soviétique et de la République populaire de Chine. Et il a juré vengeance.
Voilà ce qui a déclenché une série d’événements mystérieux et souvent déroutants qui ont conduit à la chute du président fondateur de l’Indonésie, Sukarno – personnage anti-impérialiste qui avait cherché à forger l’unité nationale en combinant les forces du nationalisme, de la religion et du communisme – et à la montée de l’Ordre nouveau de l’autoritaire général Suharto (1966-1998), une période de dictature militaire d’extrême droite, de corruption à grande échelle et d’une campagne débridée d’investissements étrangers. Suharto a tout à la fois préfiguré et dépassé son analogue chilien, Augusto Pinochet.
Le cercle d’officiers gravitant autour de Suharto a immédiatement incité l’opinion publique à s’opposer au PKI. Prétendant qu’il y avait une conspiration massive qu’ils ont appelé Gestapu ou G30S/PKI (abréviation de « Mouvement du 30 septembre/PKI »), ils ont mis en garde contre une menace imminente de soulèvement communiste à l’échelle nationale. Sur ordre de Jakarta, les commandants régionaux ont lancé des campagnes d’arrestation, de torture et d’exécution.
Nous n’en avons pas le chiffre exact, mais l’armée et ses acolytes ont tué entre cinq cent mille et un million de personnes en l’espace d’une année, et un nombre équivalent de gens ont été envoyés dans d’atroces prisons partout dans le vaste archipel du pays, dont la plus tristement célèbre est l’île de Buru. Les prisonniers y ont travaillé comme esclaves pendant des années. Après leur libération, ils ont été soumis à la répression officielle et traités comme des parias sociaux. Même les enfants des anciens prisonniers ont été victimes de graves discriminations.
Le PKI était la cible présumée de cette purge sanglante, mais celle-ci a également fait disparaître de nombreux autres gauchistes, y compris des féministes, des syndicalistes et des artistes. Parce que les tueurs ont dirigé l’État pendant des décennies, une génération d’Indonésiens a ingéré un flux constant de propagande tapageuse qui prétendait à tort que le PKI avait planifié sa propre campagne de meurtres de masse. Même après la chute de Suharto et la restauration de la démocratie, ce mensonge reste le récit officiel de l’État indonésien. Comme l’ont montré les récentes manifestations anticommunistes à Jakarta et les raids sur les livres dans les villes de province, tirer à boulets rouges sur le communisme reste toujours une puissante composante de la politique indonésienne contemporaine.
Un silence international
Si ces événements ont fait la une des journaux internationaux en 1965, ils ont rapidement été oubliés en Occident. Pourquoi « l’un des pires massacres du XXe siècle » – comme l’a décrit un rapport de la CIA de 1968 – a-t-il été balayé sous le tapis si rapidement ? En 1973, un document secret de la CIA exprimait son soulagement face au changement radical de direction au sommet :
Sukarno a exprimé sa volonté de leadership dans une rhétorique révolutionnaire et il était convaincu que l’Indonésie devait dominer ses voisins ; Suharto parle de solutions pragmatiques aux problèmes de la région et considère Jakarta comme leader parmi ses pairs.
L’anticommunisme virulent de Suharto et sa volonté de servir les intérêts de la guerre froide américaine ont encouragé des flux réguliers d’aide militaire et de capitaux étrangers. La réticence de Washington à condamner les crimes du Nouvel ordre a toujours été partagée par les deux partis.
Après avoir dans un premier temps célébré la chute de Sukarno et la neutralisation du PKI, non sans avoir apporté quelques éclaircissements sur son caractère malheureusement sanglant, la presse occidentale n’a plus guère parlé de l’Indonésie. Une fois que Suharto a éliminé le PKI, la guerre au Vietnam est passée au premier plan. Après 1975, ce sont les atrocités communistes,qu’elles soient réelles ou imaginaires, qui ont dominé dans la presse quand on parlait d’Asie du Sud-Est.
 Un visiteur passe devant une photo de Suharto, l’ancien dictateur indonésien, au musée Suharto le 06 mai 2016 à Yogyakarta. (Ulet Ifansasti / Getty Images)
Un visiteur passe devant une photo de Suharto, l’ancien dictateur indonésien, au musée Suharto le 06 mai 2016 à Yogyakarta. (Ulet Ifansasti / Getty Images)Seuls quelques journalistes ont couvert le massacre indonésien. Des livres comme celui de John Hughes, Indonesian Upheaval paru en1967, ont repris le récit complaisant que faisait l’armée indonésienne. Hughes a véhiculé les stéréotypes orientalistes parlant de paysans javanais en proie à une orgie de violence inouïe et de pieux hindous balinais marchant calmement au-devant de leurs tueurs. Dans son livre, In the Time of Madness: Indonesia on the Edge of Chaos, publié en 2006, Richard Lloyd Parry a suivi ses traces.
Dans le film Manufacturing Consent (La fabrique du consentement), Noam Chomsky note que la presse occidentale n’a pas su aborder la violence anticommuniste de droite aussi minutieusement que les violations des droits humains dans les États communistes. Il a opposé l’importante couverture du régime des Khmers rouges (1975-78) par le New York Times au peu d’attention que le journal a accordé à l’invasion génocidaire de Suharto et à l’occupation du Timor oriental (1975-1999).
Pendant des décennies, les militants politiques et les universitaires ont été exaspérés par l’indifférence générale à l’égard de la détention injustifiée, de la torture violente et du meurtre de masse de centaines de milliers d’Indonésiens. Amnesty International et TAPOL [« prisonniers politiques » en indonésien, NdT], rejoints par le Réseau d’action du Timor oriental en 1991, se sont engagés dans des campagnes visant à dénoncer les violations des droits humains commises par le Nouvel ordre. Pourtant, leurs efforts ont souvent semblé futiles, les médias grand public n’accordant que peu d’attention à la situation.
Les universitaires ont souvent hésité à se manifester. Benedict Anderson et Ruth McVey ont rédigé un rapport secret critiquant le régime en 1966, et George McT. Kahin a fait publier par l’université de Cornell le « Cornell Paper » en 1971 ; tous ces spécialistes de l’Indonésie se sont ensuite vus interdire l’entrée dans le pays. Cela a eu un effet dissuasif sur les autres universitaires qui critiquaient le régime.
Faire des recherches sérieuses sur le sujet étaient pratiquement impossible dans l’État policier de Suharto. De nombreux universitaires ont choisi l’autocensure dans l’espoir d’obtenir de très convoités visas de recherche. Avant mon premier voyage en Indonésie en tant qu’étudiant de troisième cycle en 1990, la faculté m’a averti de ne pas parler de 1965.
Tout à coup, une historiographie rigoureuse
La crise économique de l’Asie du Sud-Est de la fin des années 1990 a particulièrement frappé l’Indonésie, et une révolution du pouvoir populaire a renversé Suharto en 1998. D’un seul coup, les règles ont changé. Les prisonniers politiques ont été libérés et le président intérimaire B. J. Habibie a autorisé le Timor-Oriental à organiser un référendum sur l’indépendance. Le successeur élu de Habibie, Abdurrahman Wahid (connu sous le nom de Gus Dur), a reconnu la complicité des organisations islamiques dans les massacres de 1965-66 et a envisagé la nécessité d’une réconciliation.
Des universitaires et des militants ont saisi l’occasion. Mon ami Bonnie Triyana, alors étudiant en licence, allait fonder le premier magazine d’histoire populaire du pays, Historia. Il a réussi à obtenir l’accès à des archives militaires provinciales et à des dossiers sur la destruction d’un village du centre de Java. John Roosa, un doctorant américain récemment diplômé qui s’était spécialisé dans l’histoire de l’Asie du Sud au cours de ses études supérieures, avait un proche qui avait été incarcéré sous Suharto. En utilisant les relations nouées lors de sa visite de la prison et les contacts de la communauté locale des militants, il a commencé à interroger d’anciens prisonniers politiques.
Une partie de ce travail a servi de base au livre de Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia [non traduit en français : Un prétexte pour un massacre : Le mouvement du 30 septembre et le coup d’État de Suharto en Indonésie, NdT], l’histoire politique complète de l’événement qui a déclenché le génocide indonésien. Publié en 2006, Pretext for Mass Murder a marqué un changement radical en comparaison avec les études de 1965. Aujourd’hui professeur associé d’histoire à l’Université de Colombie britannique, Roosa a écrit une suite à Pretext for Mass Murder.
Produit de plus de deux décennies de travail, le livre de Roosa : Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia [ non traduit en français : Histoires enfouies : Les massacres anticommunistes de 1965-1966 en Indonésie, NdT] est une étude minutieusement rédigée de ces événements. Le livre fait la lumière sur les mécanismes précédemment cachés du massacre et dissipe un certain nombre de mythes sur ce moment sombre de l’histoire indonésienne. Basé sur des dizaines d’entretiens et des recherches dans les archives, Buried Histories est une addition bienvenue au travail scientifique de plus en plus important sur ce que d’aucuns ont appelé un génocide politique.
 Sukar, 83 ans, un villageois qui a été témoin du massacre anticommuniste en Indonésie, à côté de la pierre tombale disposée par des militants et des familles de victimes sur le site où des victimes pourraient être enterrées, au milieu de la forêt de teck du village de Plumbon le 3 mai 2016 à Semarang, dans le centre de Java, en Indonésie. (Ulet Ifansasti / Getty Images)
Sukar, 83 ans, un villageois qui a été témoin du massacre anticommuniste en Indonésie, à côté de la pierre tombale disposée par des militants et des familles de victimes sur le site où des victimes pourraient être enterrées, au milieu de la forêt de teck du village de Plumbon le 3 mai 2016 à Semarang, dans le centre de Java, en Indonésie. (Ulet Ifansasti / Getty Images)Les lecteurs de Jacobin savent sans doute qu’il existe une série de livres récents sur les événements de 1965-66, dont beaucoup sont passés en revue ici. Si des historiens tels que Geoffrey Robinson, Jess Melvin et Annie Pohlman ainsi que des journalistes comme Vincent Bevins ont tous apporté une contribution importante à ce sujet, on peut se demander ce qu’un autre livre pourrait offrir. Heureusement, la réponse est qu’il peut encore beaucoup apporter.
Buried Histories est un livre en deux parties. L’introduction remarquablement écrite parvient tout à la fois à humaniser cette histoire terrible et à présenter un aperçu des événements ainsi qu’un résumé de l’historiographie. Les chapitres 1 à 4 exposent les questions qui ont eu un impact sur l’Indonésie dans son ensemble, tandis que les chapitres 4 à 7 proposent des études de cas sur des régions précises.
Bien qu’ils soient centrés sur des contextes locaux distincts, chaque chapitre propose un plaidoyer convaincant et judicieux qui est pertinent pour l’histoire nationale de l’Indonésie dans son ensemble. La conclusion énumère de manière concise les principaux acteurs responsables des meurtres : hauts responsables de l’armée, commandants régionaux et milices civiles. Une dernière section décrit les difficultés et les dangers rencontrés quand on veut mener une réflexion honnête sur cette histoire dans l’Indonésie contemporaine.
Une rivalité gramscienne
Roosa commence par évoquer la lutte entre le PKI et l’armée pendant la période de la Guided Democracy de Sukarno (1957-1965). Constatant que sous la direction de D. N. Aidit, le PKI a abandonné une stratégie basée sur l’insurrection armée pour se tourner vers une stratégie de compétition électorale, Roosa utilise la théorie de l’hégémonie d’Antonio Gramsci pour décrire comment Aidit, après la suspension de la démocratie sous Sukarno, a construit l’influence du parti en mobilisant des organisations de masse de compagnons de route.
La SOBSI [La Fédération pan-indonésienne des organisations de travailleurs, NdT] a organisé le mouvement syndical, le LEKRA [Le Lembaga Kebudajaan Rakjat était un mouvement littéraire et social très prolifique associé au parti communiste indonésien, NdT] a rassemblé des artistes et le BTI [organisation paysanne affiliée au PKI, NdT]a aidé les paysans à mettre en œuvre la réforme agraire. Le parti était également étroitement allié à Gerwani [650 000 membres en 1957, NdT] probablement le plus grand mouvement féminin du monde au début des années 1960, bien qu’il ne soit pas contrôlé par le PKI.
Dans un effet miroir avec la stratégie Gramscienne du PKI, l’armée a étendu son pouvoir à toute l’Indonésie sous couvert de Commandement territorial. Cette structure organisationnelle a permis à l’armée de placer ses officiers dans les bureaux des gouvernements provinciaux, donnant à l’armée une influence significative, voire un contrôle total de la bureaucratie administrative, ainsi que d’excellentes sources de renseignements.
Si tant le PKI que l’armée ont réussi à étendre leur influence sur l’ensemble de ce vaste archipel, seule l’armée avait accès aux armes. Lorsque le conflit a éclaté en octobre 1965, il a été très facile pour l’armée de prendre le contrôle de l’État et d’agir contre ses opposants non armés et sans méfiance. Roosa indique qu’il existe des preuves concrètes montrant que les officiers formés aux États-Unis attendaient le bon prétexte pour attaquer le PKI, une théorie que Vincent Bevins souligne dans son ouvrage, La méthode de Jakarta.
Opérations mentales
Les deux chapitres suivants du livre de Roosa expliquent l’utilisation de la propagande et de la torture par l’armée. S’engageant dans ce que les généraux ont appelé les « Opérations mentales », immédiatement après l’échec du coup d’Etat, les journaux et la radio contrôlés par l’armée ont accusé le PKI d’être responsable des meurtres et ont mis en garde contre une plus grande campagne d’effusion de sang. Selon cette campagne de propagande, probablement planifiée à l’avance et très certainement orchestrée, l’armée s’était trouvée dans l’obligation d’écraser le PKI afin d’empêcher le parti de s’engager dans un massacre de masse.
Cet argument « tuer ou être tué » était un mensonge. La presse a prétendu, à tort et à travers, que le PKI détenait un arsenal d’armes secrètes et creusait secrètement des fosses communes pour ses victimes à venir. Répandant des rumeurs fausses mais morbidement fascinantes sur des adhérentes détraquées de Gerwani qui auraient mutilé sexuellement les généraux, l’armée s’est servi de la misogynie pour mobiliser un fort sentiment anti-PKI.
Une fois que les arrestations de masse ont commencé, l’armée s’est tournée vers l’utilisation généralisée de la torture. À première vue, l’utilisation systématique de la torture semble simplement sadique et sans but pratique, mais Roosa soutient de manière convaincante qu’elle a servi à promouvoir les mensonges de la machine de propagande. Les prisonniers étaient torturés jusqu’à ce qu’ils fassent des aveux absurdes.
En suivant le travail d’Annie Pohlman et de Saskia Wieringa, Roosa montre que les femmes ont été victimes de viols et autres formes de violence sexuelle à grande échelle. En dépit de leur ignorance de ce qui s’était passé dans le cercle restreint des dirigeants du PKI d’Aidit, les membres de la base du parti, les syndicalistes et des centaines de milliers d’autres personnes prises dans le filet de l’armée ont été torturés jusqu’à ce qu’ils avouent avoir participé à une conspiration majeure, impliquant souvent ainsi d’autres innocents.
 Eko Soetikno, 75 ans, à son domicile, le 4 mai 2016 à Kendal, dans le centre de Java, montre la photo qui le représente avec l’écrivain indonésien Pramoedya Ananta Toer qui a été emprisonné sur l’île de Buru. (Ulet Ifansasti / Getty Images)
Eko Soetikno, 75 ans, à son domicile, le 4 mai 2016 à Kendal, dans le centre de Java, montre la photo qui le représente avec l’écrivain indonésien Pramoedya Ananta Toer qui a été emprisonné sur l’île de Buru. (Ulet Ifansasti / Getty Images)Bien qu’elles soient évidemment fausses, ces déclarations pouvaient servir de preuve pour justifier la campagne de violence de l’armée. Une fois qu’une personne avait signé des aveux, ceux-ci devenaient un fait juridique aux yeux de l’État, justifiant les arrestations et rationalisant la recherche d’autres membres de la prétendue conspiration G30S/PKI. La torture a principalement fait apparaître la théorie de la conspiration des Opérations mentales.
Le raisonnement de Roosa met en lumière l’utilisation similaire de la torture par les Khmers rouges au Cambodge. Les aveux tout aussi absurdes extorqués dans la prison de Tuol Sleng à Phnom Penh étaient un moyen pour le régime de Pol Pot de rationaliser ses actions et de confirmer son idéologie. Alors qu’ils étaient aux antipodes de l’éventail politique de l’Asie du Sud-Est de la guerre froide, tant les communistes cambodgiens que les anticommunistes indonésiens ont instrumentalisé la violence pour faire de leurs fantasmes paranoïaques une réalité bureaucratique.
Surprises mortelles
La deuxième section de Buried Histories se penche sur la destruction du PKI à Surakarta, les disparitions à Bali, le massacre de Kapal à Bali et l’attaque de l’armée contre les travailleurs syndiqués du pétrole à Sumatra. Dans chaque cas, Roosa dissipe le mythe orientaliste de John Hughes qui attribue le massacre à des foules hystériques de patriotes anticommunistes, de musulmans enragés et d’hindous fatalistes. Au lieu de cela, comme Robinson et Melvin, il démontre que les dirigeants de l’armée à Jakarta ont soigneusement orchestré la violence, qui a été mise en œuvre sur le terrain par des officiers régionaux qui se sont souvent appuyés sur le crime organisé et les organisations de masse anticommunistes, comme le Nahdlatul Ulama musulman [représente l’islam traditionnel indonésien, ou plus précisément javanais, NdT] pour acquérir des forces.
Le succès de l’armée repose sur le déploiement bien planifié de la force militaire contre des civils non préparés. Les plans ayant été mis en place bien avant que les membres du PKI n’aient la moindre conscience qu’ils étaient en danger, la résistance dans une telle situation était pratiquement impossible. La campagne nationale de massacre de masse a duré environ six mois. Commencés à Aceh, à l’extrême ouest, puis se déplaçant vers l’est en passant par Sumatra, Java et allant jusqu’à Bali, les massacres ont consisté en une série d’attaques surprises contre un parti civil légal et ses organisations partenaires. Roosa montre comment les membres du PKI dans le centre de Java et à Bali se rendaient volontiers aux postes de police lorsqu’ils étaient convoqués, n’ayant aucune idée des horreurs qui les attendaient.
En mettant en parallèle des chapitres nationaux avec des études de cas régionales, Buried Histories nous montre à la fois la forêt et les arbres. Tout au long du texte, Roosa ne perd jamais de vue les horreurs infligées à des individus qui ne savaient pas qu’ils étaient en danger. À la fin du livre, il aborde les différentes tentatives de reconnaissance de ces crimes et le rejet permanent d’une évaluation morale et éthique de cette sombre histoire.
En ces temps d’autoritarisme croissant et de polarisation de la violence politique, Buried Histories est une lecture indispensable. Après une année au cours de laquelle des agents fédéraux non identifiés se sont saisi de citoyens américains dans les rues de Portland, nous ferions bien de regarder Indonésie 1965 pour nous servir de véritable cas d’école.
Michael G. Vann, 23/02/21
Michael G. Vann est professeur d’histoire à l’université d’État de Sacramento, il est l’auteur, avec Liz Clarke, de The Great Hanoi Rat Hunt : Empire, Disease, and Modernity [non traduit en français : La grande chasse au rat de Hanoi : empire, épidémie et modernité dans le Vietnam colonial français, NdT].
Source en anglais : Michael G. Vann: https://jacobinmag.com/
Source en français (traduction par les lecteurs du site Les Crises): https://www.les-crises.fr/
« Birmanie: solidaires du mouvement populaire.(IC.fr-23/02/21)LFI candidate aux régionales : « On n’est pas des gauchistes ! » (LT.fr-23/02/21-17h17) » Tags : Indonésie, génocide, anti-communisme, répression, Impérialisme US
Tags : Indonésie, génocide, anti-communisme, répression, Impérialisme US
-
Commentaires
le blog franchement communiste du finistère-morbihan