Introduction aux trois parties : 1960 est l’année du passage du Ghana au statut de république, Kwame Nkrumah en devenant le président. Soixante ans plus tard, il demeure en Afrique une référence majeure. Cependant, il y a cinq décennies déjà, le philosophe Paulin Hountondji avait lancé un appel : « L’échec de Nkrumah mérite d’être médité ». C’est à une compréhension de cet échec que veut, modestement, contribuer ce texte.
CPP : Entre socialisme africain et socialisme
Car, malgré la mention, alors considérée comme nouvelle, de la “lutte des classes” dans le discours de certains membres d’un CPP (devenu parti unique en janvier 1964), Le Consciencisme demeurait encore attaché à l’African personality, au socialisme africain, alors ardemment défendu par maints dirigeants du CPP. Certes, la “Révolution” ghanéenne était censée entrée dans une nouvelle phase après l’instauration (par voie référendaire) du monopartisme (au nom aussi de la supposée tradition africaine), avec le lancement du plan septennal (1964-1970), mais celui-ci a été considéré par Ikoku comme une « politique économique […] orientée vers le socialisme, mais mise en œuvre par des hommes hostiles au socialisme, liés au capitalisme étranger, et souvent corrompus » (op. cit., p. 214). De son côté Y. Bénot a parlé du « Ghana socialiste [qui] manque de socialistes » (op. cit., p. 243). L’hétérogénéité sociale, idéologique, du CPP, mise sous le tapis pendant la phase de la lutte anticoloniale, pour l’indépendance nationale, le non progressisme de l’entourage britannique de Nkrumah (souligné par L. Kaba) s’exprimaient derrière cet attachement de la majorité de la direction du CPP au socialisme africain, ce rejet de la lutte des classes, qui ne s’appuyait nullement sur une sociologie de la société ghanéenne d’alors, sur laquelle était censée s’appuyer la politique sociale de l’État ghanéen selon Nkrumah. C’est, par exemple, le déni de la lutte des classes qui explique l’insignifiance des expressions supposées de l’antériorité du “socialisme africain” à l’égard du marxisme, présentées par Baako, sans allusion à la question fondamentale de la propriété privée des moyens de production dans la société ghanéenne post-coloniale ainsi que des classes sociales qui lui sont liées. Sinon, en la considérant de façon assez légère, comme le rapporte Yves Bénot : « Il [Baako] avait déclaré quelques semaines plus tôt [en avril 1964], à un meeting organisé par les syndicats, que le socialisme était une affaire de cerveaux, et non de richesse et de pauvreté. Celui qui est riche mais fait servir son cerveau à un usage progressiste est socialiste, alors que celui qui est pauvre mais utilise mal son cerveau, est réactionnaire. Les travailleurs d’Accra se contentèrent de rire » [1].
En effet, le CPP, se voulant parti de la « nation entière », en période post-coloniale, ne pouvait être dépourvu d’éléments de la « classe […] associée au pouvoir social » pendant la période coloniale et que l’indépendance avait d’ailleurs développée, élargie. Aussi à partir de l’africanisation des postes de direction qu’avait initiée Nkrumah devenu Premier ministre du nouvel État indépendant (1957, membre du Commonwealth et ayant ainsi pour cheffe la Reine d’Angleterre). Bien au contraire, leur présence était devenue assez déterminante dans la vie du CPP, par conséquent dans sa gestion de l’État, dans la structuration de la société ghanéenne. Ce qui s’illustrait déjà par, entre autres, des pratiques qui se développeront aussi dans les autres États indépendants africains. Ainsi, dès 1960 (année de après l’érection du Ghana en République), C. L. R. James (un des anciens mentors marxistes de Nkrumah) faisait remarquer aux cadres du CPP que « When I was here in 1957, I got certain impressions of what was taking place. Since I have come back here in 1960 there has been great progress. The situation however has changed and I notice now what was not noticeable then, a tremendous concern with bribery and corruption in government. I have seen it in the newspapers and people are talking to me about it and people who are patriotic citizens are talking about it because they want their country in that respect also to be as advanced as any other country in the world » (July 1960) [2]. Samuel Ikoku, – un de ceux que des caciques du CPP considéraient comme des agents de Moscou voulant éloigner Nkrumah du socialisme africain, en le poussant à mettre l’accent sur les intérêts de classe –, va parler de l’existence de « clans procapitalistes », d’une « aile capitaliste du CPP » (p. 194) à son arrivéec au pouvoir, ayant produit par la suite des « nouveaux riches du gouvernement » (p. 204), « la droite du parti, c’est-à-dire des nouveaux riches, des trafiquants haut placés » (p. 215). Il va de soi que les intérêts de ceux-ci ne s’identifiaient pas à ceux des classes populaires, base du CPP comprise. À tel point qu’au lendemain des élections législatives de 1965, ayant consacré le pouvoir de la droite, des procapitalistes à la direction du CPP – pour lesquels travailler à la satisfaction des besoins sociaux des classes populaires n’était pas une priorité –, « le Ghana se trouvait dans cette posture ridicule, de confier la marche vers le socialisme à un parlement [monopartiste, CPP] hostile au socialisme » (p. 121) [3]. Alors qu’une telle transformation, du capitalisme néocolonial au socialisme, devrait s’articuler avec une interprétation dynamique de la société à transformer, qu’auraient partagée les parlementaires, au moins – à défaut de favoriser la participation élargie, au sein des classes populaires, à la production et discussion de cette interprétation. Ceci aurait été incompatible avec l’idéologie petite-bourgeoise du socialisme africain, avec un régime monopartiste (anti-démocratique).
À titre de rappel, encore une fois : en 1962, soit deux ans avant la publication de Le Consciencisme, Nkrumah avait, dans une approche assez illusionnée de la sociologie, considéré, face aux africanistes, que c’est la sociologie qui « apporte les fondements les plus solides pour une politique sociale », non pas l’ethnologie, même transfigurée, d’où sont issues les idées de l’ African personality, du socialisme africain. Mais, celles-ci étaient davantage instrumentalisées, au fil des années post-coloniales, par la majorité droitière de la direction du CPP, dirigeant l’État ghanéen et désormais principalement animée par la reproduction élargie de ses privilèges, comme on put le voir en réaction à la publication de Le néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme (1965) dont l’accent léninien du titre n’était pas considéré comme de bon augure pour ses intérêts, ses privilèges [4]. Ainsi, était confirmé que le discours sur le « retour aux sources » pouvait être « une expression consciente ou inconsciente, d’opportunisme politique de la part de la petite-bourgeoisie » [5], ici en période post-coloniale. Néanmoins, Nkrumah avait apparemment choisi de sous-estimer ou négliger cette expression plutôt consciente qu’inconsciente de l’opportunisme.
Panafricanisme à dominante néocoloniale et anti-impérialisme
Cette attitude s’étendait à son panafricanisme, comme l’illustre sa volonté obsessionnelle de construire un panafricanisme émancipateur avec des dirigeants africains demeurés assez subordonnés aux anciennes puissances coloniales, s’avérant pourtant défenseurs des intérêts néocoloniaux. C’était comme si, par la grâce de l’African personality, l’idéal panafricaniste, supposément commun, aurait transcendé l’adhésion consciente au néocolonialisme, la transfigurant en processus émancipateur des peuples : « l’intérêt de l’Afrique doit être le premier souci des chefs d’États africains » (L’Afrique doit s’unir, 1963). Alors que l’auteur de cet ouvrage est déjà dénonciateur pertinent du néo-colonialisme (chapitre XVIII), bien conscient que le statut de « pères de l’indépendance » de nombre de ses pairs – parmi ceux qui avaient reçu l’indépendance dans les premières années de la décennie 1960 – avait été acquis sans qu’ils aient brillé par quelque véritable lutte contre l’État colonial, par quelque confrontation systématique avec l’ordre colonial. À l’instar de celle que manifestait au Congo belge Émery Patrice Lumumba, à la tête du Mouvement national congolais. Leur statut ayant généralement été acquis comme par quelque faveur de la puissance coloniale.
Ce fût le cas dans les colonies françaises d’Afrique équatoriale et occidentale, où, lors du referendum de 1958, presque tous les principaux dirigeants politiques avaient dressé l’écrasante majorité du corps électoral des territoires à refuser l’indépendance. Ils préféraient la métamorphose de la domination coloniale, c’est-à-dire la Communauté, sous domination métropolitaine évidemment (on n’avait pas manqué de parler de “Commonwealth à la française”), succédant à l’Union française (1946-1958) ayant déjà fait de certains d’entre eux des membres du gouvernement français. Ainsi, Félix Houphouët-Boigny (membre des gouvernements français, de février 1956 à mai 1961 et président de la Côte d’Ivoire à partir de novembre 1960 – il n’y a pas d’erreur dans les dates) avait mal reçu, deux ans plus tard, en 1960, le tournant “décolonisateur” de l’État colonial français (la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance en août 1960 et le président de cette nouvelle République est en même temps ministre du gouvernement français jusqu’en mai 1961). Mais il a vite été rassuré pour la suite par le maintien de la tutelle impérialiste française, à travers, entre autres, les accords dits de coopération entre la France et les nouveaux États dits indépendants (conservant les bases militaires françaises sur leurs territoires). Pour Mehdi Ben Barka, cela « a consisté en résumé à accorder “généreusement” l’indépendance politique, au besoin en créant des États factices, à proposer une coopération dont le but était une prétendue prospérité, mais dont les bases objectives sont en dehors de l’Afrique » [6]. C’était la métamorphose du colonialisme en « néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme » (déjà pratiqué ailleurs, par exemple en Amérique dite latine). Néocolonialisme, que les puissances impérialistes avaient mis à l’ordre du jour des rapports Nord-Sud et auquel n’allait pas échapper alors même un État qui n’avait pas subi strictement la colonisation, l’Éthiopie (membre de la Société des Nations, mais tragiquement occupée de 1936 à 1941 par l’Italie fasciste de Benito Mussolini) [7], alors dirigée par l’empereur Hailé Sélassié.
La participation de l’Éthiopie à la Conférence Afro-Asiatique de Bandung (avril 1955) avait été précédée, en cette période de guerre dite froide, par son alignement derrière les États-Unis d’Amérique pendant la guerre de Corée (1950-1953) et l’hébergement d’une base militaire états-unienne, de 1954 à la chute de l’empereur en 1974, au prix d’une forte dépendance financière. Elle exprimait ainsi, malgré le non-alignement proclamé, une subordination concrète à des intérêts occidentaux. Néanmoins, cette Éthiopie impériale (dans un empire, le principe ce n’est pas l’égalité, mais l’inégalité entre les êtres humains) va être – aussi pour la symbolique d’avoir échappé à la colonisation – le lieu de naissance de l’Organisation de l’unité africaine (1963) et abriter son siège. Comme s’il s’agissait de symboliser aussi que l’anti-colonialisme – tardivement manifesté par bon nombre de “pères de l’indépendance” –, faussement supposé anti-impérialiste, ne signifiait surtout pas anticapitalisme, en ces temps de la guerre dite froide.
La posture anti-impérialiste étant alors, comme il a été dit plus haut, non seulement celle d’un Arthur Lewis, bien qu’économiste du développement, d’un développement capitaliste et partisan du Congrès pour la liberté de la culture, mais aussi celle du chef du Gouvernement provisoire de la France libérée de l’occupation allemande nazie, le général Charles de Gaulle. L’organisateur de la Conférence des gouverneurs généraux à Brazzaville (1944) qui avait écarté dans ses recommandations « la constitution éventuelle, même lointaine, de self-governments dans les colonies » et qui comme premier président de la Ve République française (à partir de 1958), considéré comme “décolonisateur”, ayant pourtant eu sa part de guerre contre les nationalisme algérien (1954-1962) et camerounais (1955-1971), s’est, en effet, proclamé anti-impérialiste, à un certain moment : « Nous avons procédé à la première décolonisation jusqu’à l’an dernier. Nous allons passer maintenant à la seconde. Après avoir donné l’indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L’Europe occidentale est devenue, sans même s’en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s’agit maintenant de nous débarrasser de leur domination […] Le grand problème, maintenant que l’affaire d’Algérie est réglée, c’est l’impérialisme américain. Le problème est en nous, parmi nos couches dirigeantes, parmi celles des pays voisins. Il est dans les têtes. » (4 janvier 1963) [8]. Comme si l’esprit de la Communauté n’avait pas continué d’animer les relations des États nouvellement indépendants avec l’ancienne métropole coloniale, impactant le processus panafricaniste institutionnel. Sous la forme, entre autres, d’opposition menée par F. Houphouët-Boigny à l’orientation préconisée par Kwame Nkrumah (L’Afrique doit s’unir, 1963), ayant abouti à une Organisation de l’unité africaine, à l’unité minimale plutôt qu’au déclenchement d’un processus devant aboutir à une union africaine. L’attitude du chef de l’État ivoirien, par ailleurs co-leader du projet de l’Eurafrique, illustrait assez bien, selon Nkrumah, le néocolonialisme, français en l’occurrence, dont la critique va s’accentuer, avec la publication de Le néo-colonialisme, dernier stade de l’impérialisme.
À propos d’un Ghana communiste
Ce dernier ouvrage de Nkrumah président exprime non seulement sa conscience des mécanismes de dépendance des ex-colonies françaises à l’égard de l’ex-métropole coloniale, devenue métropole néocoloniale, comme obstacle à l’unité africaine vers l’union africaine, mais aussi celle de la toile tissée par l’impérialisme, en général. À l’égard duquel l’État ghanéen ne pouvait alors, malheureusement, se targuer d’être indépendant et qui ne pouvait, selon Nkrumah, être combattu, avec efficience, que dans une unité africaine vers l’union des États africains. Emprise impérialiste à laquelle Nkrumah s’accommodait, en effet, comme le rappelait en mai 1964 un journaliste états-unien, paraissant bien connaître le Ghana, voire Nkrumah et connu de lui, et qui s’était même encore entretenu avec Nkrumah quelques semaines auparavant, « Although Ghana would seen to be on the verge of becoming an orthodox Marxist state, there is a wide gap between theory and reality. Only one foreign firm has been nationalized – and generously compensated. Ghana’s trade is still largely with Europe, and most foreign aid still come from the West. Nkrumah has repeatedly insisted that there is plenty of room for private foreign investment. In fact, the success of his seven-year development plan depends on it » [9]. Une situation économique qui ne pouvait que fragiliser le projet panafricaniste de Nkrumah, surtout dans une période se caractérisant en même temps par, entre autres, une marxisation du discours nationaliste, socialiste du CPP, en fait celui de son aile gauche, minoritaire. Ce qui effrayait, néanmoins, les chancelleries des États capitalistes développés, à en croire un article antérieur du même journal états-unien dont l’auteur, à la différence de son confrère (écrivant postérieurement), n’était pas porté à la distinction entre la diffusion de cette rhétorique “révolutionnaire” et le “réalisme” économique du régime : « Diplomats in Accra […] have conclued, almost unanimously, that that country is rapidly becoming an undisguised Marxist state. They hold that the Government of President Kwame Nkrumah is seeking ideological control over the judiciary, education, the civil service, the army, the police. These views are confirmed almost daily by the Government owned press and radio, which have proclaimed “total war” on capitalism and are demanding a nationwide purge of all “antiprogressive” elements […] The most radical change in the Government’s Policy is sudden emphasis on the “class struggle”. Until recently, President Nkrumah maintained that Ghana was seeking to develop “African Socialism” and that, because of the “communal” nature of African society, class frictions were non existent » [10]. Une telle présentation du climat politique rendait, néanmoins, problématique, hypothéquait certaines contributions attendues, des États-Unis par exemple, au financement du plan septennal du régime de Nkrumah (1964-1970). Planification économique qui ne pouvait pourtant être considérée comme incompatible avec le capitalisme en cette période post-Seconde Guerre mondiale, assez marquée par le Plan Marshall, conçu sous la présidence de Harry Truman pour les États d’Europe aux économies détruites par la guerre. Ainsi que par l’influence de l’économiste hétérodoxe britannique John Maynard Keynes, théoricien de l’État acteur économique, du “plein emploi”, caractéristiques, entre autres, de la période qui va être dite du Welfare State, des Trente Glorieuses (grosso modo 1945-1975). Ce plan ghanéen – ni le premier, ni l’unique en cette Afrique post-colonisée ou néocolonisée – avait été, de surcroît, élaboré avec la participation d’économistes libéraux [11].
Ainsi, l’idée propagée d’un Ghana communiste ne correspondait pas aux faits, a réitéré Ikoku qui, à la différence du journaliste du New York Times, ne limite pas la présence “occidentale” au domaine économique, démystifiant davantage aussi bien la propagande des supporters progressistes du régime de Nkrumah que la désinformation menée à l’époque par ses adversaires : « Cette accusation de communisme ne repose sur rien […] Sur le plan économique, en 1962-1963, lors du premier grand assaut de la contre-révolution, moins de 10 % du commerce ghanéen se faisaient avec les pays socialistes. En 1966, sur 200 millions de livres empruntés au dehors, moins de 20 millions provenaient de pays socialistes. À la fin de 1965, moins de 5 % de spécialistes étrangers travaillant au Ghana venaient de pays socialistes. Et s’il est vrai que l’assistance technique pour les services de sécurité provenait de l’U.R.S.S., tout le personnel étranger de l’armée venait d’Angleterre et du Canada. Quant aux investissements privés étrangers, ils étaient tous occidentaux, sauf quelques entreprises libanaises et indiennes. Bref, la campagne contre le prétendu communisme de Nkrumah n’avait d’autre but que de servir de couverture à l’attaque occidentale contre un pays africain dont la volonté d’indépendance dérangeait les intérêts des puissances impérialistes » (p. 195-196). Ce qui peut être considéré comme incohérent, quand abstraction est faite de la politique extérieure des États-Unis face au nationalisme des États dépendants/dominés.
En effet, du renversement en 1909 (après une quinzaine d’années d’allégeance au capital états-unien, n’ayant pas empêché le refus de la concession d’un canal inter-océanique à celui-ci) du président nicaraguayen José Santos Zelaya à l’annulation par le gouvernement des États-Unis d’Amérique du prêt promis au gouvernement égyptien de Gamal Abdel Nasser (l’ayant appris à la radio) pour la construction du barrage d’Assouan – à cause, entre autres, de la manifestation de non alignement ayant consisté à acheter des armes à l’URSS, de la reconnaissance de la République populaire de Chine par l’Égypte, de l’intention exprimée d’obtenir de l’URSS une participation au financement de la construction du barrage d’Assouan… [12] –, en passant par le putsch militaire de juin 1954 au Guatemala contre le Président (colonel) Jacobo Arbenz Guzman (nationaliste social-démocrate/pro-capitaliste ayant entrepris une réforme économique – principalement la réforme agraire, considérée comme une atteinte à la “souveraineté” de l’états-unienne United Fruit Company, créatrice des “républiques bananières” – finalement victime d’un putsch militaire co-organisé par la CIA, après quatre ans de présidence) [13], voire par l’intention d’écarter De Gaulle de la direction de la France post-Libération (ni co-organisatrice, ni participante à la Conférence des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale à Yalta, février 1945), les États-Unis d’Amérique ont montré les limites qu’ils fixaient au nationalisme, à l’indépendance de leurs supposés partenaires. Comme l’a rapporté John P. C. Matthews : « Neutralism in the West sphere of influence (i.e. the free world), he [John Foster Dulles, le Secrétaire d’État du président Dwight David Eisenhower] told an audience in Iowa on June 9th, “is an immoral and shortsighted conception » [14].
Nkrumah qui en appelait aux capitaux occidentaux et voulait avoir un État entrepreneur économique, banal en plein keynésianisme dans les sociétés capitalistes développées, n’était pas communiste sans être anti-communiste [15]. Cependant, n’était-ce pas une « conception sans perspicacité et immorale » de sa part de s’ingérer dans la guerre du Vietnam, non pas en s’alignant derrière les États-Unis pour l’écrasement du Front National de Libération vietnamien (dirigé par Ho Chi Minh) menaçant les intérêts des États-Unis (obsédés par la théorie des dominos [16]) dans cette sous-région asiatique, mais, en voulant, au nom du non alignement, jouer les médiateurs, en commençant par consulter la Chine, tout en propageant la critique du néocolonialisme (qu’illustrait le régime du Sud Vietnam, gouverné par Ngo Dinh Diem, contrôlé par les États-Unis) ? Un crime de lèse-majesté impérialiste, un mauvais exemple, malgré le fait d’avoir caressé publiquement les États-Unis dans le sens du poil, à un mois de son renversement (accompli par des hiérarques militaires ghanéens pendant le voyage de Nkrumah en Chine, pour ladite médiation) : « The United States is a capitalist country. In fact, it is the leading capitalist power in the world today. Like Britain in the heyday of its imperial power, the United States is, and rightly so, adopting a conception of dual mandate in its relations with the developing world. This dual mandate, if properly applied, could enable the United States to increase its own prosperity and at the same time assist in increasing the prosperity of the developing countries » [17]. La prospérité de toutes les classes sociales de ces pays, voire déjà de celles de toutes les classes sociales états-uniennes ? Ou celle de la classe dirigeante, accompagnée d’une classe dite moyenne, chargées de reproduire la dépendance ? Une posture apologétique des États-Unis qui semble très surprenante de la part de l’auteur de Le néo-colonialisme, dernier stade de l’impérialisme. Car cette opinion, apparemment motivée diplomatiquement, tranche avec la démonstration du livre, d’une rigueur déterminée par un idéal paraissant avoir gagné en précision à partir du mitan de années 1960 et qui hantait le département d’État états-unien, affirmant entre autres qu’« Au premier rang des néo-colonialistes, on trouve les États-Unis, qui ont longtemps dominé l’Amérique latine. Ils se sont tournés vers l’Europe, maladroitement d’abord, puis avec plus de sûreté après la Deuxième Guerre mondiale, quand la plupart des pays de ce continent étaient endettés à leur égard. Depuis lors, avec méthode et minutie, le Pentagone s’est mis en devoir de consolider leur emprise, dont on peut constater les effets dans le monde entier » (Chapitre 18 : Les mécanismes du néocolonialisme [18]. Comme un brouillage, une ambiguïté – l’hétérogénéité idéologique de son entourage a été évoqué plus haut –, ayant, en fin de compte, caractérisé le discours et la pratique de Nkrumah président, avec laquelle il ne rompra effectivement (au niveau du discours) que pendant son exil.
African personality et lutte des classes
En effet, alors que son ex-principal conseiller économique, W. A. Lewis – ayant néanmoins contribué à l’élaboration du plan septennal de l’État ghanéen (1964-1970), comme il a déjà été indiqué –, affirmait, à juste titre, en 1965, à partir de la diversité des sociétés africaines, de la réalité des nouveaux États africains co-existant dans l’Organisation de l’Unité Africaine créée depuis deux ans (1963), que « L’idée que de cette diversité sortira quelque chose qui sera universellement ou uniquement africain semble d’une grande invraisemblance – qu’il s’agisse de la “négritude”, de la “personnalité africaine”, ou de quelque système intrinsèquement africain. La seule méthode de pensée féconde, quand il s’agit du peuple africain consiste à le considérer, d’une part, comme aussi divers que le reste de l’humanité, et d’autre part, comme exactement semblable au reste de l’humanité, en ce qu’il obéit aux mêmes motivations fondamentales et qu’il est susceptible de réagir à peu près de la même façon que les autres peuples » (Lewis, p. 40), Nkrumah était, de son côté, resté attaché encore quelques années à l’African personality. Car, cette croyance sert encore de principe organisateur à l’édition, revue et corrigée en 1969 (pendant son exil guinéen) de Le Consciencisme, en dépit de certaines modifications faites (recensées par le philosophe béninois Paulin J. Hountondji [19]). Pourtant, lors de sa communication à un séminaire cairote, intitulée « African Socialism revisited » (1967), soit deux ans avant cette nouvelle édition de Le Consciencisme, il avait exprimé une remise en cause de la vision idyllique de l’Afrique précoloniale sur laquelle était fondée l’idée du communalisme africain : « All available evidence from the history of Africa up to the eve of the European colonisation, shows that African society was neither classless nor devoid of a social hierarchy. Feudalism existed in some parts of Africa before colonisation ; and feudalism involves a deep and exploitative social stratification, funded on the ownership of land. It must also be noted that slavery existed in Africa before European colonisation, although the earlier European contact gave slavery in Africa some of its most vicious characteristics » [20].
Malgré la non ambiguïté du propos, un partisan de l’afrocentricité a cité cette communication de Nkrumah en faisant de lui un défenseur persistant de ce qu’il avait entrepris de critiquer, en se référant même à ce passage de la communication : « Today ‘African Socialism’ seems to espouse the view that the traditional society was a classless society imbued with the spirit of humanism and to express a nostalgia for that spirit. Such a conception of socialism makes a fetish of the communal African society » [21]. Il semble ne l’avoir pas compris, car en guise de commentaire – comme pour celles et ceux qui n’auraient pas compris le propos de Nkrumah – il affirme : « The central theme in African socialism is communalism. African communalism maintains that the central values of Africans in traditional societies were communal rather than individualistic. Individualism belongs to the West while communalism belongs to Africa ». La critique du fétichisme du communalisme est transformée, par l’afrocentriste, en apologie du supposé communalisme. Il en est autant chez son collègue Kwame Botwe-Asamoah quand dans sa présentation des « trois aspects de la pensée philosophico-politique de Nkrumah » [22], il affirme que « First, his socio-political philosophy returns to traditional African ethics, humanistic values and egalitarian mode of production to formulate a new socio-economic system for post-independence Africa ». Ce qui est bien logique, vu qu’il n’y a aucune référence à « African Socialism revisited » et que La lutte des classes en Afrique y apparaît comme une référence très mineure, non sans amalgame, y compris comparativement à des textes antérieurs à et contemporains de la première édition de Le Consciencisme.
Certes, il est possible d’arguer que même dans La lutte des classes en Afrique (1970 ; 1972 pour la traduction française), cette croyance en l’African personality n’a pas tout à fait disparu, car en parlant de l’« idéologie de la Révolution africaine », à la fin du chapitre 6 (« Intelligentsia et intellectuels »), il précise qu’« Unique en son genre, elle s’est développée dans le cadre de la Révolution africaine. Elle est, enfin, le produit de la Personnalité africaine, autant que des principes du socialisme scientifique » (p. 48). Auparavant, dans le chapitre 3 (« Caractéristiques et idéologies des classes », il a reproché à la négritude de donner « une description erronée de la personnalité africaine » (p. 29). Autrement dit, la sienne propre ne renvoyait pas à une fiction, n’était pas erronée. Mais ce sont les rares occurrences de « personnalité africaine » dans La lutte des classes en Afrique. African personality qui, rappelons-le, avait une connotation indéniablement racialiste chez E. W. Blyden, hostile au métissage “racial”, malgré la sympathie qu’il a exprimée pour l’Islam (d’origine arabe). Cette connotation, héritée de la grammaire coloniale, n’a pas absolument disparu chez Nkrumah, car dans la « Conclusion », resurgit la confusion entre panafricanisme et pannégrisme, un effacement de la pluralité “raciale” de l’Afrique : « C’est autour de la lutte des peuples africains pour la libération et l’unité du Continent qu’une authentique culture négro-africaine prendra sa forme. L’Afrique est un Continent, un Peuple, une Nation » (p. 107) [23]. Une « authentique culture négro-africaine », à côté, par exemple, d’une authentique culture kabyle (il n’y a, selon les historien·ne·s, de peuple kabyle, depuis des millénaires, qu’en Kabylie, en Algérie, en Afrique), d’une culture afrikaner (produite depuis le XVIIe siècle par les Boers – paysan·ne·s originaires de Hollande – en Afrique du Sud) ?
C’est dans cet ouvrage, publié quelques mois après la dernière édition de Le Consciencisme que sont critiquées, faisant suite à « African Socialism revisited », les « conclusions erronées, postulant que l’Afrique constituait une entité distincte à laquelle ne s’appliquaient pas les critères économiques et valables pour le reste du monde », la propagation « des mythes tels que ceux du “Socialisme africain” et du “socialisme pragmatique” » [24]. Il y est plus qu’esquissé une pratique de la sociologie « qui, plus que toute autre discipline, apporte les fondements les plus solides pour une politique sociale » (Discours aux africanistes, 1962, op. cit.), d’une sociologie critique, présentant une typologie des classes sociales en Afrique, leur origine, leurs caractéristiques et idéologies, y compris le rapport de la classe à la race, dans une Afrique qu’il considère alors comme « le théâtre d’une violente lutte des classes » (p. 10) – lutte des classes que le Premier ministre Nkrumah avait considéré comme « passé de mode » en période post-coloniale. Ce qui pouvait aboutir à la révolution socialiste africaine, moment de la révolution socialiste mondiale (dernier chapitre et Conclusion). La répercussion sur son panafricanisme était assez évident : l’OUA dont il avait été l’un des artisans est alors considérée comme sérieusement plombée par la nature des États qui la composent, étant soumis, quasiment tous, aux puissances impérialistes. Cette critique – autocritique implicite – du « mythe » du “socialisme africain” a été aussi omise, récemment, par Blondin Cissé qui pourtant indique La lutte des classes en Afrique dans la bibliographie de son texte (« La problématique de la Renaissance africaine dans le Consciencisme de Nkrumah : pour une relecture du socialisme africain » [25]), mais sans qu’il y en ait une quelconque trace dans l’article. Il est vrai que parler de la lutte des classes n’est pas actuellement à la mode ou gratifiant, dans l’intelligentsia africaine peut-être pire qu’ailleurs.
Par ailleurs, ce qui n’est pas aussi souvent relevé, même le Tiers-Monde, considéré comme une troisième voie, un non-alignement, un neutralisme entre le capitalisme et le socialisme, n’est désormais, pour Nkrumah, qu’un mythe, comme une posture d’évitement de la réalité bipolaire d’alors par les États qui s’en revendiquent encore « a form of political escapism – a reluctance to face the stark realities of the present situation. The oppressed and exploited peoples are the struggling revolutionary masses committed to the socialist world. Some of them are not yet politically aware. Others are very much aware, and are already engaged in the armed liberation struggle. At whatever stage they have reached in their resistance to exploitation and oppression, they belong to the permanent socialist révolution. They do not constitute a ‘Third World’. They are part of the revolutionary upsurge which is everywhere challenging the capitalist, imperialist and neo-colonialist power structure of reaction and counter-revolution. There are thus two worlds only, the revolutionary and the counter-revolutionary world » [26]. Une critique du Tiers-Monde différente de celle faite, par la suite, par exemple, par Hannah Arendt. Selon celle-ci le Tiers-Monde est « une idéologie, une illusion » – dans l’acception péjorative d’idéologie, évidemment –, qui n’avait d’intérêt en fait que pour « des peuples qui se trouvent situés au plus bas niveau – c’est-à-dire les Noirs africains » [27] – un mépris racialiste non surprenant de la part de celle qui était, par exemple, partisane du maintien de la ségrégation raciale scolaire aux États-Unis d’Amérique [28].
Mais Nkrumah, qui s’était accepté au pouvoir comme Osagyefo (rédempteur), omettait de mentionner que cette connaissance erronée des réalités africaines en général, de la réalité ghanéenne en particulier, avait guidé sa politique à la tête de la République du Ghana. Qu’il avait ainsi contribué – à son insu ? – à contrecarrer la révolution africaine en mettant sous le boisseau le principe donc la pratique de la lutte des classes – comme l’ont rappelé différemment Samuel Ikoku, Frederick Cooper, cités plus haut – sous prétexte d’unité nationale (post-coloniale) supposée anti-impérialiste incarnée par le CPP. Au nom de ce qui passait alors pour un « retour aux sources africaines » – justifiant, au passage, entre autres, l’instauration du monopartisme comme dans les autres post-colonies africaines, avérées néocoloniales. En revanche, son ami Cabral – ayant profité de son métier d’agronome, ainsi que de l’implantation rurale de la lutte armée, pour enrichir sa connaissance des sociétés du Cap-Vert et de Guinée-Bissau (voire d’Angola [29]) –, à titre de rappel, considérait par contre ledit « retour aux sources africaines » comme pouvant être une « expression consciente ou inconsciente d’opportunisme politique de la part de la petite-bourgeoisie » [30]. En effet, tout comme L. S. Senghor, chantre du « socialisme africain – enfant légitime des compromissions néocoloniales » [31], ne pouvait parler d’exploitation des paysan·ne·s talibés de la confrérie mouride (productrice d’arachide pour les huileries coloniales, continuée sous le néocolonialisme) par les dignitaires de celle-ci [32], Nkrumah président paraissait même conciliateur concernant les relations, évidemment inégalitaires, entre les autorités dites traditionnelles – partisanes, contre l’unitarisme de Nkrumah, d’un Ghana fédéral, où les États fédérés devraient leur servir de fiefs – et leurs sujet·te·s, par ailleurs citoyen·ne·s de la République du Ghana. Une telle attitude de Nkrumah président pouvait alors être considérée comme une mise à jour post-coloniale/néocoloniale de la superposition de très détestables abus précoloniaux et coloniaux, évoquée par Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme (après avoir affirmé, de façon plutôt provocatrice : « je fais l’apologie systématique des civilisations para-européennes », p. 21).
Du panafricanisme comme culturalisme petit-bourgeois
C’est l’impact d’une telle attitude théorique sur la pratique de la « révolution africaine » qu’a relevé, dans un passage de son hommage funèbre (largement conventionnel) à Nkrumah, Cabral (qui, à titre de rappel, fixait comme but à la révolution africaine, voie de l’émancipation, l’abolition de « toutes les formes d’oppression », de « l’exploitation du travail par qui que ce soit » [33]) : « Oui, l’impérialisme est criminel et sans scrupules, mais nous ne devons pas tout mettre sur son large dos. […] Jusqu’à quel point donc le succès de la trahison au Ghana aurait-il été lié ou non à des problèmes de la lutte des classes, des contradictions de la structure sociale, du rôle du Parti et d’autres institutions, y compris les forces armées, dans le cadre d’un nouvel État indépendant ? Jusqu’à quel point, nous demandons-nous, le succès de la trahison ne serait-il pas lié au problème de la définition correcte de cette entité historique et artisane de l’histoire qu’est le peuple, et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l’indépendance ? » [34]. Ces propos étaient en fait adressés, assez évidemment, non plus à Nkrumah, mais à celles/ceux – majoritaires ? [35]– qui, alors, se passaient toujours d’une « analyse lucide » des sociétés africaines tout en prétendant lutter pour l’émancipation de l’Afrique.
Ces propos peuvent aussi être adressés, mutatis mutandis, aux tenant·e·s actuel·le·s d’un panafricanisme dominant et demeurant simpliste dans la critique du néocolonialisme – La lutte des classes en Afrique ayant effectué à propos une avancée par rapport à Le néocolonialisme, dernier stade de l’impérialisme, en y incluant – en termes de « collaborateurs », certes – les acteurs africains. Ils peuvent enfin être adressés à celles et ceux qui paraissent aveugles (volontairement ?) au contexte actuel d’une lutte de classe menée non seulement par l’impérialisme, les institutions financières internationales, mais aussi par les capitalistes africain·e·s [36] dans le cadre d’États africains davantage insérés dans le capitalisme, voire dirigés, ici et là, par des capitalistes avérés. Cet ensemble constitue ainsi le bloc capitaliste post-colonial/néocolonial, très conscient de ses intérêts déterminants, communs (en dépit de son caractère hiérarchisé et d’inévitables divergences internes, fractionnelles aux déterminations diverses). Ce bloc capitaliste néocolonial (sans frontières) mène une lutte contre les classes sociales et milieux sociaux populaires en général (petite paysannerie agricole, prolétariat et assimilés, sous-prolétariat, etc.), avec un impact particulier sur les femmes de ces classes populaires, sur lesquelles reposent aussi, évidemment, les tâches essentielles de reproduction. Il s’agit d’une lutte pour l’accumulation du capital expliquant aussi, surtout en cette période où prévaut l’idéologie de la « fin des idéologies », l’instrumentalisation des identités ethniques/régionales/nationales et confessionnelles par des fractions politiciennes des classes dirigeantes dans certaines sociétés africaines.
Mais, apparemment, à en croire l’attitude de certain·e·s nationalistes africain·e·s, négro-africain·e·s surtout, il ne faudrait pas tenir compte de la participation africaine à ce bloc capitaliste post-colonial (néolibéral) et au capital international. Ainsi, les “AfroChampions”, des capitalistes africain·e·s investissant au-delà du cadre national, et les “African Globalizers”, qui investissent aussi hors d’Afrique, devraient être regardés avec fierté. Au nom de l’appartenance commune à l’Afrique, et pour leurs supporteurs/supportrices négro-africain·e·s, au nom de l’identité raciale commune. L’Afrique étant souvent exposée à ce réductionnisme mélanique. Pourtant, l’ampleur du capital accumulé, voire la célérité de cette accumulation, exprime au moins qu’elles/ils ne sont pas moins exploiteurs/exploiteuses que « les riches richissimes » d’ailleurs, avec lesquel·le·s elles/ils partagent désormais « les pages porno-financières des magazines Forbes et Fortune » [37]. La situation est devenue bien pire que celle constatée, avec un accent assez fanonien, par le Nkrumah de La lutte des classes en Afrique : « En Afrique, l’ennemi interne, qui est la bourgeoisie réactionnaire, doit être démasqué : il s’agit d’une classe d’exploiteurs, de parasites et de collaborateurs des impérialistes et néo-colonialistes, desquels dépend le maintien de leurs positions puissantes et privilégiées. La bourgeoisie africaine est essentielle à la continuité de la domination et de l’exploitation impérialistes et néo-colonialistes » (p. 104).
Ainsi, ce panafricanisme demeure encore prisonnier de sa nature de classe originelle, petite-bourgeoise, marqué par le clivage racial américain (hérité de l’esclavage) et colonial (en Afrique dite noire), ne s’intéressant pas à la sociologie actuelle des sociétés africaines, aux luttes de classe qui s’y déroulent néanmoins, très souvent en faveur de la classe exploiteuse (toutes races confondues). Ce panafricanisme post-colonial s’est ainsi placé dans le sillage d’un Hailé Selassié, définissant ainsi, dans son célèbre discours à la tribune des Nations unies en octobre 1963 (postérieur à la naissance, sous son égide, de l’OUA), sa lutte contre l’exploitation : « Pour ce qui est de l’égalité entre les hommes, là aussi il y a un défi et une opportunité à saisir ; le défi est d’insuffler une vie nouvelle aux idéaux déjà inscrits dans la Charte, l’opportunité est de rapprocher les hommes de la liberté et de la vraie égalité […] l’égalité entre les hommes que nous visons est à l’opposé de l’exploitation d’un peuple par un autre, dont les pages de l’histoire, et en particulier celles écrites sur les continents d’Afrique et d’Asie, nous parlent si abondamment. L’exploitation ainsi considérée présente plusieurs aspects, mais quelle que soit la forme qu’il prenne, ce fléau doit être évité là où il n’existe pas et éradiqué là où il existe ». On voit bien là une conception limitée de l’égalité, entre “peuples” et non pas entre concitoyen·ne·s [38], assez logique pour un “Roi des rois”, ne pouvant concevoir une égalité avec ses sujets (même quand elle est dite parlementaire, la monarchie a pour principe la situation, considérée comme naturelle, de la famille impériale/royale/princière au dessus de l’égalité entre citoyen·ne·s/sujet·te·s, comme dans La ferme des animaux de George Orwell) en bénéficiaire qu’il était de la soumission des rapports sociaux féodaux au capitalisme. Ainsi la revendication de l’égalité multidimensionnelle – l’inégalité sociale étant consubstantielle au capitalisme (la racisation étant une construction sociale) – dans les sociétés africaines n’est pas courante chez ces panafricanistes, plutôt proches, en effet, d’un Hailé Selassié que d’un Walter Rodney qui incluait la lutte des classes dans le combat panafricaniste post-colonial [39].
Aujourd’hui, bien moins encore que dans les années 1960-1970, ne se profile pas vraiment à l’horizon la désertion massive – « suicide » disait Cabral [40] – politique de leur classe sociale par des membres de la petite bourgeoisie, pour se mettre du côté des classes exploitées africaines, des catégories sociales opprimé·e·s d’Afrique. Pourtant il ne pourra être question d’émancipation effective de l’Afrique que suite à une victoire sur l’exploitation, les oppressions, les injustices/inégalités qui concernent la très grande majorité des Africain·e·s.
Ce panafricanisme dominant – surtout dans son expression à partir des métropoles impérialistes où généralement persiste le racisme [41], demeure attrayant le postmodernisme – s’accroche principalement au discours identitaire “racial” diversement décliné (essentialisme, culturalisme, une certaine décolonialité, etc.), n’articulant pas, sinon mal, cette identité raciale (noire, principalement) – érigée en Identité – opprimée, avec les autres formes d’identité (de sexe/genre, de classe, etc.) opprimées et exploitées. D’une part, on établit couramment la confusion entre panafricanisme et pan-négrisme – quand on parle de “diaspora africaine” ou de “personnes d’ascendance africaine”, il faut entendre “diaspora noire”, “personnes d’ascendance négro-africaine” [42] – et ainsi les Africain·e·s non noir·e·s, de l’Afrique septentrionale à l’Afrique australe (où persiste dans certaines sociétés un racisme anti-Noir·e·s), en passant par l’Afrique occidentale (où persiste aussi dans quelques sociétés une discrimination ethnique à l’égard des populations touaregs et arabes), ne feraient pas partie des Africain·e·s. Ce qui est une régression par rapport à Nkrumah dénonçant que l’ « On cherche à diviser l’Afrique en deux zones fictives, au nord et au sud du Sahara, en insistant sur les différences de race, de religion et de culture » (L’Afrique doit s’unir). D’autre part, on postule l’existence d’une solidarité, le partage des mêmes valeurs par les Négro-Africain·e·s – voire par les Noir·e·s, quel que soit leur pays ou continent, du fait de leur appartenance au « monde noir », de leur supposée négritude substantielle. Par exemple, le Rapport alternatif sur l’Afrique (RASA) en posant la question (c’est en fait un principe dudit rapport) « L’Afrique et les Africains ne doivent-ils pas construire leurs propres instruments de mesure de leurs progrès et de leurs défis à partir des valeurs et réalités qui leur sont propres ? » prouve la persistance de l’influence de la « bibliothèque coloniale » : quelles peuvent bien être ces valeurs que partageraient toute l’Afrique dite noire, les Négro-Africain·e·s d’hier, comme d’aujourd’hui, sans distinction des appartenances de classe sociale, de genre, etc. ? Évidemment, lesdites valeurs sont prétendues propres à l’Afrique, comme il a été dit plus haut, sans quelque comparaison historique, symétrique, avec ce dont elles sont censées être distinguées, une tradition héritée de l’ethnologie coloniale/occidentale. Bien qu’on y retrouve la référence à Fanon et Cabral concernant « l’absence d’idéologie », « la carence idéologique » (p. 82), la mention de « classes dirigeantes locales désireuses [seulement ?] de participer à l’exploitation de leur peuple » (p. 84), ce texte à plusieurs mains, idéologiquement éclectique, est néanmoins à dominante différentialiste/culturaliste et non assumée comme étant à dominante pro-capitaliste (même si y ont contribué quelques uns des rares intellectuel·le·s anticapitalistes africain·e·s). Ceci n’est possible qu’en ne s’intéressant nullement à la sociologie, à la vie concrète de ces sociétés. On reproduit ainsi le mépris pour l’histoire n’ayant cessé de montrer que cette commune appartenance n’avait pas, par exemple, empêché des actes de chauvinisme national massif, voire officiel, entre négro-africains, d’Abidjan (vers la fin de la période coloniale) à Durban (la négro-afrophobie post-apartheid : le si chauvin prince Mangosuthu Gatsa Buthelezi a été de façon continue ministre de l’Intérieur sous la présidence de Nelson Mandela, puis de Thabo Mbeki), en passant par Brazzaville (l’expulsion massive, il y a quelques années, des Congolais·e·s de l’autre rive fluviale). Cette croyance ou fantasme sur la solidarité négro-africaine – voire du « monde noir » – exprime en effet un aveuglement fréquent face aux faits historiques. Ou une certaine surdité à l’égard, par exemple, de la précision apportée, au début des années 1970, par l’un des initiateurs/initiatrices du mouvement de la négritude, Aimé Césaire, s’étant affirmé « contre une idéologie fondée sur la négritude […] quand une théorie, disons littéraire, se met au service d’une politique, je crois qu’elle devient infiniment détestable […] parce que je crois effectivement qu’il y a la lutte des classes, par exemple […] Je refuse absolument une espèce de pannégrisme idyllique à force de confusionnisme […] la négritude je ne la rejette pas, mais je la regarde avec un œil extrêmement critique […] En plus, ma conception de la négritude n’est pas biologique, elle est culturelle et historique. Je crois qu’il y a toujours un certain danger à fonder quelque chose sur le sang que l’on porte, les trois gouttes de sang noir […] Si on fait ça, on tombe dans un gobinisme renversé. Et ça me paraît grave » [43].
En fin de compte, il y a une sorte d’européocentrisme/occidentalocentrisme dans ce panafricanisme pannégriste, car il semble encore très préoccupé à affirmer une « fierté africaine » [44] (entendre “fierté noire”) face au narcissisme de l’“Européen blanc” (avec son extension américaine), placé de ce fait comme central, duquel on semble attendre une reconnaissance, pourtant si évidente, d’humanité entière. Une prolongation ainsi de ce que Fanon, parlant de la Société africaine de culture (initiée par Alioune Diop, le fondateur de la revue Présence Africaine et de la maison d’édition éponyme, principale organisatrice des Congrès des écrivains et artistes noirs, Paris 1956 et Rome 1959) considérait comme des « manifestations exhibitionnistes : montrer aux Européens qu’il existe une culture africaine, s’opposer aux Européens ostentatoires et narcissistes, tel sera le comportement habituel des membres de cette Société ». Contre ce narcissisme des dominant·e·s jouissant pathologiquement de leur blanchité, se dresse un narcissisme réactif des dominé·e·s qui se manifeste de nos jours postmodernistes de façon amplifiée, du fait aussi de l’importance des images, du numérique qui accroît celle-ci. Fanon parlait d’un « cul-de-sac », pouvant certes, pour quelques tenant·e·s actuel·le·s de ladite fierté, être rentable en espèces sonnantes et trébuchantes, en carrière sur le marché spectaculaire académico-médiatique des identités (l’identité de classe exploitée en étant exclue) – dont le centre demeure l’Europe et les États-Unis d’Amérique –, en présence régulière garantie dans les villes dudit centre, leurs lieux de pouvoir intellectuel, source de prestige (occidentalocentré). Mais sans toutefois avoir des effets perceptibles concernant ou vraiment contribuer à la lutte pour l’émancipation des peuples africains.
Notes
[1] Y. Bénot, op. cit., note infrapaginale 22, p. 200.
[2] C. L. R. James, Nkrumah and the Ghana Revolution, London, Allison & Busby, 1977, p. 172 (à propos de cette conférence aux cadres du CPP, C. L. R. James indique dans l’introduction de son livre que « Nkrumah learnt about the speech and its reception, expressed his approval and told me that he would get the text printed. I sent the script to him and it was never acknowledged, far less printed » (p. 10). Autrement dit, il s’agit d’une promesse non tenue ressemblant à la censure d’un texte contenant des passages critiques à l’égard du gouvernement. Au tout début de la « révolution dahoméenne », le philosophe béninois Paulin J Hountondji, affirmait concernant le CPP, dans l’espoir que quelque leçon en soit tirée : « Nkrumah a échoué parce que son Parti, le “Convention People’s Party” n’était plus en 1966 cette puissante organisation de masse qu’il avait été de 1949 à 1957, année de l’indépendance, mais était devenu un champ d’intrigues et de luttes d’influences, entre adulateurs et corrompus d’un Chef coupé du peuple […] L’échec de Nkrumah mérite d’être médité », Libertés, Cotonou, Editions Renaissance, 1973, p. 58.
[3] Par ailleurs, concernant ce plan de développement, censé mener au socialisme, selon Ikoku, Ama Biney rappelle que « world class economists such as Dudley Seers, Arthur Lewis, Nicholas Caldor [Kaldor], Albert Hirschmann, Joseph Bognar, and Tony Killick contibuted before its official launch in 1964 », Ama Biney, op. cit., p. 109.
[4] Selon Samuel Ikoku, protagoniste de la guerre gauche-droite autour de Nkrumah, l’aile droite contrôlant le parlement mais inquiète de la critique du néocolonialisme que développait désormais Nkrumah, considérée comme une menace pour leurs intérêts, réagissait, par exemple, en rappelant, par tract, que « le socialisme africain […] n’est pas athée et ne repose pas sur la lutte des classes. Ils prétendaient que Nkrumah était tombé sous l’influence de gens qui étaient des agents de Moscou […] D’autres tracts exigeaient de lui qu’il renvoie ces hommes sous peine d’être accusé d’avoir trahi son premier idéal de socialisme africain », S. G. Ikoku, op. cit., p. 215-216.
[5] Amilcar Cabral, « Le rôle de la culture dans la lutte pour l’indépendance » (1972), in Unité et Lutte, p. 179.
[6] Mehdi Ben Barka, « La révolution nationale en Afrique et en Asie » (1963), in Mehdi Ben Barka (recueil de textes), Genève, CETIM, 2013, p. 62.
[7] À titre de rappel, le Ghana de Nkrumah n’est pas le premier État indépendant d’Afrique, car bien avant lui, étaient indépendants, par ordre chronologique : l’Ethiopie (n’ayant pas été strictement une colonie, malgré l’invasion par l’Italie fasciste), le Libéria (1847), l’Égypte (1922), la Libye (1951), le Maroc (1956), le Soudan (1956), la Tunisie (1956).
[8] Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Paris, Gallimard, 2002, p. 603 et 606. De Gaulle se réfère à l’emprise états-unienne subséquente à l’European Recovery Program ou Plan Marshall (1948-1952), une aide subordonnante aux États d’Europe occidentale, qui s’étendait aux colonies. Dans le cas français : « L’Outre-mer français a bénéficié sur les crédits Marshall ordinaires de $287 millions environ, soit 11 % de l’aide totale à la France et à ses territoires dépendants […] On remarque que dans le partage entre pays d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire, l’Afrique du Nord l’emporte largement […] La gestion de l’aide Marshall dans les TOM a entrainé des incidents finalement plus nombreux qu’en France. Les heurts entre le néo-impérialisme libéral américain et le narcissisme paternaliste français étaient inévitables », selon Gérard Bossuat (« La contre-valeur de l’aide américaine à la France et à ses territoires d’Outre-Mer », in Colloque tenu à Bercy les 21, 22 et 23 mars 1991 sous la direction de Réné Girault et Maurice Lévy-Leboyer, Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Ministère des Finances, 1993, (p. 177-199), p. 195 et 196 pour la citation). Par anti-impérialisme, en 1966-1967, De Gaulle, en retirant la France de l’OTAN, a mis fin à la présence sur le sol français des bases (30) de l’armée des États-Unis d’Amérique, installées en France à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais tout en maintenant au même moment les bases militaires françaises dans presque toutes ses anciennes colonies. Autrement dit, un anti-impérialiste néocolonialiste/impérialiste.
[9] « Portait of Nkrumah as Dictator », New York Times, May 3, 1964, https://www.nytimes.com/1964/05/03/archives/portrait-of-nkrumah-as-dictator.html. À propos de cette domination du capital occidental, cf. aussi, par exemple, l’historien africaniste Robert Cornevin (dans un article publié quelques jours après le putsch militaire) « Le coup d’État militaire d’Accra ne doit pas nous faire oublier les réalisations dues au socialisme ghanéen », Le Monde diplomatique, mars 1966, p. 1 et 3. Dans son article cité plus haut – une recension de l’ouvrage de l’un des économistes cités plus haut (Tony Killick, Development economics in action : a study of economic Policy in Ghana, second edition, London and New York, Routledge, 2010) ayant contribué à la préparation du plan septennal de l’État ghanéen –, Jasper Ayelazuno (Abembia) affirme, concernant le supposé socialisme de l’économie ghanéenne sous Nkrumah, que « This is a serious theoretical oversight since Killick admits that, for all his socialist and [anti]neocolonialism rhetoric, Nkrumah did not nationalise private enterprises. Rather, he tried to woo foreign direct investments and even transacted business with private capital. Killick also notes that the liberal governments of Ghana (i.e., the NLC, the Busia-led government and the Kuffuor-led government) also continued with some of Nkrumah’s state-interventionist policies », p. 390.
[11] Dans le Tanganyika nouvellement indépendant, le Premier ministre “socialiste africain” Julius Nyerere, a nommé au ministère des Finances, un colonial conservateur de droite, ayant auparavant servi comme ministre au Kenya (colonial) et qui intégrera par la suite la Banque mondiale, Sir Ernest Vase. Celui-ci a été, en cela, considéré comme le cerveau du Plan Triennal de Développement (1961-1964). Son influence dans l’organisation du gouvernement tanganyikais est alors, néanmoins, considérée comme incongrue par Nkrumah. Le ministre de la Santé et du Travail du Tanganyika était aussi un Britannique, D. N. M. Bryceson. Le deuxième plan, le Plan Quinquennal (1964-1969), a été élaboré par « une équipe de six “experts” étrangers sous la direction de M. J. Faudon », Michael Jennings, « ‘We Must Run While Others Walk’ : popular participation and development crisis in Tanzania, 1961-9 », Journal of Modern African Studies, 41, 2, 2003, (p. 163–187), p, 165, DOI : 10.1017/S0022278X0300421X.
[12] « Le Congrès américain qui représente les États américains avait demandé que soit coupée toute aide à l’Égypte, car nous avons refusé d’accepter l’occupation et l’exploitation de notre territoire. Ce fut notre punition », Discours de Gamal Abdel Nasser [annonçant la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez] (Alexandrie, 26 juillet 1956), Notes et études documentaires : Écrits et Discours du colonel Nasser, Paris, La Documentation française. 20.08.1956, n° 2.206 ; http://www.cvce.eu/obj/Discours_de_Gamal_Abdel_Nasser_Alexandrie_26_juillet_1956-fr-d0ecf835-9f40-4c43- a2ed-94c186061d2a.html.
[13] Dans son discours d’investiture à la présidence du Guatemala (1951), Arbenz s’était clairement posé en partisan du capitalisme en affirmant comme l’un des trois objectifs fondamentaux de son gouvernement « a convertir a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista […] nuestra política tendra que estar basada necesariamente en el impulso a la iniciativa privada, en el desarollo del capital guatemalteco en cuyas manos deberián encontrarse las actividades fundamentales de la economía nacional, y en cuanto al capital extranjero debemos repetir que sera bienvenido siempre que se ajuste à las distintas condiciones que se van creando en la medida que nos desarrollamos, que se subordine siempre a las leyes guatelmaltecas, coopere al desenvolvimiento économico del país y se abstenga estrictamente de intervenir en la vida politica y social de la Nación », « Discurso de Jacobo Arbenz Guzman, el 15 de marzo de 1951 », Comunidades de Población en Resistencia, https://web.archive.org/web/20141222002546/http://cpr-urbana.blogspot.com72013/08/discurso-de-jacobo-arbenz-guzman-el-15.html. (ma traduction : « transformer le Guatemala d’un pays arriéré et d’économie à prédominance féodale en un pays moderne et capitaliste […] notre politique sera nécessairement basée sur la stimulation de l’initiative privée, le développement d’un capital guatémaltèque dans les mains duquel devront se trouver les secteurs fondamentaux de l’économie nationale, et quant au capital étranger nous répétons qu’il sera toujours le bienvenu, s’ajustant aux conditions distinctes qui seront créées au cours de notre développement, en respectant toujours les lois du Guatemala, coopérant au développement du pays et s’abstenant strictement de s’ingérer dans la vie politique et sociale de la Nation [guatémaltèque] »).
[15] Dans le sixième paragraphe de l’Introduction de Le néo-colonialisme, dernier stade de l’impérialisme, Nkrumah précise que « La lutte contre le néocolonialisme n’a pas pour but d’interdire le placement des capitaux des pays développés dans les pays qui le sont moins, mais d’empêcher l’utilisation de la puissance financière des nations industrielles à l’appauvrissement des nations moins développées ». Comme l’avait dit quelques années auparavant le président nationaliste bourgeois guatémaltèque J. Arbenz.
[16] Pour les stratèges états-uniens la perte d’un pays dans cette sous-région asiatique pouvait entrainer un autre, puis un autre, etc., par répercussion – comme semblait l’illustrer alors la menace de perdre le Vietnam, après avoir perdu la Chine. C’est ce qu’il fallait endiguer au Vietnam.
[18] Dans L’Afrique doit s’unir (1963), il concluait ainsi son commentaire d’une déclaration de l’économiste du Département d’État, théoricien majeur du développement et stratège impérialiste, Walt Whitman Rostow (auteur de Les étapes de la croissance économique, publié en 1960, un classique de la “science économique” orthodoxe sur le développement, capitaliste s’entend) : « C’est sans doute là l’un des résumés les plus cyniques, mais aussi les plus sincères jamais publiés de la façon dont un pays riche réagit en face des besoins et des espérances des jeunes nations du monde » (p. 213 de la réédition de 1994). Pour l’intérêt porté par l’administration états-unienne au Ghana pendant les deux dernières années de présidence de Nkrumah, au Général Ankrah, avant et après le putsch, on peut consulter le volume des Foreign Relations of the United States (FRUS) consacré au Ghana : FRUS 1964-68, Vol. XXIV : Africa, Ghana (http://www.state.gov/www.about_state/history/vol_xxiv )
[19] Dans son ouvrage classique, Sur la “philosophie africaine” (Paris, Maspero, 1976), Paulin Hountondji, critique de l’ethnophilosophie – terme inspiré du titre de la thèse inachevée de Nkrumah : Mind and Thought in Primitive Society. A Study in Ethno-Philosophy with Special Reference to the Akan Peoples of the Gold Coast, West Africa – a procédé, dans le chapitre 7 (« L’Idée de Philosophie dans le Consciencisme de Nkrumah) à une comparaison de la première édition (1964) et la dernière (1970), concernant le rapport à l’africanisme. Ainsi, conclut-il, par exemple, que « malgré les remaniements importants ainsi opérés, l’édition de 1970 reste largement tributaire des présuppositions idéologiques d’avant 1965. Plutôt que de replâtrer le texte initial, Nkrumah aurait dû, pour être conséquent avec lui-même, renier purement et simplement l’ancien texte et écrire à nouveaux frais un nouveau livre » (p. 179). Cf. aussi, par exemple, Grégoire Mavounia, « Notes sur l’évolution de la pensée de K. Nkrumah (Du “consciencisme” à la “lutte des classes”) » (Revue congolaise de droit, n° 1, janvier-juin 1987, p. 49-65).
[20] K. Nkrumah, « African Socialism revisited » (1967), Paper read at the Africa Seminar held in Cairo at the invitation of the two organs At-Talia and Problems of Peace and Socialism, https://www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/1967/african-socialism-revisited.htm, Adjei-Gyamfi Yaw, « Afrocentricity : An Important Feature of the Pan African Tradition », This is Africa, october 2, 2018 ; https://thisisafrica.me/. Il est clair que l’afrocentriste n’a pas compris qu’il s’agit d’une critique par Nkrumah du fétichisme dudit communalisme africain. Il en est autant de son collègue Kwame Botwe-Asamoah quand il affirme dans la préface de son ouvrage sur Nkrumah (Kwame Nkrumah’s Politico-Cultural Thought and Policies. An African-Centered Paradigm for the Second Phase of the African Revolution, London & New York, Routledge, 2005) que « his socio-political philosophy returns to traditional African ethics, humanistic values and egalitarian mode of production to formulate a new socio-economic system for post-independence Africa ». Cf. aussi les pages 166-168 de la conclusion de l’ouvrage de Botwe-Asamoah qui ne se réfère aucunement à ce qui est postérieur à Le Consciencisme.
[21] Adjei-Gyamfi Yaw, « Afrocentricity : An Important Feature of the Pan African Tradition », This is Africa, october 2, 2018 ; https://thisisafrica.me/.
[22] Kwame Nkrumah’s Politico-Cultural Thought and Policies. An African-Centered Paradigm for the Second Phase of the African Revolution, London & New York, Routledge, 2005, p. x.
[23] Un détail sans doute : l’épouse de Nkrumah était d’origine égyptienne, une Africaine sémite “blanche” ou “brune”.
[24] K. Nkrumah, La lutte des classes en Afrique, Paris, Présence Africaine, 1972 [Londres, Panaf Books Ltd, 1970, traduit de l’anglais par Marie-Aïda Bah Diop], p. 10. Pour les « “socialismes africains”, en plus de l’ouvrage de Yves Bénot déjà cité cf., par exemple, Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine. De Kenyatta à Sankara, Paris, La Découverte, 2014.
[26] K. Nkrumah, « The Myth of the Third World », Labour Monthly, october 1968, p. 462-465 ; http://www.unz.org/Pub/LabourMonthly-1968oct-00462. Idée reprise dans La lutte des classes en Afrique : « Le monde en développement n’est pas un bloc homogène opposé à l’impérialisme. Le concept de “Tiers-Monde est illusoire. Car, pour une large part, il demeure sous domination impérialiste », p. 102.
[27] Hannah Arendt, « Politique et révolution » (1970), in H. Arendt, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Paris, Calmann-Lévy/Presses Pocket “Agora”, 1972 [1969-1972], (p. 209-241), p. 218.
[28] Hannah Arendt, « Réflexions sur Little Rock » (1959), in Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, Paris, Payot, 2005, p. 217-236.
[29] En agronome, Cabral, résidant alors au Portugal avait été en mission plusieurs fois en Angola, entre 1955 et 1958, où il avait, par ailleurs, participé à l’organisation du mouvement angolais de libération nationale.
[30] A. Cabral, Unité et Lutte, op. cit.
[31] Stanislas Adotevi, op. cit., p. 115.
[32] En plus du livre de Jean Copans, Les marabouts de l’arachide. La confrérie mouride et les paysans du Sénégal (Paris, Le Sycomore, 1980), on peut consulter, par exemple, l’article de Mohamed Guèye, « Touba, une zone de non-droit au cœur de la République », Défis Sud, février-mars 2015, p. 17-19) ; et plus portés sur le politique et le religieux : l’ouvrage de Christian Coulon, Le marabout et le prince (Islam et pouvoir au Sénégal), Bordeaux, Institut d’études politiques/Centre d’étude d’Afrique noire, 1981, l’article de Sanou Mbaye, « Les dérives d’un bicéphalisme politico-religieux », Pambazuka, 17 avril 2009, http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/55700), l’entretien vidéo : « Moussa Sène Absa [cinéaste sénégalais] accuse : “les politiciens et les marabouts ont pris ce pays en otage” », entretien vidéo, du 4 février 2020, https://www.leral.net/Moussa-Sene-Absa-accuse-les-politiciens-et-les-marabouts-ont-pris-ce-pays-en-otage_a269736.html (la vidéo est en ligne sur plusieurs sites sénégalais).
[33] Extrait d’un propos de Cabral aux guérilleros, au village de Maké en 1966, rapporté par Gérard Chaliand, Lutte armée en Afrique, Paris, François Maspero, 1967, p. 49.
[34] A. Cabral, « Allocution prononcée à l’occasion de la Journée Kwame Nkrumah » (à l’occasion de ses obsèques), Présence Africaine, numéro d’hommage à Nkrumah, 1972, p. 5-10. Kwame Botwe-Asamoah cite l’hommage de Cabral à Nkrumah en ne mentionnant pas ce passage critique (p. 174).
[35] Sur quoi s’est appuyé le Rapport alternatif sur l’Afrique (RASA). Numéro zéro. Un rapport pour l’Afrique par l’Afrique, Dakar, juin 2018, www.rasa-africa.org) en affirmant que « De 1960 à 1970, les premiers intellectuels étaient à la fois révolutionnaires et panafricanistes » (p. 56) ? Que peut bien signifier « révolutionnaires », surtout quand la phrase suivante dit que « Beaucoup étaient dans l’ombre des premiers dirigeants comme conseillers » ? Des intellectuels « révolutionnaires » ayant servi de conseillers aux dirigeants néocoloniaux qu’étaient presque tous les supposés « pères des indépendances africaines » ?
[36] Cf., par exemple, J. Nanga, « Aperçu sur l’actuelle classe dominante en Afrique », CADTM, 29 janvier 2018, www.cadtm.org/Apercu-sur-actuelle-classe. Pour Jacqueline Mugo (secrétaire générale de Business Africa, une association patronale panafricaine, et directrice de la Fédération des employeurs du Kenya), par exemple, la flexibilité est le présent et l’avenir du marché du travail (J. Mugo, « En Afrique, l’entrepreneuriat est perçu comme l’une des clés de la croissance », Agyp.co, 12 février 2017, https://www.agyp.co/en-afrique-lentrepreneuriat-est-percu-comme-lune-des-cles-de-la-croissance/), ce qui est une assomption de la précarité, de la précarisation des emplois, des revenus des moyen·ne·s et petit·e·s salarié·e·s.
[37] Eduardo Galeano, Sens dessus dessous. L’école du monde à l’envers, Paris, Homnisphères, 2004 [Uruguay, Ediciones del Chancito, et autres éditions d’Argentine, de Colombie et du Mexique, 1998 ; traduit de l’espagnol (Uruguay) par Lydia ben Ytzhak], p. 28.
[38] Quand dans le même discours il dénonce – dans un passage rendu célèbre par sa mise en chanson/musique par Bob Marley & The Wailers, sous le titre de « War » – l’existence dans « certaines nations des citoyens de première classe et de seconde classe », ce n’est pas en pensant aux classes sociales, mais aux races, comme le dit aussi bien la phrase antérieure sur les races “supérieure” et “inférieure” ainsi que celle postérieure faisant référence à la couleur de la peau devant devenir aussi insignifiante que celle des yeux.
[40] A. Cabral, « Fondements et objectifs de la libération nationale et structure sociale », p. 168-169.
[41] Par exemple, en Angleterre encore monarchique (avec sa minorité de nobles et l’écrasante majorité de roturier·e·s) dans le personnel enseignant des universités, c’est-à-dire dans l’élite intellectuelle, « L’écart de salaire entre les Blancs et les minorités ethniques est de 9%, mais il s’élève à 14 % pour les seuls Noirs. Ces minorités sont exclues des postes les plus prestigieux », Aris Martinelli, « Une grève à l’Université dans l’Angleterre réactionnaire », Contretemps, 19 mars 2020, https://www.contretemps.eu/.
[42] Cf., par exemple, RASA, op. cit., p. 35 et p. 38 où la façon de mentionner le racisme anti-Noir·e·s en Afrique du Nord – indéniablement existant, inacceptable et, heureusement, combattu sur place – donne l’impression que n’est pas incluse dans le RASA cette partie de l’Afrique, où certes la considération d’être Africain·e ne semble pas si établie, au sein des populations majoritairement non noires (cf., par exemple, Stéphanie Pouessel (dir.), Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires, Tunis/Paris, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain/Karthala, 2012), du fait de la réduction de l’africanité à la négro-africanité à l’égard de laquelle persistent des préjugés, du racisme hérité aussi bien du passé de traite transsaharienne que de l’image dominante de la négrité diffusée dans le monde par les cultures racistes blanches d’Europe et des Amériques. En même temps, il existe dans des sociétés ouest-africaines, une discrimination à l’égard de la partie touarègue (non noire) de la population, rendue visible en ce XXIe siècle par quelque énième rébellion armée. Ainsi, l’idée de l’Afrique que véhicule ce rapport, malgré la contribution de quelques Africain·e·s non noir·e·s, est racialiste, un héritage du colonialisme avec lequel on prétend pourtant vouloir rompre épistémiquement. Ainsi : qu’est-ce que l’Afrique, qui est Africain·e en ce XXIe siècle ?
[43] Aimé Césaire à Lilyan Kesteloot, cité par René Depestre, Bonjour et adieu à la négritude suivi de Travaux d’identité, Paris, Robert Laffont, 1980, p. 144-145. La précision apportée par Césaire (en 1972-1973) s’oppose à la conception de Senghor ayant érigé la négritude en idéologie (le “socialisme africain” étant une émanation des valeurs du “monde noir”). L’émotion nègre de Senghor relève aussi du « gobinisme renversé », car pour Gobineau « Que l’immense supériorité des blancs dans le domaine entier de l’intelligence, s’associe à une infériorité non moins marquée dans l’intensité des sensations. Le blanc est beaucoup moins doué que le noir et que le jaune sous le rapport sensuel » (Essai sur l’inégalité des races, page 197 de l’édition électronique dans la collection “Les classiques des sciences sociales” sur le site de l’Université du Québec à Chicoutimi : http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales. Quant aux « trois gouttes de sang noir », c’est le titre d’un ouvrage d’Elie Faure (Les trois gouttes de sang, Paris, Edgar Malfère, éditeur, 1929, p. 113-114), historien de l’art – auquel Senghor s’est souvent référé – défenseur d’un génie rythmique du Noir, en transfigurant, positivement, l’idée de Gobineau. Il s’agit, chez Césaire, d’une critique de l’appropriation inversée du principe raciste états-unien du “one-drop rule”, la goutte de sang “non blanc” qui suffisait pour exclure les métis·ses de la race blanche.
[44] RASA, p. 103. Cf. aussi p. 48 où est cité Abdoulaye Wade, alors président du Sénégal (« il faut raviver la fierté africaine »), qui est resté assez fidèle à cet « entêtement » (« L’entêtement est la liberté qui se fixe en une singularité et se tient à l’intérieur de la servitude », selon Hegel, Phénoménologie de l’Esprit 1, 1807, Paris, Gallimard, 1993 [traduction de l’allemand et notes par Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière], p. 204 ; il s’agit ici de la servitude organisée par et pour le Capital dont la dynamique a produit, entre autres : 1°) la conquête des “Amériques”, le massacre des autochtones/ “Indien·ne·s” et l’importation esclavagiste des Noir·e·s ; 2°) la colonisation de l’Afrique), depuis la critique du fédéralisme colonial, sans revendication de l’indépendance (A. Wade, « Imposture du fédéralisme », Présence Africaine, n° 5, décembre 1955-janvier 1956, p. 101-105), jusqu’à la co-conception du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) que l’altermondialiste nigérien Moussa Tchangari a, de façon très pertinente, dénommé le « boubou africain du néolibéralisme »
source: http://www.cadtm.org/













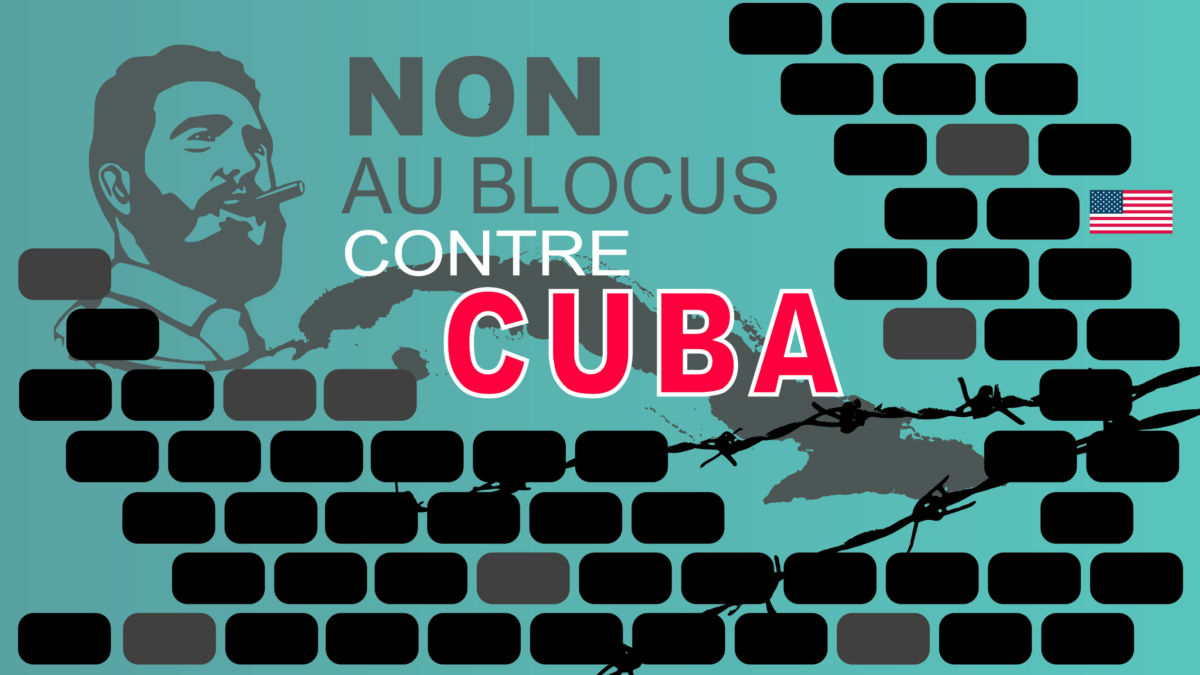










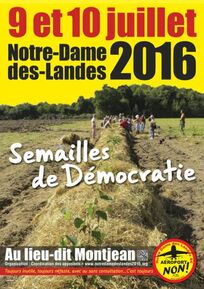









 Statue de Kwame Nkrumah, Accra, Ghana
Statue de Kwame Nkrumah, Accra, Ghana








