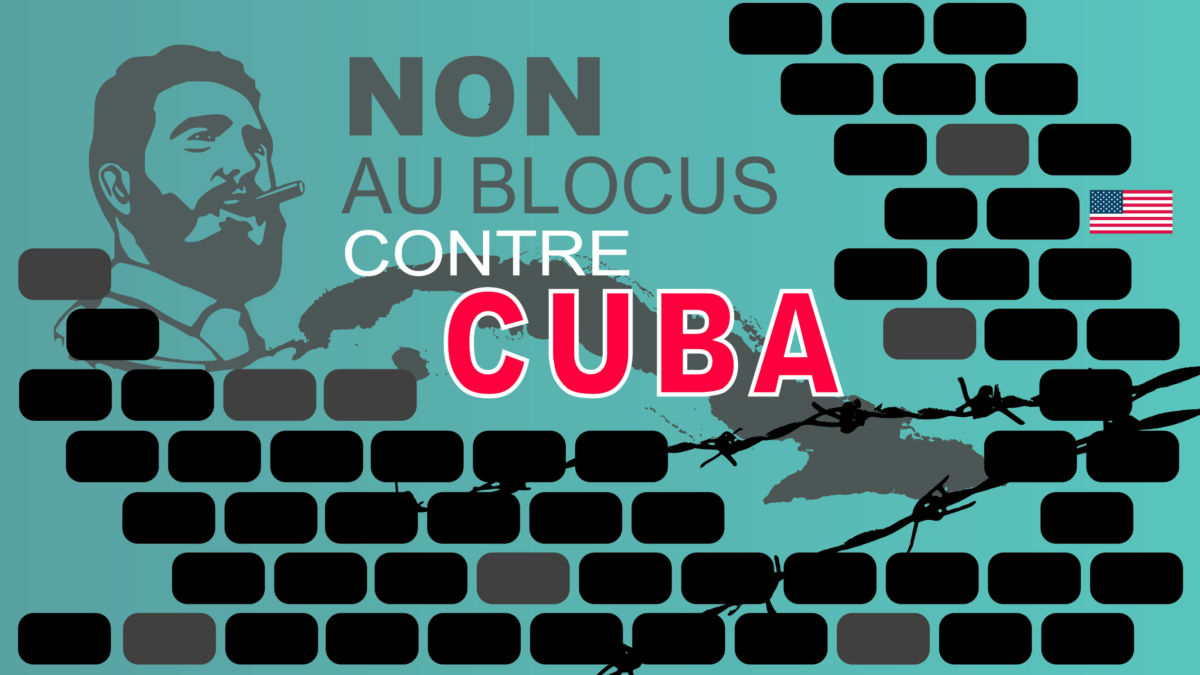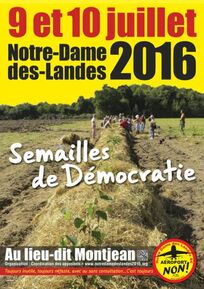-
Par L-HERMINE ROUGE le 7 Août 2015 à 21:22
« Un pays colonisé » : tribune de Patrick Köbele, secrétaire général du Parti communiste allemand (DKP) sur la politique de l’UE à l’encontre de la Grèce
Alexis Tsipras a accepté le chantage crapuleux exercé par l’UE. Une grande coalition incluant les « vieux partis » sanctionnés par le peuple, le PASOK et la Nea Dimocratia et des composantes du parti « porteur d’espoir », Syriza, s’apprêtent à valider cette politique au Parlement grec. Parmi les principaux points de ce chantage, on dénombre une attaque dramatique contre le pouvoir d’achat des masses, déjà largement entamé, via la hausse de la TVA, une coupe claire sur les retraites ainsi que le transfert de biens nationaux vers un fonds de liquidation, qui ôte encore davantage sa souveraineté à l’Etat grec.
Cette dernière mesure rappelle beaucoup l’annexion de la RDA, du moins son volet économique. Ce parallèle n’est pas déplacé. Les directives des maîtres-chanteurs augmenteront le chômage, la pauvreté des masses, la misère sociale en Grèce. Et elles ne supprimeront pas l’endettement.
Elles poursuivent ce que l’UE a déjà commencé : elles jettent l’économie grecque, le peuple grec dans les griffes du capital monopoliste des plus grandes puissances impérialistes, d’abord l’Allemagne, mais aussi des monopoles grecs qui, soit se font dévorer, soit sont dans le train des profiteurs, sans que par ailleurs le sort des propriétaires des monopoles avalés leur soit défavorables pour eux-mêmes.
Avec ce chantage, l’UE a montré de façon dramatique à l’extrême son caractère d’alliance impérialiste. Dans le même temps, cet épisode donne une photographie du processus de transformation du caractère de l’Union européenne en une UE toujours plus allemande. Il porte en soi des conflits. Les contradictions entre la France, l’Italie et l’Allemagne ont été flagrantes. Ces contradictions ont été remisées au profit des intérêts communs. Avec l’exemple de la Grèce a été démontré que quiconque refuse le joug est contraint de se plier au chantage.
Les auteurs et les victimes du chantage ne se trouvent jamais sur un pied d’égalité. Cela vaut également pour le gouvernement grec. Cependant, l’illusion d’une discussion d’égal à égal entre une économie faible et les impérialistes dominants, et avec elle, l’illusion d’une issue à l’intérieur de l’UE, ont facilité le travail des maîtres-chanteurs, et ont rendu possibles maintenant la grande coalition au parlement grec et les menaces qu’elle porte. Le danger est grand que tout cela conduise à une frustration parmi les masses et à une poussée à droite.
Mais il faut aussi parler de la responsabilité des forces progressistes en Allemagne. Elles n’ont pas réussi à repousser le soi-disant « penser local » et à faire valoir à nouveau l’internationalisme. Au contraire, l’idéologie dominante, ses médias et ses politiciens, ont réussi à ancrer le nationalisme. Changer cela exige une clarté d’analyse, des actions de masse et le développement de la lutte des classes, en Grèce, en Allemagne comme dans toute l’UE.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 7 Août 2015 à 20:45
Le gouvernement ukrainien vient de franchir un nouveau pas dans son affirmation dictatoriale. Le ministre de la justice, Pavel Petrenko, a décidé d’interdire l’inscription pour les prochaines élections municipales d’octobre de candidatures émanant du Parti communiste d’Ukraine (PCdU) et de deux petites formations se réclamant du communisme.
Les motifs invoqués sont le non-respect de la loi inique interdisant la diffusion de « symboles totalitaires » et la procédure d’interdiction en suspens du PCdU (voir, entre autres, notre article d’avril 2015 en lien).
La direction du PCdU a affirmé son intention de contester la légalité de cette décision, puisque le Parti n’est pas (encore) interdit. Il compte présenter des candidats de toute façon.
La surenchère répressive et anticommuniste du régime en place à Kiev, issu d’un coup d’Etat, ouvert aux néofascistes, toujours plus discrédité dans la population, s’explique vraisemblablement par deux raisons.
1°. Son incurie dépasse encore celle de de ses prédécesseurs, comme sa dépendance aux oligarques pillards. La situation économique et sociale s’est encore considérablement dégradée. La misère engendre la colère. Les chiffres officiels donnent un revenu moyen de 130 euros et une pension de retraite moyenne de 36 euros par mois ! Les prix des biens de première nécessité, alimentation, électricité, eau, ont explosé depuis un an, multipliés par 6 pour le gaz, par 3 pour les fruits, par 2,7 pour le pain et les pâtes, par 2,6 pour l’eau, par 2,3 pour l’électricité etc.
Le régime redoute de toute évidence la dénonciation conséquente, par le PCdU, des causes de ces réalités, l’affirmation d’un début d’alternative politique et sociale, sur la base de la mobilisation des richesses du pays.
2°. Le vote communiste pourrait également être le moyen d’exprimer une condamnation de la poursuite de la guerre civile, enclenchée par le régime, à force de propagande xénophobe et néofasciste, contre les populations de l’est du pays, en grande partie pour le compte des puissances impérialistes occidentales. L’état du rapport de force local et international ne laisse voir qu’un enlisement. Le PCdU a toujours mis en avant une résolution diplomatique du conflit, une conception fédérale du pays. C’est inacceptable pour le régime de Porochenko et ses commanditaires impérialistes.
Communistes français, nous adressons à nouveau notre solidarité aux communistes ukrainiens. Nous appelons à la dénonciation la plus forte de la dictature ukrainienne. Le gouvernement français est directement en cause dans son soutien à ce régime. Notre site continuera à relayer les demandes aux autorités françaises de dénonciation des mesures antidémocratiques prises à Kiev, d’interruption de toute livraison d’armes et de tout soutien logistique et économique à ce régime, de retrait définitif de la France du processus d’accord économique entre l’UE et l’Ukraine.
source: solidarite-internationale-pcf.fr
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 7 Août 2015 à 19:30
"Très intéressante interview – heureusement qu’il y a l’Humanité quand même… Quelques commentaires de ma part en exergue.

Le 29 juillet, le Premier ministre grec s’exprimait longuement à l’antenne de Sto Kokkino. L’entretien, conduit par Kostas Arvanitis, le directeur de cette radio proche de Syriza, offre un éclairage inédit sur cinq mois d’une négociation aux allures de guerre d’usure avec les créanciers d’Athènes et les « partenaires » européens. Avec l’autorisation de nos confrères, nous en publions ici la retranscription intégrale.
Parlons de ces six mois de négociations. Quel bilan en tirez-vous ?
Alexis Tsipras. Il faudra en tirer les conclusions de façon objective, sans s’avilir ni s’auto-flageller car ce fut un semestre de grandes tensions et de fortes émotions. Nous avons vu remonter en surface des sentiments de joie, de fierté, de dynamisme, de détermination et de tristesse, tous les sentiments. Je crois qu’au bout du compte si nous essayons de regarder objectivement ce parcours, nous ne pouvons qu’être fiers, parce que nous avons mené ce combat. Et parce que les combats perdus d’avance ne sont que ceux que l’on ne livre pas.
"Ouaip, mais les combats qu’on gagne, c’est quand même mieux…
Nous avons tenté, dans des conditions défavorables, avec un rapport de force difficile en Europe et dans le monde, de faire valoir la raison d’un peuple et la possibilité d’une voie alternative. Au bout du compte, même si ces rapports de forces étaient déséquilibrés, même si les puissants ont imposé leur volonté, ce qui reste c’est l’absolue confirmation, au niveau international, de l’impasse qu’est l’austérité. Cette évolution façonne un tout nouveau paysage en Europe. L’Europe n’est pas la même après le 12 juillet. Quand Jürgen Habermas lui-même affirme que l’Allemagne a détruit une stratégie de cinquante ans, une stratégie de l’imposition par la persuasion et non par la force, je pense que ce sont des mots qu’il nous faut écouter.
"Euh, et il trouve que c’est positif ?
Vous-même, le gouvernement, Syriza étaient-ils prêts à affronter l’adversaire ? N’y êtes-vous pas allés avec de bonnes intentions, face à des institutions qui ne se sont pas comportées de façon très institutionnelle ?
Alexis Tsipras. Il n’y a pas eu de « bonnes intentions », de notre côté ou du leur. Il y a eu une négociation très dure. Pour la première fois. Et la différence avec le passé c’est que sur la table il y avait des stratégies très différentes, contradictoires. Il y avait d’un côté un gouvernement qui avait et continue à avoir la majorité du peuple grec à ses côtés, qui revendique une autre voie, une autre perspective et de l’autre côté les institutions, qui ne sont ni indépendantes ni neutres mais aux ordres d’un plan stratégique précis.
"Eh oui, il est déniaisé le gars on dirait… Ce qu’il appelle les “instituions”, c’est en particulier le machin “Union Européenne”
Est-ce que Syriza s’est rangé à l’unisson derrière cette ligne de la négociation ou y avait-il d’autres opinions ? Avez-vous pris la négociation sur vous ? Les organes du parti connaissaient-ils les procédures ? Le parti était-il au courant de ce qui se passait ?
Alexis Tsipras. Le gouvernement fonctionne collectivement, avec le Conseil des Ministres, le conseil gouvernemental, qui tenait des réunions régulières afin que les ministres soient tenus au courant et qu’ils puissent définir le cours des négociations. Et en même temps nous avions créé, et ils existent toujours, des organes institutionnels comme le Groupe de négociation politique à laquelle de façon exceptionnelle assistaient tant le secrétaire du groupe parlementaire de Syriza que le secrétaire du comité central de Syriza, afin qu’ils soient absolument tenus au courant et qu’ils participent aux prises décisions. Le parti était lié aux organes gouvernementaux. Étroitement lié. Et bien sûr il y avait des réunions régulières du secrétariat politique de Syriza. C’est une autre question qu’il faut se poser. À quel point le parti participait de façon active à pour créer les conditions d’un soutien à l’effort gouvernemental dans la négociation ? C’est une question que l’on doit se poser.
Mais c’est vous le président de Syriza.
Alexis Tsipras. Effectivement mais je pense que le peuple grec a surpassé le parti et le gouvernement.
Cela s’est vu aussi lors du référendum.
Alexis Tsipras. Pas seulement. Certains regardaient se dérouler les négociations en grognant au moment même où la majorité du peuple grec voulait renforcer cet effort de la négociation. La négociation est une chose, la lutte quotidienne en est une autre. Les combats sociaux sont indispensables pour créer de nouveaux cadres, dépasser les cadres institutionnels en place, créer les structures et les infrastructures facilitant la confrontation avec l’ordre établi, tout en soutenant les populations qui souffrent des politiques actuelles.
Une grande partie de la population voit toujours d’un œil positif la trajectoire du gouvernement mais il y a aussi ceux qui se sont battus, dans la rue, dans les quartiers, qui se sentent contraints par les évolutions récentes. Qu’en est-il aujourd’hui du mandat populaire donné à Syriza ? Les memoranda n’ont pas été déchirés. L’accord est particulièrement dur. Vous-même, le gouvernement, le parti, avez posé la dette comme étant notre problème principal. Le sujet est enfin en discussion. Mais sur le reste, l’addition finale ?
Alexis Tsipras. Tout d’abord le mandat que nous avons reçu du peuple grec était de faire tout ce qui était possible afin de créer les conditions, même si cela nous coûte politiquement, pour que le peuple grec cesse d’être saigné.
“Mission accompl…” . Ah non…
Pour que s’arrête la catastrophe…
Alexis Tsipras. C’est le mandat que nous avons reçu, il nous a guidés dans la négociation…
Vous aviez dit que les memoranda seraient supprimés avec une seule loi.
Alexis Tsipras. Ne vous référez pas à l’un de mes discours de 2012. Avant les élections je n’ai pas dit que les memoranda pouvaient être supprimés avec une seule loi. Et personne ne disait cela. Nous n’avons jamais promis au peuple grec une ballade de santé. C’est pour cela que le peuple grec a conscience et connaissance des difficultés que nous avons rencontrées, auxquelles lui-même fait face, avec beaucoup de sang-froid. Laissons de côté ce cadre d’approche populiste « Vous avez-dit que vous déchireriez les memoranda ». Nous n’avons pas dit que nous déchirerions les memoranda avec une loi. Nous avons dit que nous mènerions le combat pour sortir de ce cadre étouffant dans lequel le pays a été conduit à cause de décisions politiques prises avant 2008 générant les déficits et les dettes, et après 2008, nous liant les mains.
“Mission accompl…” . Ah non…
Vous aviez bien dit que vous arrêteriez la catastrophe.
Alexis Tsipras. Je reviendrai sur la catastrophe. Mais nous n’avons pas promis au peuple grec que tout serait facile et que tout serait réglé en un jour. Nous avions un programme et nous avons demandé au peuple de nous soutenir afin de négocier dans des conditions difficiles pour pouvoir le réaliser. Nous avons négocié durement, dans des conditions d’asphyxie financières jamais vues auparavant. Pendant six mois nous avons négocié et en même temps réalisé une grande partie de notre programme électoral. Pendant six mois, avec l’angoisse constante de savoir si à la fin du mois nous pourrions payer les salaires et les retraites, faire face à nos obligations à l’intérieur du pays, envers ceux qui travaillent. C’était cela notre angoisse constante. Et dans ce cadre nous avons réussi à voter une loi sur la crise humanitaire. 200 millions, c’est ce qu’on a pu dégager. Des milliers de nos concitoyens, en ce moment, bénéficient de cette loi. Nous avons réussi à réparer de grandes injustices, comme celles faite aux femmes de ménage du ministère des finances, aux gardiens d’écoles, aux employés de la radiotélévision publique ERT, qui a rouvert. Nous avons voté de manière unilatérale, contre les institutions et la troïka, une loi instaurant la facilité de paiement en 100 fois, qui a permis à des centaines de contribuables, d’entrepreneurs, de s’acquitter de leurs dettes envers l’Etat, et de se débarrasser ainsi d’un poids. Nous avons voté une loi sur la citoyenneté, nous portons un projet de loi sur les prisons… Sans essayer d’enjoliver pour autant, n’assombrissons pas tout. Si quelqu’un a le sentiment que la lutte des classes est une évolution linéaire et se remporte en une élection et que ce n’est pas un combat constant, qu’on soit au gouvernement ou dans l’opposition, qu’il vienne nous l’expliquer et qu’il nous donne des exemples. Nous sommes devant l’expérience inédite d’un gouvernement de gauche radicale dans les conditions de cette Europe, de l’Europe néo-libérale, un peu comme un cheveu sur la soupe.
"Non. Ce n’est pas “Cette Europe”. C’est : “L’Europe”. Il n’y en aura jamais une autre, elle remplit actuellement 100 % des objectifs qui lui ont été assignés dès l’origine. Il veut pas comprendre le bougre…
Mais nous avons aussi, à gauche, d’autres expériences de gouvernement et nous savons que gagner les élections ne signifie pas, du jour au lendemain, disposer des leviers du pouvoir. C’est un combat constant. Mener le combat au niveau gouvernemental ne suffit pas. Il faut le mener, aussi, sur le terrain social.
Pourquoi avez-vous avez pris cette décision de convoquer un référendum ? En quoi cela vous a-t-il aidé ? En quoi cela a-t-il aidé le gouvernement et le pays ?
Alexis Tsipras. Je n’avais pas d’autre choix.
Pourquoi vous n’aviez pas d’autre choix ?
Alexis Tsipras. Il faut garder en tête ce que j’avais avec le gouvernement grec entre les mains le 25 juin, quel accord on me proposait. Je dois admettre que c’était un choix à haut risque. La volonté du gouvernement grec n’était pas seulement contraire aux créditeurs, elle se heurtait au système financier international, au système politique et médiatique grec. Ils étaient tous contre nous. La probabilité que nous perdions le référendum était d’autant plus élevée que nos partenaires européens ont poussé cette logique jusqu’au bout en décidant de fermer les banques. Lorsque nous avons pris la décision du référendum ceci n’était pas en jeu, loin de là. C’était donc un choix à haut risque mais c’était pour nous la seule voie, puisqu’ils nous proposaient un accord avec des mesures très difficiles, un peu comme celles que nous avons dans l’accord actuel, voire légèrement pires, mais dans tous les cas des mesures difficiles et, à mon avis, inefficaces. En même temps ils n’offraient aucune possibilité de survie. Car pour ces mesures ils offraient 10,6 milliards sur cinq mois. La principale position de nos partenaires lors des Sommets et des réunions de l’Eurogroupe était que la Grèce devait compléter ses obligations et ses engagements, avec une cinquième évaluation du programme précédent, ce que [le précédent Premier ministre] Samaras avait laissé à moitié fait. Ces engagements sont en fait les mêmes engagements que nous avons maintenant, c’est la cinquième évaluation que nous complétons dans un programme plus étendu, ce sont exactement les mêmes mesures. Ils voulaient que la Grèce, donc, prenne, une fois ses engagements tenus, ce qui restait du programme précédent en termes de financements. C’est à dire à peu près 10 milliards d’euros – 7 existants et 3,6 du FMI – et 2 milliards d’augmentation des bons du Trésor grec que la BCE, juste après notre élection, a mis comme limite – extrêmement basse – pour ne laisser aucune marge de respiration pour l’économie grecque. Essentiellement ils nous donnaient à peu près 12,6 milliards pour cinq mois d’extension, durant lesquels nous devions être soumis à quatre « revues » successives. Nous aurions dû appliquer le programme en cinq mois, au lieu de trois ans désormais, et l’argent que nous aurions obtenu aurait été issu des restes du programme précédent, sans un euro en plus, parce que telle était l’exigence des Néerlandais, des Finlandais, des Allemands. Le problème politique principal des gouvernements du Nord était qu’ils ne voulaient absolument pas devoir aller devant leurs Parlements pour donner ne serait-ce qu’un euro d’argent « frais » à la Grèce, car ils s’étaient eux-mêmes enfermés dans un climat populiste selon lequel leurs peuples payaient pour ces paresseux de Grecs. Un climat qu’ils ont eux-mêmes fabriqué. Tout ceci est bien sûr faux, puisqu’ils paient les banques et les prêts des banques, pas les Grecs.
La droite grecque reprend ce discours…
Alexis Tsipras. Qu’a apporté la position forte tenue contre vents et marées par le peuple grec au référendum ? Elle a réussi à internationaliser le problème, à le faire sortir des frontières, à dévoiler le dur visage des partenaires et créditeurs. Elle a réussi à donner à l’opinion internationale l’image, non pas d’un peuple de fainéants, mais d’un peuple qui résiste et qui demande justice et perspective. Nous avons testé les limites de résistance de la zone euro. Nous avons fait bouger les rapports de forces. La France, l’Italie, les pays du Nord avaient tous des positions très différentes. Le résultat, bien sûr, est très difficile mais d’un autre côté la zone euro est arrivée aux limites de sa résistance et de sa cohésion. Le chemin de la zone euro et de l’Europe au lendemain de cet accord sera différent. Les six mois prochains seront critiques et les rapports de forces qui vont se construire durant cette période seront tout aussi cruciaux.
"Mais oui, tout le monde va t’aider mon biquet… Hollande enfile déjà son casque pour venir t’aider…
En ce moment le destin et la stratégie de la zone euro sont remis en question. Il y a plusieurs versions. Ceux qui disaient « pas un euro d’argent frais » ont finalement décidé non pas seulement un euro mais 83 milliards. Donc de 13 milliards sur cinq mois on est passé à 83 milliards sur trois ans, en plus du point crucial qu’est l’engagement sur la dépréciation de la dette, à discuter en novembre. C’est un point-clé pour que la Grèce puisse, ou non, entrer dans une trajectoire de sortie de la crise. Il faut cesser avec les contes de Messieurs Samaras et Venizelos, qui prétendaient sortir des mémoranda. La réalité est que ce conte avait un loup, ce loup c’est la dette. Avec une dette à 180-200% du PIB, on ne peut pas retourner sur les marchés. On ne peut pas avoir une économie stable. Le seul chemin que nous pouvons suivre est celui de la dépréciation, de l’annulation, de l’allégement de la dette. La condition pour que le pays puisse retrouver une marge financière, c’est qu’il ne soit plus obligé de dégager des excédents budgétaires monstrueux, destinés au remboursement d’une dette impossible à rembourser.
"Amusant, on dirait qu’il a bien compris qu’il n’est plus qu’un spectateur de la chute de son pays – vive l’Europe…
Le non au référendum était un non à la proposition de la troïka, donc un non à l’austérité…
Alexis Tsipras. Il y avait deux parties dans la question posée au référendum. Il y avait la partie A, qui concernait les mesures pré-requises, et la partie B, qui concernait le calendrier de financement. Si nous voulons être tout à fait honnêtes et ne pas enjoliver les choses, par rapport à la partie A, l’accord qui a suivi le référendum est similaire à ce que le peuple grec a rejeté. Avec des mesures en partie améliorées, en partie plus difficiles, par exemple ce qui a été rajouté au dernier moment sur le Fonds de remboursement de la dette pour les 30 prochaines années. Sur d’autres mesures c’est un accord amélioré, il n’y a plus de suppression de l’EKAS [prime de solidarité pour les petites retraites, NDLR], la proposition Junker parlait de supprimer l’EKAS, d’augmenter à 23% de la TVA sur l’électricité. En ce qui concerne la partie B par contre, et là nous devons être tout à fait honnêtes, c’est le jour et la nuit. Nous avions cinq mois, 10 milliards, cinq « revues ». Nous avons 83 milliards – c’est à dire une couverture totale des besoins financiers sur le moyen terme (2015-2018), dont 47 milliards pour les paiements externes, 4,5 milliards pour les arriérés du secteur publique et 20 milliards pour la recapitalisation des banques et, enfin, l’engagement crucial sur la question de la dette. Il y a donc un recul sur la partie A, de la part du gouvernement grec, mais sur la partie B il y a une amélioration : le référendum a joué son rôle. Le mercredi soir précédent le référendum, certains avaient créé les conditions d’un coup d’État dans le pays, en proclamant qu’il fallait envahir Maximou [le Matignon grec, NDLR], que le gouvernement emmenait le pays vers une terrible catastrophe économique, en parlant de files d’attente devant les banques. Je dois dire que le peuple grec a su garder son sang-froid, au point que les télévisions avaient du mal à trouver du monde pour se plaindre de la situation, ce sang-froid était incroyable. Ce soir-là je me suis adressé au peuple grec et j’ai dit la vérité. Je n’ai pas dit : « Je fais un référendum pour vous sortir de l’euro ». J’ai dit : « Je fais un référendum pour gagner une dynamique de négociation ». Le « non » au mauvais accord n’était pas un « non » à l’euro, un « oui » à la drachme. Appelons un chat un chat. On peut m’accuser d’avoir eu de mauvaises estimations, de mauvais calculs, des illusions, mais à chaque moment, à chaque avancée, et je pense personne d’autre ne l’avait fait auparavant, j’ai dit les choses clairement, j’ai informé deux fois le Parlement, c’était un processus ouvert, Il n’y avait pas dans cette négociation de cartes cachées, tout était ouvert. À chaque avancée j’informais le peuple grec, je disais les difficultés, mes intentions, ce que je préparais, même au moment crucial du référendum, j’ai dit précisément ce que je comptais faire, j’ai dit la vérité au peuple grec.
Avec dans vos mains, aux heures de la négociation, les 61,2% que vous a donné le peuple grec, quel aurait été l’accord qui vous aurait satisfait lors de votre retour de Bruxelles ?
Alexis Tsipras. Le référendum a été décidé le jour de l’ultimatum, le 25 juin, vendredi matin, lors d’une réunion que nous avons tenue à Bruxelles, avec, devant nous, la perspective d’une humiliation sans sortie possible. C’était, pour eux, à prendre ou à laisser. « The game is over », répétait le président du Conseil européen, Donald Tusk. Ils ne s’en cachaient pas, ils voulaient des changements politiques en Grèce. Nous n’avions pas d’autre choix, nous avons choisi la voie démocratique, nous avons donné la parole au peuple. Le soir même en rentrant d’Athènes, j’ai réuni le Conseil gouvernemental où nous avons pris la décision. J’ai interrompu la séance pour communiquer avec Angela Merkel et François Hollande. Je leur ai fait part de ma décision, le matin même je leur avais expliqué que ce qu’ils proposaient n’était pas une solution honnête. Ils m’ont demandé ce que j’allais conseiller au peuple grec et je leur ai répondu que je conseillerai le « non », pas dans le sens d’une confrontation, mais comme un choix de renforcement de la position de négociation grecque. Et je leur ai demandé de m’aider à mener à bien ce processus, calmement, de m’aider afin que soit accordé par l’Eurogroupe, qui devait se réunir 48 heures plus tard, une extension d’une semaine du programme afin que le référendum ait lieu dans des conditions de sécurité et non pas dans des conditions d’asphyxie, avec les banques fermées. Ils m’ont tous les deux assuré à ce moment-là, qu’ils feraient tout leur possible dans cette direction. Seule la chancelière m’a prévenu qu’elle s’exprimerait publiquement sur le référendum, en présentant son enjeu comme celui du maintien ou non dans l’euro. Je lui ai répondu que j’étais en absolu désaccord, que la question n’était pas euro ou drachme, mais qu’elle était libre de dire ce voulait. Là, la conversation s’est arrêtée. Cette promesse n’a pas été tenue.
"Arrrrrr, quelle surprise… Pourtant il n’avait qu’à regarder ce qui était advenu à son prédécesseur qui avait voulu un référendum…
Quarante-huit heures plus tard l’Eurogroupe a pris une décision très différente. Cette décision a été prise au moment où le Parlement grec votait le référendum. La décision de l’Eurogroupe a mené en vingt-quatre heures à la décision de la BCE de ne pas augmenter le plafond ELA [mécanisme de liquidités d’urgence dont dépendent les banques grecques, NDLR] ce qui nous a obligés à instaurer un contrôle de capitaux pour éviter l’effondrement du système bancaire. La décision de fermer les banques, était, je le pense, une décision revancharde, contre le choix d’un gouvernement de s’en remettre au peuple.
Est-ce que le « non » au référendum reste, pour vous, une carte à jouer ?
Alexis Tsipras. Cela ne fait aucun doute. C’est une carte très importante. Le référendum a fait de la Grèce, de son peuple et de son choix démocratique le centre du monde. C’était un référendum contre vents et marées. Tous nos partenaires, nos créanciers et la classe dirigeante internationale affirmaient que la question était euro ou drachme. Mais la question formulée par le gouvernement grec souverain, c’était la question inscrite sur le bulletin de vote.
Vous attendiez-vous à ce résultat ?
Alexis Tsipras. J’avoue que jusqu’au mercredi [précédent le scrutin, NDLR] j’avais l’impression que ce serait un combat indécis. À partir du jeudi, j’ai commencé à réaliser que le « non » allait l’emporter et le vendredi j’en étais convaincu. Dans cette victoire, la promesse que j’ai faite au peuple grec de ne pas jouer à pile ou face la catastrophe humanitaire a pesé. Je ne jouais pas à pile ou face la survie du pays et des couches populaires. À Bruxelles, par la suite, sont tombés sur la table plusieurs scénarios terrifiants. Je savais durant les dix-sept heures où j’ai mené ce combat, seul, dans des conditions difficiles, que si je faisais ce que me dictait mon cœur – me lever, taper du poing et partir – le jour même, les succursales des banques grecques à l’étranger allaient s’effondrer, nous parlons là d’actifs valant 7 milliards d’euros, plus de 405 établissements, environ 40 000 emplois. En quarante-huit heures, les liquidités qui permettaient le retrait de 60 euros par jour se seraient asséchées et pire, la BCE aurait décidé d’une décote des collatéraux des banques grecques, voire auraient exigé des remboursements qui auraient conduit à l’effondrement de l’ensemble des banques. Il n’était pas donc pas question de décote, seulement. C’était bien la menace d’effondrement. Or un effondrement se serait traduit non pas par une décote des épargnes mais par leur disparition. Malgré tout j’ai mené ce combat en essayant de concilier logique et volonté – et je dois dire que moi-même et nos partenaires européens avons pris quelques coups durant ces dix-sept heures. Je savais que si je partais j’aurais probablement dû revenir, dans des conditions plus défavorables encore. J’étais devant un dilemme. L’opinion publique mondiale clamait « #ThisIsACoup », au point que c’est devenu cette nuit-là sur Twitter le premier hashtag au niveau mondial. D’un côté il y a avait la logique, de l’autre la sensibilité politique. Après réflexion, je reste convaincu que le choix le plus juste était de faire prévaloir la protection des couches populaires. Dans le cas contraire, de dures représailles auraient pu détruire le pays. J’ai fait un choix de responsabilité.
Vous ne croyez pas à cet accord et pourtant vous avez appelé les députés à le voter. Qu’avez-vous en tête ?
Alexis Tsipras. Je considère, et je l’ai dit au Parlement, que c’est une victoire à la Pyrrhus de nos partenaires européens et de nos créanciers, en même temps qu’une grande victoire morale pour la Grèce et son gouvernement de gauche.
"Il est quand même sidérant le gars. Les Grecs crèvent, et il est heureux d’une victoire morale qui va les faire crever encore plus…
Mais bon, il prépare peut être un plan B, on verra
C’est un compromis douloureux, sur le terrain économique comme sur le plan politique. Vous savez, le compromis est un élément de la réalité politique et un élément de la tactique révolutionnaire. Lénine est le premier à parler de compromis dans son livre La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme ») et il y consacre plusieurs pages pour expliquer que les compromis font partie des tactiques révolutionnaires. Il prend dans un passage l’exemple d’un bandit pointant sur vous son arme en vous demandant soit votre argent, soit votre vie. Qu’est censé faire un révolutionnaire ? Lui donné sa vie ? Non, il doit lui donner l’argent, afin de revendiquer le droit de vivre et de continuer la lutte. Nous nous sommes retrouvés devant un dilemme coercitif. Ce chantage est cynisme : soit le compromis – dur et douloureux – soit la catastrophe économique – gérable pour l’Europe, pas au niveau politique, mais économiquement parlant – qui pour la Grèce et la gauche grecque aurait été insurmontable. Aujourd’hui les partis de l’opposition et les médias du système font un boucan impressionnant, allant jusqu’à demander des procédures pénales contre Yanis Varoufakis, pour savoir si oui ou non il avait un plan de crise. Imaginez ce qui se passerait dans ce pays s’il y avait eu une telle catastrophe économique. Nous sommes tout à fait conscients que nous menons un combat, en mettant en jeu notre tête, à un niveau politique. Mais nous menons ce combat en ayant à nos côtés la grande majorité du peuple grec. C’est ce qui nous donne de la force.
Toute cette procédure de négociation pour en arriver là… Cela en valait-il le coût, politiquement parlant ? Au point où nous en sommes, avec les banques fermées, les dommages causés à une économie grecque déjà affaiblie, cela en valait-il la peine ?
Alexis Tsipras. Je ne regrette pas un seul de ces moments, je ne regrette rien de tout ce qui s’est passé ces cinq mois. Cela en valait la peine, et concernant l’économie, les choses sont réversibles.
"Ben voui, les boites qui ont crevé vont ressusciter – prévoir 3 jours quand même…
La Grèce est à la Une des journaux, en des termes positifs. Le drapeau grec flotte sur des manifestations à travers les capitales d’Europe. Des milliers de personnes en Irlande, en France, en Allemagne, ont manifesté leur solidarité avec le peuple grec. Cela en valait la peine, bien sûr.
"Euh, comment te dire….
Mais la conclusion de ces négociations est considérée comme une défaite…
Alexis Tsipras. C’est considéré comme une défaite par certains esprits étroits qui pensent que la révolution aura lieu via l’invasion des Palais d’Hiver et qu’elle durera un instant.
"Noooooooooooon, elle va arriver toute seule par UPS je pense, grâce à la bonté d’âme de Merkel et Hollande. Prévoir un délai quand même…
Et si l’on regarde les sondages en Espagne pour Podemos ?
Alexis Tsipras. Ceux de Podemos ont devant eux la possibilité de revendiquer une alternative. Ils ne l’auraient pas si le 12 juillet nous avions assisté à une énorme catastrophe économique.
"Euhhh, pour faire pareil ? Vaut mieux voter Mainstream, ça fait moins mal à la fin quand mêmes, car ils tapent moins forts à l’eurogroupe…
Podemos a toutes les possibilités de gagner,
"aaaaaahahahahahahah. Elle est bien bonne. 15 % des voix dans le dernier sondage… Ils se sont effondrés suite à l’expérience Syriza….
ils ont trois mois devant eux pour mener le combat et la bataille électorale en Espagne en novembre fait partie du changement qui arrive en Europe.
"Il arrive… mais prévoir 2 ou 3 millénaires quand même…
Tout comme les changements et transformations qui auront lieu dans le reste de l’Europe. Mais revenons aux dommages causés à l’économie grecque. Ils sont réversibles, à condition que l’accord soit complété. Nous ne sommes pas tous seuls :
"On dirait un discours de l’état major français en mai 1940, non ?
le projet de Grexit des cercles conservateurs extrémistes pour un Grexit est toujours sur la table.
"Ah, ça, c’est sûr que vous allez finir par quitter l’euro…
Il y restera jusqu’à la décision de dépréciation de la dette grecque, une décision qui doit déterminer si le FMI participera ou non au programme. Je dis que la situation est réversible. S’il n’y avait pas eu de changement politique, le pays, de toute façon, serait contraint de dégager des excédents budgétaires primaires équivalents à 3,5% en 2015 et 4,5% à partir de 2016 et par la suite. Aujourd’hui, nous avons l’obligation, d’arriver en 2018 à un excédent de 3,5%. Aujourd’hui nous pouvons n’en dégager aucun, voire être en négatif, arriver à 1% demain, à 2,5% en 2017, en fonction de la situation économique. Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Cela veut dire que le changement politique et la négociation ont sauvé l’économie grecque de mesures qui lui auraient coûté plus de 15 milliards d’euros.
Mais l’économie réelle devra fait face à la hausse de la TVA… Nous n’avons plus notre mot à dire sur le niveau de taxation de tel ou tel produit. Ils font irruption tels des gangsters dans la gestion de nos affaires internes…
Alexis Tsipras. Il n’y a pas de doute là-dessus.
Les Grecs ont porté la gauche au pouvoir pour arrêter cela…
Alexis Tsipras. La gauche a fait tout ce qu’elle a pu et elle va continuer à se battre que cela s’arrête. Mais il faut que la gauche – et nous tous avec – se rende compte que nous devons nous battre dans un cadre très précis, en mesurant les alternatives qui s’offrent à nous. À ce stade en particulier les alternatives que nous avions devant nous étaient soit la faillite désordonnée soit le compromis difficile qui nous laisse la possibilité de survivre et de nous battre dans les années à venir pour « casser » cette étroite mise sous surveillance. Nous avons la possibilité de nous libérer de cette surveillance asphyxiante. Le peuple grec est comme le fugitif qui, parce qu’il a tenté de s’échapper de la prison de l’austérité, a été placé à l’isolement. Il mène un combat pour s’enfuir mais à la fin il est arrêté et jeté dans une cellule encore plus étouffante et plus étroite.
"C’est incroyable quand même, un premier ministre qui parle ainsi de son pays. Il ne lui manque que de partir en exil à Shangaï…
Comment sortir de cette prison désormais ? Certains préconisent de se jeter dans les douves avec les crocodiles ou sur les grillages électriques. Non, ce n’est pas une façon de s’échapper : c’est une façon de se suicider. Aujourd’hui pour quitter cet isolement il faut susciter une immense vague de solidarité internationale pour aider le peuple grec à se libérer du joug de l’austérité. C’est seulement ainsi que nous nous libérerons.
"Il est énorme ce type ! Mais oui, compter sur un immense élan de solidarité internationale, ça c’est du lourd. Moi, je vais dire à mon banquier que j’attends de gagner au loto…
Peut-on encore entrevoir une solution au sein de cette Union Européenne, dans le cadre de cette zone euro ? C’est un peu une alliance de loups…
Alexis Tsipras. Nous vivons dans le cadre d’une économie mondialisée. Regardez les pays voisins, en dehors de l’UE, de la zone euro : la Serbie, l’Albanie. Vous avez l’impression que là-bas il n’y a pas d’austérité ?
"Un peu plus loin, il y a le Mali aussi…
Que les conditions de survie n’y sont pas difficiles ? Que ces pays ne sont pas contraints d’importer les produits de base ? Tout d’un coup, le pays deviendrait autonome et pourrait couvrir les besoins pour la survie de la population ? Nous ne pouvons pas faire ça du jour au lendemain. Nous sommes donc obligés de voir la réalité en face. Et de voir, dans le cadre de cette réalité, si la lutte des classes existe seulement au niveau des négociations ou aussi au sein du pays. Existe-il, pour un gouvernement de gauche, des possibilités d’ouvrir un espace, de créer des respirations de solidarité et de redistribution ? La différence entre une politique progressiste et une politique conservatrice, au sein de l’étroit cadre européen est-elle possible ?
"Ami lecteur (trice), si vous répondez oui à cette question, ne prenez SURTOUT pas la route dans cet état !!!!
Nous devrons répondre collectivement à ces questions. Cet accord a été un choc pour le peuple et pour la gauche. Certains en concluent que dans ce contexte un gouvernement de gauche n’a pas de raison d’être. Je suis prêt à débattre de ce point de vue. Cela équivaut à dire au peuple grec : « Nous nous sommes trompés en disant que nous pouvions mettre fin à ce mémorandum, demandons au système politique déchu qui nous a mené jusqu’ici de gérer cela. Choisissez plutôt ce système qui toutes ces dernières années ne négociait pas mais complotait avec la troïka afin de vous imposer ces mesures. » Le peuple grec nous répondrait qu’il n’en veut pas, qu’il attend de nous que nous assumions nos responsabilités. Si nous devions renoncer parce que les conditions trop difficiles, comment cela se traduirait-il en pratique ? Nous ne nous présenterions pas aux prochaines élections pour ne pas courir le risque d’être élus, comme l’a fait le KKE en 1946. Voyons maintenant les choses différemment. Supposons que nous en arrivions à la conclusion théorique que nous autres les « sages » de la gauche, façonnions mieux les conditions objectives en étant dans l’opposition. Si nous avouons au peuple, les yeux dans les yeux, que nous ne pouvons pas gérer les choses, en étant au gouvernement, comment pourrait-il nous faire confiance pour le faire dans l’opposition ? Dans l’opposition, nous aurions dix fois moins de pouvoir. Si elle suit cette logique, la gauche en arrivera à clore volontairement une opportunité historique de mener le combat pour changer les choses – tant qu’elle le peut – depuis une position de responsabilités. Au fond, ce serait céder à la peur des responsabilités.
Ne sommes-nous pas dans une position surréaliste, avec des travailleurs appelés à se battre contre une politique que la gauche est supposée mettre en œuvre ? C’est une folie !
Alexis Tsipras. La grande différence, l’énorme différence, et c’est là où se concentre leurs attaques, à l’intérieur comme à l’extérieur du Parlement, c’est que nous, nous ne revendiquons pas la propriété de ce programme. Quand l’opinion publique européenne et mondiale a vu de quelle façon le gouvernement grec et moi-même avons été contraints à ce compromis, personne ne peut prétendre que la propriété de ce programme nous revient. Ici permettez-moi de répéter la citation de Jürgen Habermas qui a dit, je le cite mot à mot : « J’ai peur que le gouvernement allemand, y compris sa frange social-démocrate, ait dilapidé en l’espace d’une nuit tout le capital politique qu’une Allemagne meilleure avait accumulé depuis un demi-siècle ». Voici quelle défaite politique ont subi nos partenaires européens. Ici s’ouvre devant nous un espace, très important, de transformations en Europe. Doit-on l’abandonner, nous qui en sommes les protagonistes, nous qui avons suscité ces fissures ? Enfin, un gouvernement de gauche obligé de mettre en œuvre ce programme va rechercher en même temps les moyens d’en équilibrer les conséquences négatives, tout en restant dans les combats sociaux, parmi les travailleurs qui se battront.
Mais ils vous couperont l’herbe sous le pied ! Pourquoi vous laisseraient-ils compenser les effets de ces mesures ?
Alexis Tsipras. Vous pensez que la négociation s’est arrêtée le 12 juillet ? C’est un combat constant. Tant que nous façonnerons les conditions pour des rapports de force plus propices au niveau européen, ce combat penchera en notre faveur. Il ne faut pas abandonner le combat.
"Ah mais si : quand tu as une armée de 500 personnes, et que tu as l’armée allemande qui te fonce dessus, tu abandonne le combat, sauve tes troupes, et prépare la résistance. Tu ne vas pas mener le combat de face… en l’espèce il faut sortir du cadre en quittant l’euro – ce qui est trèèèèès difficile pour un pays aussi faible que la Grèce
Il y déjà des rumeurs sur de nouvelles mesures, sur de nouveaux paquets de mesures.
Alexis Tsipras. J’ai bien peur que ces rumeurs ne naissent ici, avant de se propager à l’étranger pour ensuite revenir ici.
Cela fait partie du jeu. Mais vous les avez bien entendues vous aussi. Des rumeurs de prêt-pont.
Alexis Tsipras. Je connais le cadre de l’accord que nous avons signé le 12 juillet au Sommet de la zone euro. Ces obligations fondamentales, indépendamment du fait que nous soyons ou non d’accord avec elles, nous les mettrons en œuvre. Pas une de plus, pas une de moins.
Un auditeur nous dit : « J’ai trois enfants, ils sont au chômage, je travaille à temps partiel, je dois m’acquitter d’une taxe immobilière de 751€, je veux les soutenir mais je n’ai rien ! »
Alexis Tsipras. C’est la réalité de la société grecque aujourd’hui. Un rapport de l’Institut du travail de la Confédération syndicale des salariés du privé évalue à 4 sur 10 le nombre de personnes en situation de pauvreté. Nous devons affronter cette réalité que nous devons affronter. Si nous abandonnons le combat, ces 4 pauvres sur 10 vont-il cesser d’être pauvres? Le seul choix, c’est de rester, d’organiser un mouvement de solidarité et en même temps de nous battre pour des mesures qui contrebalancent les conséquences néfastes des obligations imposées par les recettes néolibérales de l’austérité. Dans le cadre d’un projet que nous allons devoir établir au plus vite, nous allons nous reconstituer pour contre attaquer. Ce projet sera un projet de gauche, il ne peut venir ni de la droite ni de la social-démocratie. Le projet de la droite et de la social-démocratie c’est de dire que s’il n’y avait pas de mémorandum, il faudrait l’inventer ! Nous, nous affirmons que le mémorandum est une mauvaise recette. Les alliances en face étaient trop fortes et nous avons été obligés de l’accepter. Mais nous livrons un combat pour en retourner les termes, pour nous en désengager petit à petit. J’entends dire que c’est le pire mémorandum de tous ceux que nous avons eus. C’est le plus douloureux parce qu’il arrive dans le cadre d’un compromis douloureux. Je suis d’accord là-dessus. Mais les deux précédents memoranda se sont traduits par 16% d’ajustement budgétaire sur quatre ans. Ils comportaient des licenciements collectifs - des licenciements de fonctionnaires, ici nous n’avons pas de licenciements de fonctionnaires, mais nous avons eu des réembauches de gens injustement traités. En même temps, nous avons la poursuite de l’austérité de manière directe avec l’augmentation de la TVA, dans la restauration par exemple, c’est une mesure qui ne va rien donner à notre avis et c’est un des grands problèmes, mais nous n’avons pas de baisse nominale des retraites et des salaires !
Mais nous avons des baisses indirectes !
Alexis Tsipras. Dites-moi donc où sont ces baisses ?
L’augmentation de la TVA se traduira par une perte de pouvoir d’achat.
Alexis Tsipras. Je l’ai dit ça, sur la TVA, je ne vais pas me répéter. Mais est-ce la même chose que d’avoir des baisses de salaires ou de retraite de 40% comme avec les deux précédents memoranda ? 40% de baisse nominale sur les retraites, est-ce la même chose que la TVA à 23% sur la restauration ? Cela justifie-t-il que l’on juge ce memorandum pire que les deux précédents ?
C’est une autre logique…
Alexis Tsipras. Non nous ne sommes pas dans des logiques différentes ! Nous sommes tous déçus, nous sommes tous amers, mais de là à se charger d’un poids supplémentaire, s’auto-fustiger, parce que la gauche s’est habituée à un discours de la faute ces quarante dernières années, et ne pas reconnaître que nous avons réussi quelque chose et que nous allons continuer…
Vous n’avez pas décrit l’accord qui vous aurait fait dire : « c’est un bon accord », après le référendum.
Alexis Tsipras. Oui. Après le référendum un bon accord aurait été celui qui nous aurait donné la possibilité d’assurer nos obligations budgétaires à moyen terme, celles que nous avons assurées désormais, en plus de l’engagement sur la dette. Mais avec un cadre de compromis honnête. D’accord, acceptons les règles de la zone euro, acceptons d’entrer dans une logique de budgets équilibrés et d’excédents budgétaires – mais modérés, pour qu’ils soient viables, ces excédents. Des excédents de 1 ou 2% pour éviter des mesures qui sont, de l’avis des meilleurs économistes de la planète, contre-productives. Par exemple je considère que l’augmentation de la TVA est une erreur. Parce que le pays a besoin d’une amélioration de l’encaissement des impôts et de la TVA. Cela implique de renforcer les mécanismes de contrôle, dans les îles où il y a actuellement énormément de fraude et d’évitement fiscal ; de convaincre les citoyens de prendre part en demandant des factures, pour améliorer l’encaissement. Si on augmente l’encaissement de 3%, on encaissera d’avantage que ce qui est prévu avec l’augmentation de 10% de la TVA dans la restauration. Je dis des choses logiques, il n’y a là rien d’incroyable. De même je considérerais comme logique de ne pas imposer une pression fiscale supplémentaire sur des secteurs touchés par la crise, comme l’agriculture. Là nous devons trouver des mesures qui compensent cette pression fiscale supplémentaire.
Mais qui sont vraiment les agriculteurs ? Ils ne sont pas tous les mêmes. La Grèce compte-elle 800.000 agriculteurs ? On ne peut pas caresser certaines catégories dans le sens du poil…
Alexis Tsipras. Certaines catégories sociales sont habituées à ne pas faire face à leurs obligations et à revendiquer sans critères de justice. Nous devons nous attaquer à tout cela. D’autre part, nous devons comprendre que ces changements ne peuvent pas intervenir dans un contexte de conflit social, mais seulement dans un contexte de cohésion sociale. Mais là vous m’offrez l’occasion de prendre position sur les nombreux choix qui peuvent se faire, dans une perspective progressiste, même dans le cadre d’un ajustement budgétaire difficile imposé de l’étranger. Prenons les exemples de la fraude fiscale, de la corruption. La gauche sera jugée sur sa capacité à les affronter Peut-on suivre un programme politique de gauche, une politique socialement juste sans contrôle de ceux qui fraudent depuis des années, envoient de l’argent à l’étranger, au vu et au su de tous, tout en restant hors d’atteinte ? Nous serons jugés là-dessus.
Qui peut arrêter ceux-là ? Est-ce si difficile, pour l’administration, de repérer les comptes depuis lesquels l’argent est transféré à l’étranger ?
Alexis Tsipras. Cela demande du temps et de la méthode. Je dois avouer que ces derniers six mois, notre attention a été accaparée par les confrontations liées à la négociation. Mais il n’y a pas que la négociation ! Si l’on considère que les étrangers sont responsables de tout ce qui ne marche pas dans le pays, on déroule le tapis rouge à la bourgeoisie et à l’oligarchie locale qui ont mené le pays à la catastrophe. Nous devons nous occuper de l’oligarchie intérieure, cela implique de réorienter notre projet, notre plan de bataille, de confrontation et de conflit, contre l’oligarchie qui a conduit le pays à la destruction et qui continue à contrôler des centres de pouvoir. Certains diront : mais là aussi vous allez vous retrouver avec la Troïka comme adversaire ! Oui. Mais alors chacun devra prendre ses responsabilités publiquement. C’est une chose que la Troïka dise : « Je ne veux pas que vous ayez des déficits » – même si on n’est pas d’accord avec sa politique – et c’en est une autre qu’elle dise : « Je ne veux pas que les riches de votre pays soient mis à contribution et je veux que les pauvres paient toute l’addition ». La Troïka prendra publiquement ses responsabilités, elle devra rendre des comptes devant l’opinion internationale parce qu’en ce moment tous nous regardent, l’Europe et le monde entier.
"Ah oui, ça va les terroriser. Un peu comme quand il se sont assis sur le référendum de 2005…
Je suis allé au Parlement européen, il y avait une immense dichotomie : la moitié de notre côté et l’autre moitié avec ceux d’en face. Tout le monde regarde vers la Grèce ! Il faut donc que nous prenions des initiatives, dans le sens de grands changements, des réformes au contenu progressiste, qui vont changer le système politique, combattre la corruption, la fraude fiscale, les pratiques de l’oligarchie. Voilà les buts que doit se donner une politique progressiste et radicale pour notre pays.
Des combats n’ont pas été menés par le gouvernement de gauche. Par exemple, sur les mines d’or de Skouriès où les citoyens se sont dressés contre la compagnie Ellinikos Chrysos. Le gouvernement de droite a poursuivi et réprimé ces citoyens. La Compagnie Ellinikos Chrysos fonctionne encore.
Alexis Tsipras. À Skouriès ce que je sais c’est que l’entreprise se plaint, elle réclame une décision car elle n’a pas encore reçu d’autorisation pour continuer l’extraction et la séparation de l’or sur place. Ce combat continue. Pas seulement contre les grands intérêts. C’est aussi un combat qui se livre sur place contre des intérêts locaux. Il faut trouver un modus vivendi parce que de l’autre côté, ils avancent l’argument de l’emploi.
Mais nous sommes d’un côté, pas de l’autre !
Alexis Tsipras. Nous sommes un gouvernement, nous avons des responsabilités, nous ne pouvons pas mettre 5000 salariés au chômage. Il faut trouver une solution. Ce dossier était géré par Panayotis Lafazanis en tant que ministre [de l'Énergie et de la Reconstruction productive, qui a quitté le gouvernement le 18 juillet, NDLR]. Il est aujourd’hui repris par Panos Skourletis. Ce n’est pas encore réglé mais je suis certain que la solution prendra en compte à la fois la cohésion, la justice sociale et le bon droit du combat citoyen.
Quels citoyens ? Ceux qui se battent contre cet « investissement » ou ceux qui réclament du travail ?
Alexis Tsipras. La justice sociale implique que les gens qui travaillaient ne perdent pas leur emploi. Le droit du combat citoyen, c’est celui des gens qui se battent pour l’environnement et pour leurs vies. Je suis clair là-dessus.
Concernant les médias de masse, il y a depuis des années un environnement anarchique. Le gouvernement a pris des engagements, un projet de loi a été déposé. Cela se fait-il dans un esprit de revanche ? Les nouveaux acteurs qui vont surgir dans le paysage audiovisuel seront-ils plus honnêtes ? Le gouvernement favorisera-t-il ses amis, l’entourage des ministres ?
Alexis Tsipras. Je ne pense pas qu’il y ait de place pour un sentiment de revanche dans le projet de loi. Il exprime pour la première fois la volonté de mettre de l’ordre et d’imposer des règles dans ce secteur. Lorsque quelqu’un veut utiliser un bien public, il a le devoir de payer au secteur public le loyer équivalent à l’usage de ce bien public – et il a le devoir aussi de respecter certaines règles sur la manière de gérer ce bien public. Il ne s’agit pas seulement d’imprimer un journal et de le vendre à celui qui veut bien l’acheter. Il y a usage du domaine public, donc il faut respecter quelques règles ! Pour la première fois depuis l’entrée des investisseurs privés dans le secteur audiovisuel, il va y avoir une règlementation, le cadre va être réglementé. Tous ceux qui, jusqu’ici, ne respectent pas leurs engagements envers la loi seront obligés de les respecter… Les consultations qui vont suivre le projet de loi nous permettrons d’entendre les positions des uns et des autres.
Ces consultations seront-elles ouvertes à tous et sincères ?
Alexis Tsipras. Nous entendrons toutes les parties, journalistes, propriétaires de médias et nous sommes prêts à entendre tous les points de vue. Ce qui compte c’est que nous puissions dire au peuple grec - et s’il doit y avoir des améliorations, des modifications, nous sommes prêts à l’entendre, – que ce secteur va enfin être régulé et qu’il le sera dans la légalité. Aucun groupe de presse ne pourra plus dissimuler des pertes financières et en même temps bénéficier de facilités de la part du système bancaire privé en contrepartie d’un soutien à certains acteurs du système politique. Dans ce triangle de l’intrication, de la corruption, ce triangle du pêché, des entreprises de presse en déficit se voyaient accorder des prêts bancaires de manière scandaleuse tandis que des entreprises saines, dans les autres secteurs d’activité, ne pouvaient obtenir de prêts. Ce triangle scandaleux est terminé. L’information des citoyens est un bien public, elle doit être objective, se plier à des règles et le fonctionnement des entreprises de presse et des mass media doit se faire dans la transparence selon les règles applicables à toutes les entreprises du pays.
Des auditeurs nous interpellent sur les violences policières, puisque nous avons abordé le sujet des mines d’or de Skouriès. C’est un gouvernement de gauche qui réprime les manifestations. Il y a eu des membres cassés, parfois.
Alexis Tsipras. Je n’en doute pas, mais la différence, c’est qu’il n’y a aucune volonté politique de couvrir, de cacher ces faits. Au contraire. Il faut faire toute la lumière sur ces violences et mettre à la disposition de la justice ceux qui provoquent ces incidents, laisser la loi faire son travail. Le rôle du policier n’est pas de tabasser ou de dissoudre la légitimité d’une manifestation publique, comme nous l’avons vécu ces dernières années. Tout de même sur ce point il y a eu des changements importants.
Nous nous étions heureux du retrait des grilles autour du Parlement. Elles sont de retour aujourd’hui.
Alexis Tsipras. Quand ça ?
Je les ai revues.
Alexis Tsipras. Vous parlez des incidents qui ont eu lieu. Des cocktails Molotov ont explosé devant les gens il a failli y avoir des blessés graves. Quinze personnes de nationalités étrangères ont été arrêtées pour cette raison. Est-ce que quelqu’un a relevé ce fait ? Entendons-nous bien : où étaient les grandes foules, les grandes passions ? Juste ces quinze étrangers ! Que voulaient-ils ? Attention ! Il ne s’agissait pas de migrants. Je ne sais pas s’il s’agissait de provocateurs liés à des services secrets étrangers. Je l’ignore, ce point reste à éclaircir. Peut-être s’agissait-il de militants solidaires. Cela ne m’intéresse pas. Mais je suis désolé : pourquoi ne relevez-cous pas aussi ces faits-là ? Certaines actions, certains mouvements, je parle objectivement, fonctionnent de façon provocatrice. Que doit faire la police, dans une démocratie, lorsqu’une pluie de cocktails Molotov s’abat aux abords d’une manifestation, menaçant de bruler vifs des manifestants ? Doit-elle laisser faire, jusqu’à ce qu’il y ait mort d’homme ?
Pourquoi vous mettez vous en colère ?
Alexis Tsipras. Parce que je suis dans un environnement familier et que j’aime me mettre en colère en terrain connu [rires].
Venons-en aux questions relatives au parti. Comment avez-vous fait pour faire des problèmes internes à Syriza des problèmes de la Grèce ? Il n’y a que Syriza pour réussir un tour pareil.
Alexis Tsipras. [Rires] Non, il n’est pas question d’en faire un problème du pays. Le pays avance dans le cadre de la Constitution, selon laquelle les décisions sont prises par les représentants du peuple au Parlement grec. Le gouvernement, le Conseil des ministres assume une responsabilité collective et le cadre dans lequel les décisions sont prises est clairement défini. À partir de là, Syriza est le parti gouvernemental, il joue un rôle important sur la scène politique et se doit, en respectant sa propre « Constitution », c’est-à-dire ses statuts, dans un cadre démocratique, de prendre des décisions. Il y a un décalage lié à la « violente maturation » de Syriza, qui est passé très vite d’un parti à 4% à un parti dans lequel une grande majorité du peuple grec place ses espoirs et ses attentes. C’est un parti de 30 000, soutenu par 3 millions de citoyens. Malgré tout, les partis doivent fonctionner dans les cadres fixés par leurs statuts. Nous devons mener la discussion, pour savoir si Syriza doit s’ouvrir, être en phase avec les angoisses, les espoirs de sa base sociale. Nous ne l’avons pas fait plus tôt, c’est une faute de notre part. Ce débat est désormais ouvert et les 30 000 membres de Syriza devront prendre des décisions.
Si Syriza s’ouvre il devra changer. Aujourd’hui, Syriza est perçu comme un parti de la gauche radicale. Doit-il le rester, devenir un grand parti progressiste ou un parti social-démocrate ?
Alexis Tsipras. Cette pensée ne traverse l’esprit de personne à Syriza. Pourquoi la posez-vous donc ici ?
Parce que c’est une crainte qui s’exprime.
Alexis Tsipras. Une crainte ou un désir ?
J’imagine que beaucoup souhaitent voir Syriza devenir un parti social-démocrate.
Alexis Tsipras. La social-démocratie à deux expressions en Grèce [Le Pasok et le Mouvement des démocrates socialistes de Georges Papandréou, NDLR], trois en comptant Dimar [Parti pro-mémorandum issu d'une scission de Syriza, NDLR], peut-être plus si d’autres partis se créent. La social-démocratie se trouve dans une impasse stratégique, pourquoi Syriza voudrait-il s’engager dans cette impasse stratégique ? Personne au sein de Syriza ne souhaite cela. Nous ne devons pas nous cacher les problèmes mais y faire face avec honnêteté. Il y a deux ans, en juillet 2013, Syriza tenait son premier congrès. Notre principal but était de créer un parti uni, un parti du futur. Il faut reconnaître que Syriza n’est pas devenu un parti uni. L’effort pour transformer une coalition en parti unitaire était honnête mais nous ne sommes pas parvenus au résultat recherché.
La responsabilité est partagée par tous…
Alexis Tsipras. Bien sûr ! Je suis le premier à l’assumer.
Syriza compte de nombreuses tendances, malgré la décision de former un parti uni.
Alexis Tsipras. C’est une réalité. Où se situent les responsabilités ? C’est une discussion. Mais regardons la réalité, demandons-nous comment résoudre ce problème. Un cadre ou un membre du parti qui n’appartient à aucune des tendances constituées n’a pas les mêmes droits que les autres. Tel que je le comprends, cette personne est exclue du processus de décision. Elle n’est même pas tenue informée. C’est dans ce sens que nous devons voir et juger les choses, calmement, à froid, en camarades. Le Secrétariat politique n’est pas le seul centre de décision, il en existe beaucoup d’autres, ces centres s’entrecroisent. Voilà la réalité que nous devons affronter. Pour certains, cette réalité peut être le modèle de fonctionnement moderne d’un parti déterminé. Je peux accepter cela aussi. Mais alors, mettons-y des conditions et des règles. Mon opinion est que cela peut fonctionner, être positif dans le cadre d’un parti pluraliste dans l’opposition. Mais quand un parti exerce le pouvoir, ce modèle n’est pas limité aux affaires internes, il est transposé au Parlement, cela ne peut pas fonctionner. Un parti ne peut pas, quand il est au gouvernement et qu’il s’appuie sur une majorité de 161 sièges, dans le cadre d’un gouvernement de coalition, fonctionner avec des centres de pouvoir parallèles. Qu’il y est une réunion du groupe parlementaire et des réunions dans des hôtels pour que certains députés décident de leur position, cela ne peut pas fonctionner. Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Je dis simplement que ça ne peut pas être efficace. On ne peut pas avoir une majorité gouvernementale à la carte. Un coup avec ceux-là, un coup avec les autres. Je ne suis pas partisan du centralisme démocratique, et vous le savez. Je ne peux accepter que le pluralisme pour un parti…
Là-dessus nous sommes en désaccord.
Alexis Tsipras. Oui, vous vous êtes de l’ancienne école, je le sais. Je ne suis pas pour le centralisme démocratique ni même pour la fermeture de nos réunions. Je suis pour la transparence, pour que tous les points de vue puissent s’exprimer, être pris en compte et que nos décisions soient prises de façon démocratique. Mais lorsqu’on prend la décision de gouverner un pays, il faut le gouverner. Ce n’est pas une question d’ordre moral, ni de conscience, c’est une question d’efficacité élémentaire. Si la décision collective d’un parti est de gouverner, il faut que les décisions collectives soient respectées et soutenues par tous les députés sinon, comme le disent les statuts du groupe parlementaire, les députés qui s’y opposent doivent rendre leur siège pour le laisser au suivant. Ce n’est pas possible autrement.
Avez-vous demandé à des députés de rendre leurs sièges ?
Alexis Tsipras. Non, je ne l’ai pas fait. Ce sont des questions qui relèvent du groupe parlementaire. Mais je ne veux pas sous-estimer le problème capital posé par un désaccord stratégique que je respecte. Lorsqu’un parti n’est pas uni mais pluriel, des limites se posent quand ce parti se trouve en situation de gouverner. On ne peut pas transposer son multi-centrisme au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire. Il y a des différences de stratégie, cela ne fait pas de doute. Je les respecte, je respecte l’opinion opposée, je ne fonctionne pas avec une culture du chef, une culture qui proclame que l’autre point de vue doit être noyé, c’est pour cela que je n’ai pas demandé, de sanctions, ce que prévoient les statuts du groupe parlementaire, concernant les votes négatifs. Ce que je demande c’est que nous allions vers un processus collectif où le parti prendra des décisions. Une fois qu’elles seront prises, que l’on s’entende, que l’on fonctionne et que l’on avance. On ne peut pas dire « Je vote contre les propositions du gouvernement mais je soutiens le gouvernement ». Pour moi c’est trop surréaliste. Comme je vous l’ai dit je respecte la différence d’opinion, je suis le premier à demander des procédures collectives. Mais je ne peux pas nier le fait que j’ai été surpris, même à titre personnel, de la position de certains camarades. Certains disent qu’il ne faut pas montrer ses sentiments en politique, je ne fais pas partie de ces gens-là, je considère que les sentiments font partie de la politique et que personne ne peut les cacher. Avec beaucoup de ces camarades nous menions des combats et nous étions à la même table avec la même angoisse il y a quelques jours. Avec l’angoisse commune que l’effondrement du système bancaire signerait notre destruction politique et morale face au mouvement populaire, aux travailleurs et à l’histoire de la gauche. Nous ressentions la même angoisse dans le combat, dans la recherche de solutions. Nous nous sommes battus pour le référendum et nous connaissions l’alternative posée devant nous. Ces mêmes personnes, après le rude combat que j’ai mené pendant dix-sept heures, avec cette alternative à ma disposition, ont considéré opportun de dire le lendemain : « Bien, maintenant que tu t’es assuré que les banques ne fermeront pas et que notre destruction ne viendra pas, nous te laissons la responsabilité de cet accord et nous gardons les lauriers de la pureté idéologique ». Je ne fais pas allusion à la position politique, je le répète, je respecte les différences de stratégie, l’avis selon lequel la gauche ne peut pas gouverner le pays sous de telles conditions. Cela, je le respecte. Je ne parle ni d’opinion ni de stratégie mais des limites de nos valeurs collectives, du cadre moral dans lequel se définit la solidarité au sein d’un parti, au sein d’un gouvernement et au sein d’un groupe parlementaire. Ceux qui, la veille, partageaient mon angoisse m’ont dit, le lendemain : « Je te soutiens, mais prends seul la responsabilité du compromis, moi je garde le droit de voter contre ». Je m’attendais à ce qu’ils me disent : « Nous avons une estimation différente de notre capacité à continuer mais les valeurs élémentaires de solidarité nous imposent de soutenir le gouvernement et le Premier ministre jusqu’à ce que soit possible l’accord – parce qu’il n’existe pas encore, de voter pour tout en soulignant notre désaccord, y compris durant le vote et ensuite de demander la redéfinition de la stratégie du parti et donc du gouvernement à travers une procédure de débat collectif comme le prévoient nos statuts ». Voilà ce qu’aurait dû être une position de solidarité. Je ne comprends pas cette posture, ou plutôt je comprends qu’elle est liée à des décisions prises il y a déjà longtemps. Des décisions de rupture. Des décisions qui peuvent conduire à l’implosion. Je suis le garant de l’unité de Syriza, en tant que président du parti et j’irai jusqu’au bout de mon effort pour garantir cette unité. Mais l’unité forcée, ça n’existe nulle part.
Rien n’indique que ces décisions étaient planifiées, les choses sont arrivées rapidement. Ceux qui, au Parlement, brandissaient le oui et ceux qui brandissaient le non partageaient la même douleur…
Alexis Tsipras. La vie nous dira si mes peurs sont fondées ou injustifiées. Mais voilà quelles étaient mes attentes à l’endroit de camarades avec qui nous avons fait tant de chemin, avec nos désaccords mais toujours ensemble dans les moments difficiles. J’ai dû gérer une réalité terrible, impitoyable. Si quelqu’un pense que Tsipras, en tant que Premier ministre, le 12 juillet, avait d’autres choix et qu’il a décidé de ne pas les suivre pour trahir ses principes et maintenir le pays dans l’asphyxie, qu’il l’explique publiquement, sans manipulations. Et qu’il nous dise quel était ce plan alternatif. Quel était donc ce plan que j’aurais choisi de ne pas suivre ? Posons ce débat en toute honnêteté. Pas en proférant des accusations d’apostasie. Discutons de la monnaie, de l’orientation européenne du pays ! Mais en des termes structurés, qui tiennent la route, pas seulement en théorie mais en pratique aussi. Dans le programme de Syriza, notre priorité absolue est d’empêcher la catastrophe humanitaire. Si notre plan théorique ne prend pas en compte cette priorité alors c’est un plan sans fondement. Je n’ai pas demandé au peuple grec de voter « non » pour aller à la drachme. Et pour autant que je sache, la majorité du peuple grec n’a pas compris la question du référendum en ces termes. Dire que ce grand « non » était un grand « oui » à la drachme, c’est manipuler la vérité. Manipulation que nous n’avons pas le droit de faire face à notre histoire, à nos combats, à notre dialogue démocratique entre égaux. Nous n’avons pas le droit d’essayer de régler nos différences dans un tel cadre.
Vous posez la question de vos rapports – non pas au niveau personnel, mais institutionnel, avec le Parlement et avec sa présidente, Zoé Konstantopoulou.
Alexis Tsipras. J’ai exprimé ma préoccupation, tant à elle en personne que publiquement. Nos relations sont des relations d’estime, il n’y a aucun doute là-dessus. À partir de là, les choix de chacune et de chacun, notamment lorsqu’on occupe des responsabilités institutionnelles, produisent des résultats. De facto. Se trouver face à quelqu’un qui vous dit : « Je te dénonce pour te protéger », c’est surréaliste. Je ne suis pas un enfant, j’ai d’autres façons de me protéger [Rires]. Maintenant, si cela induit un mauvais fonctionnement institutionnel nous en jugerons dans la prochaine période. Si la volonté est de jouer la guérilla pour finir par voter, épuisés, à six heures du matin, en dormant sur les bancs de la Vouli, afin de montrer que de cette façon, on résiste à la Troïka, que dire ? Ce sont des enfantillages.
Quelles est la position du président de la République face à la crise ?
Alexis Tsipras. Le président de la République, avec beaucoup d’angoisse, s’est positionné sur ces décisions difficiles et il respecte scrupuleusement le cadre institutionnel de ses prérogatives. Je me souviens que tout le monde lui était tombé dessus, lui demandant de ne pas accepter le référendum. Il a fait son devoir, comme le définissait la Constitution, mais au-delà du cadre constitutionnel, au-delà des clichés institutionnels et du protocole, je pense qu’il ressent une sincère angoisse pour le pays. Une angoisse qu’il me communique quotidiennement. Nous avons des opinions différentes mais c’est une collaboration exceptionnelle.
Faut-il aller à des élections législatives anticipées ?
Alexis Tsipras. J’aurais été le dernier à vouloir des élections, si nous avions une majorité parlementaire garantie, pour aller jusqu’à la fin du programme et à la sortie des memoranda, tout en menant le combat afin d’être jugés non pas sur des intentions, mais sur une politique de confrontation avec l’oligarchie, de respiration, de redistribution, de soutien aux plus faibles. Mais si nous n’avons pas la majorité parlementaire je serai obligé, nous serons obligés d’aller vers des élections. Cela tiendra en grande partie aux décisions prises au niveau du parti, étant données les dissensions exprimées au sein du comité central et du groupe parlementaire.
Quelle est votre proposition au niveau du Comité Central ?
Alexis Tsipras. Je pense que ma proposition est une proposition logique. Nous avons un parti, avec des membres, il faut leur faire confiance, entendre leurs réponses, de façon ordonnée, démocratique. Qu’il y ait une procédure structurée, pour un congrès extraordinaire, étant donné que ce sont des conditions d’urgences qui se profilent. Les procédures devraient être lancées juste après les vacances d’été, dès septembre il faut qu’il y ait un congrès, que soient élus des délégués appelés à trancher des désaccords stratégiques critiques, à définir la voie de la gauche à partir de maintenant, le nouveau plan stratégique, le nouveau programme. À partir de là, si des membres du Comité Central exigent que le parti se positionne immédiatement, avant la conclusion de l’accord… j’aurai une bombe entre les mains [rires]. Mais enfin si telle est l’exigence, la moindre des choses serait que ce débat crucial pour le futur de la gauche et pour le futur du pays ne soit pas simplement posé au niveau de la direction du parti. Que les adhérents s’expriment. Et comme en si peu de temps il n’existe pas d’autre moyen de leur demander leur avis que par un bulletin. Si telle est l’exigence, la démocratie étant toujours la solution, comme le peuple, le parti devrait voter et décider rapidement. Ce qui n’invalide pas pour autant la proposition d’un congrès extraordinaire par la suite, pour résoudre les problèmes de stratégie.
Une dernière question. Durant tout ce parcours, depuis cinq mois, quelle a été votre erreur ?
Alexis Tsipras. S’il n’y en avait qu’une je serais un homme heureux ! [Rires]
La plus grande?
Alexis Tsipras. Ce n’est que plus tard que quelqu’un pourra en juger. Disons que cette confrontation frontale avec les principaux pouvoirs en Europe, aurait dû avoir lieu plus tôt. Nous avons été emportés après le 20 février dans une négociation qui était une guerre d’usure. Je dois avouer cependant qu’il n’est pas facile de prendre la décision de dire : « Je ne paye pas, advienne que pourra. » C’est une décision très difficile. Cependant, rétrospectivement, il était certain que nous en arriverions là mais vous savez, l’espoir meurt en dernier. Il y avait toujours l’espoir que l’attachement aux principes démocratiques, que les manifestations des peuples nous offriraient une issue, un cadre pour une solution. Ça n’a pas été le cas.
"C’est beau la naïveté quand même…
Cependant, je le répète, je me sens fier de ce semestre, du combat mené. Il y a eu bien sûr des erreurs. Je crois que malgré les difficultés nous n’en sommes pas arrivés au point où ces erreurs ont mené à une catastrophe irréversible. Tout est réversible. Je pense que nous avons devant nous une voie très accidentée faite de combats constants et de revendications, afin de réussir le mieux possible pour les intérêts du peuple. Tel est notre but.
Source : Kostas Arvanitis, retranscrit et traduit par Theodoros Koutsaftis, pour L’Humanité, le 31 juillet 2015.
Source : https://youtu.be/oDkcN3kb310
=============================================
Dans le cadre de ce que j’appelle le syndrome d’Athènes, je rappelle qu’on est encore bien loin d’avoir 50 % de Grecs souhaitant sortir de l’euro (36 % actuellement, lire ce papier de Sapir)
Et je répète, c’est très dur pour un pays faible de quitter une monnaie unique.
Pour comprendre, je vous cite ce mail reçu d’une Française en Grèce à propos de la sortie de l’euro, répondant au fait de savoir si l’euro était juste un symbole pour les Grecs :
Ce n’est pas un symbole. Chacun voit midi a sa porte: ceux qui ont encore qques économies a la banque (en Grèce) tremblent de voir leur argent transforme en drachmes dévaluées le jour même; ceux qui possèdent des sociétés (PME) ont leur capital en Euros a la banque en Grèce et tremblent pour la même raison; si nos revenus –salaires, retraites ou autres- sont en drachmes, tout achat d’un produit étranger deviendra inaccessible (par ex je vais en France 2 fois/an voir ma mère, comment acheter un billet d’avion si mes revenus sont en drachmes? Ce sera absolument inabordable); la plupart des produits consommés en Grèce sont importés, comment les payer avec une monnaie qui ne vaut plus rien? Énergie, aliments pour le bétail, pâte a papier, tout est importé… rien n’a été fait ces dernières décennies pour rendre le pays autonome dans un quelconque domaine (développement de énergie solaire ou éolienne par ex. On importe du pétrole pour en faire du courant électrique, normal: les armateurs transportent, raffinent, revendent…).Ajoutez a cela qu’en cas de retour a une monnaie nationale, les Grecs qui ont mis des millions ou même seulement des centaines de milliers d’Euros dans des banques étrangères pourront acheter tout le pays, terrains, immobilier. Eux seraient les véritables gagnants. De même pour les autres Européens, les Allemands débarqueraient pour de bon, achetant en Euros le patrimoine immobilier grec… La colonisation serait totale.source:les-crises.fr
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 4 Août 2015 à 07:35
Juste avant la victoire de Syriza aux élections, Alexis Tsipras avait demandé à son futur ministre des Finances de plancher sur une alternative à l'euro. Rocambolesque.
 Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec, le 10 juillet 2015 à Athènes. (LOUISA GOULIAMAKI/AFP)
Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec, le 10 juillet 2015 à Athènes. (LOUISA GOULIAMAKI/AFP)Il y avait bien un plan B à Athènes. Et pas n'importe lequel. Alors qu'il était ministre des Finances du gouvernement Tsipras, en plein bras de fer avec les Européens, Yanis Varoufakis a créé un cabinet secret, qui avait notamment pour mission de réfléchir aux alternatives, au cas où il faudrait passer de l'euro à la drachme. Varoufakis voulait aussi développer un système bancaire alternatif. Et cela supposait de… pirater sa propre administration fiscale !
L'affaire, pour le moins explosive à Athènes, a été révélée dimanche 26 juillet par "Ekathimerini". Ce journal grec a retranscrit une conférence téléphonique entre Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances britannique Norman Lamont, et des financiers. Elle a eu lieu le 16 juillet, soit une semaine après le départ de Varoufakis du gouvernement.
Depuis, le contenu de cette conversation a été confirmé par Varoufakis et par deux responsables de fonds spéculatifs qui y ont participé, révèle le "Télégraph" (en anglais). A Athènes, les principaux partis d'opposition (Nouvelle Démocratie, To Potami et le Pasok) se sont réunis en urgence pour évoquer l'affaire. "Ils veulent me faire passer pour un escroc, répond Varoufakis, et me faire tomber pour trahison."
Un système bancaire parallèle
L'histoire racontée par l'ancien ministre aux financiers dépasse la fiction.
"Le Premier ministre, avant qu'il ne devienne Premier ministre, avant que nous ne gagnions l'élection en janvier, m'avait donné son feu vert pour mettre au point un plan B, débute Varoufakis. J'ai réuni une équipe très compétente, restreinte vu qu'il fallait garder ce projet secret pour des raisons évidentes. Nous avions travaillé depuis décembre ou début janvier."
L'économiste affirme que le plan était "presque achevé", mais que pour le mener à bien, il avait besoin d'agrandir son équipe de 5 à 1.000 personnes. Là n'est pas la seule difficulté :
"Notre plan se déroulait sur plusieurs fronts, poursuit l'ex-ministre, je ne vous en présenterai qu'un seul. Prenez le cas des premiers instants où les banques sont fermées. Les distributeurs de billet ne fonctionnent plus et il faut mettre en œuvre un système de paiement parallèle pour continuer à faire tourner l'économie pendant un temps, et donner le sentiment à la population que l'Etat a le contrôle, qu'il y a un plan. Nous avions prévu cela."
Le plan de Varoufakis consistait à créer des comptes bancaires de réserve pour chaque contribuable, en fonction de son numéro fiscal. Il suffirait d'envoyer à chaque contribuable un mot de passe pour qu'il se connecte sur le site des impôts et passe des virements.
"Cela aurait créé un système bancaire parallèle lors de la fermeture des banques résultant de l'action agressive de la BCE de nous priver d'oxygène. C'était très avancé et je pense que cela aurait fait la différence, parce que rapidement, nous aurions pu l'étendre, utiliser des applications sur smartphone, et cela aurait pu devenir un système parallèle qui fonctionne, bien sûr avec une dénomination en euro, mais qui pourrait être converti en drachme en un clin d'œil."
Un obstacle : la troïka
Seulement, pour faire cela, le gouvernement grec aurait dû surmonter de sérieux obstacles institutionnels.
"C'est assez fascinant, poursuit Varoufakis aux financiers. La direction générale des finances publiques, au sein de mon ministère, était contrôlée entièrement et directement par la troïka. Elle n'était pas contrôlée par mon ministère, par moi, ministre, elle était contrôlée par Bruxelles. Le directeur général est désigné via une procédure sous le contrôle de la troïka. Imaginez, c'est comme si les finances étaient contrôlées par Bruxelles au Royaume-Uni. Je suis sûr que ca vous hérisse le poil d'entendre cela."
Le ministre fait alors appel à un "ami d'enfance", professeur d'informatique à l'Université de Columbia, qu'il nomme directeur général des systèmes d'information.
"Au bout d'une semaine, il m'appelle et me dit : 'Tu sais quoi ? Je contrôle les machines, le matériel, mais je ne contrôle pas les logiciels. Ils appartiennent à la Troïka. Qu'est-ce que je fais ?'"
Les deux amis se voient discrètement. Pas question de demander officiellement à la direction des finances publiques l'autorisation d'accéder au système, cela pourrait susciter des soupçons.
Nous avons décidé de pirater le programme informatique de mon propre ministère afin de pouvoir copier, juste copier, le code du site internet des impôts sur un gros ordinateur de son bureau, pour pouvoir travailler sur la conception et le développement d'un système parallèle de paiement. Et nous étions prêts à obtenir le feu vert du Premier ministre, lorsque les banques fermeraient, pour nous rendre à la direction générale des finances publiques qui est contrôlée par Bruxelles et à y brancher son ordinateur portable pour activer le système."
Voilà qui en dit long sur l'ampleur des enjeux auxquels doivent faire face le gouvernement grec et sur la complexité de la relation entre Athènes et Bruxelles.
"Ce que j'essaie de vous décrire, c'est le genre de problèmes institutionnels que nous avons rencontré, les obstacles institutionnels qui nous empêchaient de mener une politique indépendante pour contrer effets de la fermeture de nos banques par la BCE."
Varoufakis savait que la conversation était enregistrée. "Il y a surement d'autres personnes qui écoutent, mais ils ne diront rien à leurs amis", avait mis en garde Normal Lamont alors que Varoufakis commençait à entrer dans les détails. "Je sais. Même s'ils le faisaient, je nierais avoir dit cela", avait répondu le grec sur le coup. Depuis la publication de la conversation, il se défend :
"C'est une tentative d'annuler les cinq premiers mois de ce gouvernement et de les mettre dans la poubelle de l'Histoire", a-t-il déclaré au 'Télégraph'. J'ai toujours été totalement contre un démantèlement de l'euro, car on ne sait jamais quelles forces maléfiques peuvent se réveiller en Europe."
L'ancien ministre a aussi publié un communiqué officiel. Il s'en prend au journal grec :
"L'article fait référence au projet du ministre comme l'a décrit le ministre le 6 juillet dans son discours de départ pendant la passation des pouvoirs. Dans ce discours, Varoufakis déclare clairement : 'Le secrétariat général à l'informatique a commencé à étudier les moyens de faire de Taxisnet quelque chose de plus important, un système de paiement pour tiers, un système qui augmente l'efficacité et minimise les arriérés de l'Etat aux citoyens et vice-versa.' Ce projet ne faisait pas partie du programme du groupe de travail, a été présenté entièrement par le ministre Varoufakis au cabinet et devrait, selon le ministre Varoufakis, être mis à exécution indépendamment des négociations avec les créanciers de la Grèce, car cela contribuera à améliorer considérablement l'efficacité des transactions entre l'Etat et les contribuables et entre les contribuables."
Le projet de Schaüble
Le journal "Ekathimerini" cite aussi un extrait où Varoufakis évoque le ministre des Finances allemand :
"Schaüble a un plan. Ce qu'il m'en a décrit est très simple. Il croît que l'eurozone n'est pas viable. Il pense qu'il faut des transferts budgétaires, et un certain degré d'union politique. Il croit que pour que cette union politique fonctionne sans fédération, sans la légitimité qu'un parlement fédéral, élu en bonne et due forme, peut assurer, notamment face à un exécutif, la seule solution est la discipline. Et il m'a dit explicitement qu'un Grexit sera l'élément qui lui permettra de négocier, qui lui donnera suffisamment de puissance, de quoi faire peur, afin d'imposer aux Français ce contre quoi Paris a résisté. Et de quoi s'agit-il ? Un degré de transfert budgétaire qui fait passer le pouvoir de Paris à Bruxelles."
Dans le "Telegraph", Varoufakis va plus loin, affirmant que Schaüble a fini par penser que la Grèce devait être expulsée de l'euro, qu'elle ne faisait qu'attendre son heure, sachant que le dernier plan de renflouement était voué à l'échec.
"Tout le monde sait que le Fonds monétaire international ne veut pas participer au nouveau programme mais Schaüble insiste pour en faire la condition de nouveaux prêts. J'ai le fort pressentiment qu'il n'y aura pas d'accord de financement le 20 août."
Selon Varoufakis, les indicateurs économiques se révéleront mauvais à la fin de l'année en Grèce.
"Schaüble dira alors qu'il s'agit d'un nouvel échec. Il nous enfume. Il n'a pas renoncé à pousser la Grèce hors de l'euro."
"Des enjeux opérationnels"
James K. Galbraith, économiste britannique de renom et proche de Varoufakis, a révélé lundi qu'il faisait partie de son équipe secrète. Et il précise son rôle, sous la forme de six déclarations :
- "A aucun moment le groupe de travail ne s'est engagé pour un Grexit ou tout autre choix de politique. Le travail était uniquement d'étudier les enjeux opérationnels qui se poseraient si la Grèce était forcée d'émettre de nouveaux papiers ou si elle était forcée à quitter l'euro.
- Le groupe a opéré en supposant que le gouvernement était entièrement décidé à négocier dans le cadre de l'euro, et a pris des précautions extrêmes pour ne pas mettre en jeu cette engagement en laissant filtrer au monde extérieur des indices de notre travail. Il n'y a eu aucune fuite, jusqu'à la révélation de l'existence du groupe, révélée par l'ancien ministre lui-même, en réponse aux critiques selon lesquelles son ministère n'avait pas préparé de plan de sortie alors qu'il savait que la sortie forcée de l'euro était une option.
- L'existence de plans n'auraient pas pu jouer de rôle dans la position grecque dans les négociations, puisque leur circulation (avant qu'il n'y ait eu besoin de les mettre en exécution) aurait destabilisé la politique du gouvernement.
- En dehors d'une conversation téléphonique tardive et non-concluante entre le député Costas Lapavitsas et moi, il n'y a eu aucune coordination avec la "plateforme de gauche" et les idées de notre groupe de travail avaient très peu en commun avec les leurs.
- Notre travail s'est terminé pour des raisons pratiques début mai, par un long memo exposant les questions principales et les scénarios que nous avons étudiés.
- Mon travail n'a été ni rémunéré ni officiel, fondé sur mon amitié pour Yanis Varoufakis et mon respect pour la cause du peuple grec."
Donald Hébert
source: tempsreel.nouvelobs.com
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 31 Juillet 2015 à 08:26
 La menace d’une inculpation pour Haute Trahison pesant désormais sur Yanis Varoufakis a quelque chose d’absurde, mais aussi de terriblement révélateur[1]. Elle éclaire de manière crue le faite que la zone Euro est désormais devenue un monstre, ou plus précisément un tyran qui s’est dégagé de toute règle.
La menace d’une inculpation pour Haute Trahison pesant désormais sur Yanis Varoufakis a quelque chose d’absurde, mais aussi de terriblement révélateur[1]. Elle éclaire de manière crue le faite que la zone Euro est désormais devenue un monstre, ou plus précisément un tyran qui s’est dégagé de toute règle.Les faits
Yanis Varoufakis, en tant que Ministre des finances, a pris la décision de faire pénétrer clandestinement le système informatique de l’administration fiscale grecque. On a rendu compte de ce « plan B » dans ce carnet[2], et c’est ce qui lui est reproché. Mais, il a pris cette décision en accord avec le Premier ministre, Alexis Tsipras. Il a pris cette décision concernant le système informatique de l’administration fiscale grecque parce que ce dernier était en réalité sous le contrôle d’hommes de la « Troïka », c’est à dire du Fond Monétaire International, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne. C’est donc le Premier ministre conservateur, M. Samaras, battu lors des élections du 25 janvier, qui a en réalité commis cet acte de Haute Trahison en confiant l’administration fiscale à une (ou des) puissances étrangères. C’est lui, et lui seul, qui porte la totale responsabilité de ce qui est alors survenu.
Cette décision avait pour but de mettre en œuvre un système de paiements parallèles qui aurait permis au gouvernement grec de contourner le blocage des banques qui fut organisé par la BCE à partir de la fin juin 2015. Ceci aurait été nécessaire pour éviter la destruction du système bancaire grecque qu’a provoquée l’action de la Banque Centrale Européenne. Cette action illégale de la BCE a mis en péril le système bancaire alors que l’une de ses missions, inscrites dans la charte de la BCE est justement d’assurer le bon fonctionnement de ce système bancaire. Si Yanis Varoufakis doit être inculpé, il serait logique, il serait juste, que le Président de la BCE M. Draghi ainsi que le Président de l’Eurogroupe, M. Dijsselbloem, le soient aussi.
Il est exact que ce système parallèle de paiements aurait aussi pu permettre un glissement très rapide de l’Euro vers la Drachme, mais Varoufakis, selon les propos rapporté par The Telegraph, n’envisageait cela qu’en toute dernière extrémité[3].
Une décision absurde.
Inculper M. Varoufakis est ainsi absurde. Le fait qu’il soit désormais défendu par des personnalités comme Mohamed El-Erian, l’économiste en chef d’Allianz et Président d’un comité d’experts économiques auprès du Président des Etats-Unis[4], montre bien que ce qu’il a fait, il l’a fait pour le plus grand bien de l’Etat qu’il servait comme Ministre des finances. Cette inculpation, si elle devait de confirmer, ne pourrait avoir lieu qu’avec la complicité d’Alexis Tsipras qui aurait alors lâché son ancien Ministre des finances, et qui n’assumerait pas ses responsabilités. Cette inculpation, si elle survenait, serait un acte odieux, un acte de pure justice politique, de vengeance des autorités européennes contre un homme qui a osé, appuyé par son peuple, les défier.
Cette inculpation serait aussi quelque chose de très révélateur de l’attitude néo-coloniale qu’ont les autorités européennes aujourd’hui vis-à-vis de la Grèce, mais aussi d’autre pays. Stefano Fassina, ancien Vice-Ministre des finances du gouvernement italien, membre du Parlement de ce pays et l’un des membres éminents du Parti Démocrate actuellement au pouvoir, a écrit dans un texte qui a été publié sur le blog de Yanis Varoufakis[5] : « Alexis Tsipras, Syriza et le peuple grec ont eu le mérite historique indéniable d’arracher le voile de rhétorique Européiste et d’objectivité technique qui n’a pour but que de masquer la dynamique de la zone Euro »[6]. Il ajoute aussi : « Nous devons reconnaître que l’Euro fut une erreur de perspective politique. Il nous faut admettre que dans la cage néo-libérale de l’Euro, la Gauche perd sa fonction historique et qu’elle est morte comme force servant la dignité et l’importance politique du travail ainsi que de la citoyenneté sociale en tant qu’instrument d’une démocratie réelle »[7]. Il conclut enfin en écrivant : « Pour une désintégration qui soit gérée de la monnaie unique, nous devons construire une large alliance de fronts de libération nationale »[8].
Cette perspective est aujourd’hui entièrement justifiée. La zone Euro s’est bien révélée une machine de guerre au service d’une idéologie, le néo-libéralisme, et au service d’intérêts particuliers, ceux de la finance, et d’une oligarchie sans frontières. La perspective offerte par Stefano Fassina est bien celle que nous avons aujourd’hui devant nous, soit la constitution d’une « alliance des fronts de libération nationale » des pays de la zone Euro pour faire plier le tyran, et pour démanteler la zone Euro.
Jacques Sapir-le 30/07/2015
Notes
[1] Evans-Pritchards A., « European ‘alliance of national liberation fronts’ emerges to avenge Greek defeat », The Telegraph, 29 juillet 2015, http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11768134/European-allince-of-national-liberation-fronts-emerges-to-avenge-Greek-defeat.html
[2] http://russeurope.hypotheses.org/4148
[3] http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11764018/Varoufakis-reveals-cloak-and-dagger-Plan-B-for-Greece-awaits-treason-charges.html
[4] http://www.project-syndicate.org/commentary/varoufakis-agenda-defended-by-mohamed-a–el-erian-2015-07
[5] Voir Fassina S., « For an alliance of national liberationfronts », article publié sur le blog de Yanis Varoufakis par Stefano Fassina, membre du Parlement (PD), le 27 juillet 2015, http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/27/for-an-alliance-of-national-liberation-fronts-by-stefano-fassina-mp/
[6] Alexis Tsipras, Syriza and the Greek people have the undeniable historical merit of having ripped away the veil of Europeanist rhetoric and technical objectivity aimed at covering up the dynamics in the eurozone
[7] We need to admit that in the neo-liberal cage of the euro, the left loses its historical function and is dead as a force committed to the dignity and political relevance of labour and to social citizenship as a vehicle of effective democracy.
[8] For a managed dis-integration of the single currency, we must build a broad alliance of national liberation fronts
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 29 Juillet 2015 à 12:36
Entretien inédit pour le site de Ballast
Résumons à très grands traits. Le 25 janvier 2015, Syriza remporte les élections législatives grecques sur un programme de rupture ; le 5 juillet, c’est un tonitruant « OXI », à 61 %, qui envoie les petits barons de l'ordre européen dans les cordes ; le lendemain, Yánis Varoufákis, ministre des Finances grec, est poussé vers la sortie ; le lundi 13 juillet, le tout-venant apprend que les dix-huit heures de bataille psychologique, à la fameuse « table des négociations », ont eu raison des espoirs mis dans le gouvernement grec : capitulation en rase campagne, entend-on. La couleuvre de l’austérité avalée contre un hypothétique rééchelonnement de la dette. « J’assume la responsabilité d’un texte auquel je ne crois pas », affirme Tsipras à la télévision publique grecque. Mercredi, le comité central de Syriza rejette l’accord et dénonce « un coup d’État contre toute notion de démocratie et de souveraineté populaire ». Les ministères démissionnaires partent en claquant la porte, le texte passe avec les voix de la droite et de la social-démocratie grecques, les grèves générales repartent et la place Syntagma s’enflamme. « Trahison » ; la messe est dite. Pour Stathis Kouvélakis, philosophe francophone, membre du Comité central de Syriza et figure de la Plateforme de gauche, l’équation s'avère toutefois plus complexe, si l'on tient à prendre toute la mesure de ces récents événements. Entretien pour y voir plus clair et, surtout, organiser la riposte.
 Vous émettez des réserves quant à la critique de Tsipras en termes de « trahison », qui revient pourtant fréquemment dans les gauches radicales européennes depuis l’accord du 12 juillet. Pourquoi la considérez-vous comme inefficace ?
Vous émettez des réserves quant à la critique de Tsipras en termes de « trahison », qui revient pourtant fréquemment dans les gauches radicales européennes depuis l’accord du 12 juillet. Pourquoi la considérez-vous comme inefficace ?Je ne nie pas que le terme de « trahison » soit adéquat pour traduire une perception spontanée de l’expérience Syriza. Il est évident que les 62 % qui ont voté « non » au référendum et les millions de gens qui ont cru en Syriza se sentent trahis. Néanmoins, je nie la pertinence analytique de la catégorie de trahison car elle repose sur l’idée d’une intention consciente : consciemment, le gouvernement Tsipras aurait fait le contraire de ce qu’il s’était engagé à faire. Je pense que cette catégorie obscurcit la réalité de la séquence en cours, qui consiste dans la faillite d’une stratégie politique bien précise. Et quand une stratégie fait faillite, les acteurs qui en étaient les porteurs se retrouvent uniquement face à de mauvais choix ou, autrement dit, à une absence de choix. Et c’est très exactement ce qui s’est passé avec Tsipras et le cercle dirigeant du gouvernement. Ils ont cru possible de parvenir à un compromis acceptable en jouant cette carte de la négociation – qui combinait une adaptation réaliste et une fermeté quant à des lignes rouges, dans le but d’obtenir un « compromis honorable ».
Or la Troïka des créanciers n’était nullement disposée à céder quoi que ce soit, et a immédiatement réagi, en mettant dès le 4 février le système bancaire grec au régime sec. Tsipras et le gouvernement, refusant toute mesure unilatérale, comme la suspension du remboursement de la dette ou la menace d’un « plan B » impliquant la sortie de l’euro, se sont rapidement enfermés dans une spirale qui les amenait d’une concession à une autre et à une détérioration constante du rapport de force. Pendant que ces négociations épuisantes se déroulaient, les caisses de l’État grec se vidaient et le peuple se démobilisait – réduit à un état de spectateur passif d’un théâtre lointain sur lequel il n’avait prise. Ainsi, quand Tsipras affirme le 13 juillet qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer cet accord, il a en un sens raison. À condition de préciser qu’il a fait en sorte de ne pas se retrouver avec d’autres choix possibles. Dans le cas précis de la Grèce, on assiste à une faillite flagrante de cette stratégie pour la simple raison qu’elle n’avait prévu aucune solution de repli. Il y a un véritable aveuglement de Tsipras et la majorité de Syriza dans l’illusion européiste : l’idée qu’entre « bons européens », nous finirons par nous entendre même si, par ailleurs, demeurent des désaccords importants ; une croyance dure comme fer que les autres gouvernements européens allaient respecter le mandat légitime de Syriza. Et, pire encore, l’idée de brandir l’absence de « plan B » comme un certificat de bonne conduite européiste, qui fut le comble de cet aveuglement idéologique...
La notion de « trahison » empêche d’analyser et de remettre en cause la stratégie ; elle empêche de parler en termes d’analyse stratégique et point aveugle idéologique ; elle rabat tout sur les « intentions des acteurs » – qui resteront toujours une boîte noire – et se fonde sur l’illusion naïve selon laquelle ceux-ci sont maîtres de leurs actes. Par ailleurs, elle empêche de saisir le cœur du problème, à savoir l’impuissance de cette politique : la violence de la réaction d’un adversaire a été sous-estimée alors même que le gouvernement Syriza, par son existence même, était allé suffisamment loin pour la déclencher.
De plus en plus de voix s’élèvent dans l’Europe du Sud pour dénoncer le carcan de la monnaie unique. Ce débat a-t-il sérieusement eu lieu au sein du gouvernement Tsipras et de Syriza ? Yánis Varoufákis, après avoir démissionné, a affirmé avoir proposé un plan de sortie de l’euro ou, du moins, la mise en circulation d’une monnaie nationale au plus dur des négociations.
Ce débat n’a jamais véritablement eu lieu — ou, plutôt, il n’a eu lieu que de façon limitée, au sein de Syriza, pendant les cinq dernières années. Et ce fut toujours contre la volonté de la majorité de la direction du parti, par une sorte d’état de fait créé par le positionnement d’une minorité substantielle en faveur d’une sortie de l’euro, comme condition nécessaire pour la rupture avec les politiques d’austérité et le néolibéralisme. La majorité de la direction du parti n’a jamais vraiment accepté la légitimité de ce débat. La sortie de l’euro n’était pas présentée comme une option politique critiquable avec des inconvénients qui justifiaient un désaccord. Elle était purement et simplement identifiée à une catastrophe absolue. Systématiquement, il nous était reproché que si nous défendions la sortie de l’euro, nous étions des crypto-nationalistes ou que la sortie de l’euro entraînerait un effondrement du pouvoir d’achat des classes populaires et de l’économie du pays. En réalité, c’étaient les arguments du discours dominant qui était repris par nos camarades. Ils ne cherchaient donc pas un véritable débat argumenté mais à nous disqualifier symboliquement, à disqualifier la légitimité de nos arguments à l’intérieur de Syriza et de la gauche radicale. Ainsi, quand Syriza est arrivé au pouvoir, la question s’est posée par la logique même de la situation, puisqu’il est rapidement devenu évident que ces négociations n’aboutissaient à rien. Déjà, l’accord du 20 février indiquait bien que Syriza était contraint de reculer au cours de ce bras de fer. Mais cette discussion s’est déroulée à huis clos : jamais de façon publique et jamais avec le sérieux nécessaire — si l’on excepte bien sûr les prises de position de la Plateforme de gauche de Syriza.
Yánis Varoufákis, de son côté, avait posé à divers moments la question d’un plan B. Panayótis Lafazánis et la Plateforme de gauche mettaient régulièrement sur la table ces propositions. Il faut préciser que le plan B ne se limite pas simplement à la reprise d’une souveraineté monétaire. Il met en avant l’interruption du remboursement des créanciers, le placement des banques sous contrôle public et un contrôle de capitaux au moment du déclenchement de l’affrontement. C’était, d’une façon générale, prendre l’initiative plutôt que d’être à la traîne de négociations qui amenaient un recul après l’autre. Le gouvernement n’a même pas fait les gestes minimaux afin d’être en mesure de tenir bon quand les Européens appuyèrent sur le bouton nucléaire, c’est-à-dire en arrêtant totalement l’approvisionnement en liquidité avec l’annonce du référendum. Le référendum lui-même aurait pu être conçu comme le « volet politique » du plan B : il a donné une idée d’un scénario réaliste conduisant à la rupture avec les créanciers et la zone euro. Le raisonnement aurait pu être le suivant : Le mandat initial de Syriza, celui issu des urnes du 25 janvier, était de rompre avec l’austérité dans le cadre de l’euro ; nous avons bien vu que c’était impossible dans ce cadre ; donc nous nous présentons de nouveau devant le peuple ; le peuple confirme son mandat en disant « Non à l’austérité et faites le nécessaire ». C’est effectivement ce qui s’est passé avec la victoire écrasante du « non », lors du référendum du 5 juillet, mais il était déjà trop tard ! Les caisses étaient déjà vides et rien n’avait été fait pour préparer une solution alternative
Vous soulignez les rapports de force qui ont traversé Syriza depuis 2010. Comment expliquer que la frange acquise à l’Union européenne et l’euro l’ait emportée ?
Il faut replacer ces débats dans un cadre plus large : celui de la société grecque, et d’une façon plus générale, celui des sociétés de la périphérie européenne. Avant la crise de 2008-2010, les pays les plus europhiles au sein de l’Union européenne étaient précisément ceux du sud et de la périphérie. Il faut bien comprendre que, pour ces pays, l’adhésion à l’UE signifie une certaine modernité, à la fois économique et politique, une image de prospérité et de puissance que l’euro vient valider à un niveau symbolique. C’est l’aspect fétichiste de la monnaie que Karl Marx a souligné : en ayant la monnaie commune dans sa poche, le Grec accède symboliquement au même rang que l’Allemand ou le Français. Il y a ici quelque chose de l’ordre du « complexe du subalterne ». C’est notamment ce qui nous permet de comprendre pourquoi les élites dominantes grecques ont constamment joué avec la peur de la sortie de l’euro — leur carte maîtresse depuis la début de la crise. Tous les « sacrifices » sont justifiés au nom du maintien dans l’euro. La peur du Grexit est étrangère à la rationalité économique. Elle ne repose pas sur les conséquences éventuelles d’un retour à la monnaie nationale ; par exemple : les difficultés pour les importations ou, à l’inverse, les nouvelles facilitées à l’exportation. Au niveau du « sens commun », la sortie de l’euro charrie une sorte de tiers-mondisation symbolique. Pour le Grec moyen qui résiste à l’idée d’une sortie de la zone euro, la justification de son refus renvoie à la peur d’une régression du pays au rang de nation pauvre et retardataire – qui était effectivement le sien il y a quelques décennies. N’oublions pas que la société grecque a évolué très rapidement et que le souvenir de la misère et de la pauvreté est encore présent dans les couches populaires et dans les générations âgées.
Ce que je viens de dire explique aussi l’apparent paradoxe du vote massif du « non » chez les jeunes. Le journal Le Monde fait son reportage en disant : « Toutes ces générations des 18-30 ans qui ont grandi avec l’euro et l’Union européenne, qui ont bénéficié des programmes Erasmus et des études supérieures [le niveau d’accès à l’enseignement supérieur en Grèce est parmi les plus élevés d’Europe], comment se fait-il qu’elles se retournent contre l’Europe ? » La raison est en fait que les jeunes générations ont moins de raisons que les autres de partager ce complexe de la subalternité ! Cet « européisme » ambiant de la société grecque est resté toutefois hégémonique, y compris dans les forces d’opposition aux politiques néolibérales — à l’exception du Parti communiste, très isolé et sectaire. Et cela explique pourquoi Syriza a choisi, dès le début, de s’adapter à l’européisme et d’avoir une stratégie électoraliste à court terme plutôt que d’entrer dans un travail de pédagogie qui consisterait à dire : « Nous ne sommes pas contre l’Europe ou l’euro par principe, mais si eux sont contre nous, et qu’ils nous empêchent d’atteindre nos objectifs, il nous faudra riposter. » C’est un discours qui demandait un certain courage politique, chose dont Tsipras et la majorité de la direction de Syriza s’est révélée être totalement dépourvue.
Le référendum n’était donc en rien la possibilité d’une rupture mais un simple mouvement tactique afin de renforcer Tsipras dans les négociations ?
Tsipras est un grand tacticien. Penser que tout ce qui s’est passé est conforme à un plan préétabli serait se tromper lourdement. C’est une gestion au jour le jour de la situation qui a prévalu, sans vision stratégique autre que celle de la recherche de l’illusoire « compromis honorable » dont j’ai parlé auparavant. Le référendum a été conçu, d’emblée, comme un geste tactique, comme une issue à une impasse dans laquelle le gouvernement s’est trouvé à la fin du mois de juin, lorsque le plan Juncker a été présenté sous la forme d’un ultimatum. Mais, en annonçant le référendum, Tsipras a libéré des forces qui sont allées bien au-delà de ses intentions. Il faut ici souligner le fait que l’aile droite du gouvernement et de Syriza ont très bien perçu, elles, le potentiel conflictuel et de radicalisation que comportait objectivement la dynamique référendaire, et c’est pour cela qu’elles s’y sont fortement opposées. Je vais vous livrer une anecdote. Le jour du grand rassemblement du vendredi [3 juillet], une foule immense s’était rassemblée dans le centre-ville d’Athènes. Tsipras est allé à pied de la résidence du Premier ministre à la place Syntagma, séparées par quelques centaines de mètres. C’est une scène de type latino-américaine qui s’est produite : une foule enthousiaste s’est formée derrière lui et l’a conduit en triomphateur jusqu’à la marée humaine de la place du Parlement. Quelle a été la réaction de Tsipras ? Il a pris peur et a abrégé les trois quarts du discours qu’il avait préparé.
Vous racontez qu’Euclide Tsakalotos, ministre des Finances grecques après la démission de Yánis Varoufákis, préparait son intervention devant l’Eurogroupe comme un professeur d’université prépare sa contribution à un colloque. Ne pointez-vous pas ici un des problèmes de la gauche radicale : une parfaite analyse des phénomènes mais une incapacité à mener des rapports de force, à établir des stratégies gagnantes, à jouer sur les contradictions de l’adversaire ? Est-ce dû à la promotion des savoirs académiques au sein de la gauche radicale au détriment d’autres profils ?
Je suis très réticent par rapport aux explications sociologistes : je ne pense pas qu’elles permettent de comprendre la situation. Dans un entretien à Mediapart¹, Tsakalotos expliquait en effet que, lorsqu’il est allé à Bruxelles, il avait préparé ses argumentaires de façon très sérieuse. Il s’attendait à entendre des contre-arguments et, au lieu de cela, il s’est retrouvé face à un mur de technocrates répétant des règles et des procédures. Il avait été choqué du faible niveau de la discussion – comme s’il s’agissait d’un colloque universitaire où le meilleur argument l’emporte. Or tout en étant moi-même universitaire, et même un ancien camarade de parti de Tsakalotos (nous avons milité dans le Parti eurocommuniste grec dans les années 1980), je n’en suis pas moins en désaccord profond avec lui. Par ailleurs, s’il y avait un reproche à lui faire, c’est justement un défaut d’analyse ! La gauche, dans son ensemble, a considérablement sous-estimé la nécessité d’analyser sérieusement l’Union européenne. Au lieu de cela, nous avons eu droit, pendant des décennies, au recours à une longue litanie de vœux pieux : « l’Europe sociale », « l’Europe des citoyens », « faire bouger les lignes en Europe », etc. Ce genre de discours sont répétés inlassablement depuis des décennies alors qu’ils ont fait la preuve flagrante de leur impuissance et de leur incapacité à avoir la moindre prise sur le réel.
Une dernière remarque à propos du statut sociologique du discours européiste : je fais partie d’un département d’Études européennes dans une université britannique. Je peux vous assurer que mes collègues, qui sont du côté mainstream, qui sont donc universitaires mais qui connaissent de façon intime la machine européenne, ont toujours refusé de prendre au sérieux la vision de Syriza. Ils n’arrêtaient pas d’ironiser sur les naïfs qui pensaient qu’à coups de négociations et d’échanges de bons arguments on arriverait à rompre avec le cadre des politiques européennes, c’est-à-dire avec l’austérité et le néolibéralisme. Personne n’a pris ce discours au sérieux chez les gens informés, alors, qu’à l’inverse, il déclenchait une sorte d’extase parmi les cadres et bon nombre de militants des formations de la gauche radicale européenne. Nous avons ici affaire à une question de politique avec un grand « P », à la puissance de l’idéologie dominante et à une déficience d’analyse et de pensée stratégique, loin de toute explication réductrice en termes de position sociologique des acteurs.
Slavoj Žižek a écrit le 20 juillet que « Syriza devrait exploiter, en montrant un pragmatisme impitoyable, en pratiquant le calcul le plus glacial, les fêlures les plus minces de l’armure de l’adversaire. Syriza devrait instrumentaliser tous ceux qui résistent à la politique hégémonique de l’Union européenne, des conservateurs britanniques à l’UKIP, le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni. Syriza devrait flirter effrontément avec la Russie et la Chine, elle devrait caresser l’idée de donner une île à la Russie afin que celle-ci en fasse sa base militaire en Méditerranée, juste pour effrayer les stratèges de l’OTAN. Paraphrasons un peu Dostoïevski: maintenant que le Dieu-Union européenne a failli, tout est permis². » Y souscrivez-vous ?
Il y a ici deux questions en une. Tout d’abord, il s’agit de s’interroger sur les contradictions internes à l’Union européenne et, ensuite, de se demander que faire en dehors de ce cadre. Quant à la première, la stratégie du gouvernement Tsipras consistait justement à exploiter ses contradictions internes, réelles ou, surtout, supposées. Ils pensaient pouvoir jouer sur l’axe Hollande-Renzi – vus comme des gouvernements plus « ouverts » à une approche anti-austérité –, Mario Draghi – vu également sur une ligne divergente de l’orthodoxie rigoriste de Wolfgang Schäuble [Ministre allemand des Finances] – et, enfin, sur le facteur américain – perçu comme pouvant faire pression sur le gouvernement allemand. Tout cela s’est révélé une illusion complète. Bien entendu, il ne s’agit pas de nier l’existence de contradictions dans le bloc adverse : le FMI, par exemple, a une logique de fonctionnement et des priorités en partie distinctes de celles de la Commission européenne. Ceci dit, toutes ces forces convergent sur un point fondamental : dès qu’une menace réelle émerge, et Syriza en était une car il remettait en cause l’austérité et le néolibéralisme, toutes ces forces ont fait bloc pour la détruire politiquement. Voyons le numéro de François Hollande. Il essaie d’endosser auprès de l’opinion française un rôle soi-disant amical vis-à-vis des Grecs. En réalité, il n’a été qu’un facilitateur de l’écrasement du gouvernement grec par le gouvernement allemand : ces acteurs-là sont d’accord sur l’essentiel, à savoir sur une stratégie de classe — les divergences ne portent que sur des nuances.
Que faire maintenant, en dehors du cadre de l’Union européenne ? Penser pouvoir s’appuyer sur l’administration Obama est une fausse bonne idée, on l’a vu. Quant à la Russie, c’était sans doute une carte à explorer. Syriza l’a tentée sans vraiment y croire ; en réalité, la diplomatie russe est très conservatrice. Elle ne vise pas du tout à favoriser des ruptures dans le bloc européen. La Russie, dans ses pourparlers avec Syriza, souhaitait un gouvernement dissonant quant à l’attitude antirusse des Occidentaux suite à l’affaire ukrainienne et aux sanctions économiques. Mais à condition de rester dans le cadre de l’Union européenne et de l’euro ! En dépit de quelques bonnes paroles, la Russie n’a été, à aucun moment, un allié du gouvernement Syriza : il me semble douteux de croire qu’elle serait disposée à faire davantage si les choses étaient allées jusqu’à la rupture.
D’aucuns avancent que Tsipras temporise et attend les élections générales espagnoles de novembre pour avoir le soutien de Pablo Iglesias – en pariant sur une victoire de Podemos. Cela vous semble-t-il crédible ?
Ce genre de propos relève d’une tromperie manifeste. En signant cet accord, la Grèce est soumise à un carcan qui va bien au-delà de celui imposé par les mémorandums précédents. C’est un véritable mécanisme institutionnalisé de mise sous tutelle du pays et de démembrement de sa souveraineté. Il ne s’agit pas simplement d’une liste – comme les naïfs peuvent le croire – de mesures d’austérité très dures, mais de réformes structurelles qui remodèlent le cœur de l’appareil d’État : le gouvernement grec perd en effet le contrôle des principaux leviers de l’État. L’appareil fiscal devient une institution dite « indépendante » ; elle se retrouve en fait dans les mains de la Troïka. Un conseil de politique budgétaire est mis en place, qui est habilité à opérer des coupes automatiques sur le budget si le moindre écart est signalé par rapport aux objectifs en matière d’excédents, fixés par les mémorandums. L’agence des statistiques devient elle aussi « indépendante » ; en réalité, elle devient un appareil de surveillance en temps réel des politiques publiques directement contrôlé par la Troïka. La totalité des biens publics considérés comme privatisables sont placés sous le contrôle d’un organisme piloté par la Troïka.
Privé de tout contrôle de sa politique budgétaire et monétaire, le gouvernement grec, quelle que soit sa couleur, est désormais dépossédé de tout moyen d’agir. La seule chose qui reste sous contrôle de l’État grec est l’appareil répressif. Et on voit bien qu’il commence à être utilisé comme avant, c’est-à-dire pour réprimer des mobilisations sociales. Les gaz lacrymogènes déversés sur la place Syntagma du 15 juillet, suivis d’arrestations de militants, de passages à tabac et maintenant de procès devant les tribunaux de syndicalistes, ne sont qu’un avant-goût de ce qui nous attend lorsque la situation sociale se durcira, lorsque les saisies des résidences principales se multiplieront, lorsque les retraités subiront de nouvelles coupes dans leur retraite, lorsque les salariés seront dépossédés du peu de droits qu’ils leur restent. Le maintien du très autoritaire Yannis Panoussis comme ministre responsable de l’ordre public, et qui se voit également confier le portefeuille de l’immigration, est un signal clair du tournant répressif qui s’annonce. Ceux qui évoquent donc une stratégie de « gain de temps » ne provoquent chez moi qu’un mélange de dégoût et de révolte.
Vous analysez les résultats du référendum du 5 juillet comme un vote de classe. Pensez-vous, comme Frédéric Lordon en France, que l’Union européenne et l’euro sont l’opportunité historique donnée à la gauche radicale de reconstruire une frontière de classe dans nos sociétés européennes ? Faut-il, d'après vous, profiter des élans d'une sorte de « patriotisme émancipateur » (« Défendre les Grecs contre la Troïka », dit-on) – pour constituer des identités politiques « nationales-populaires » (Gramsci), comme en Amérique latine ?
Je me situe, de par ma formation intellectuelle au sein du marxisme, à la convergence de ces deux dimensions : associer la dimension de classe et la dimension nationale-populaire. Cela me paraît d’autant plus pertinent dans le cadre des pays dominés comme la Grèce. Disons-le sans ambages : l’Union européenne est une construction impérialiste – par rapport, certes, au reste du monde, mais aussi en interne, au sens où elle reproduit des rapports de domination impériale en son sein. On peut distinguer au moins deux périphéries : la périphérie Est (les anciens pays socialistes), qui sert de réservoir de main-d’œuvre bon marché, et la périphérie Sud (c’est un sud géopolitique, et non géographique, qui inclut l’Irlande). Ces pays sont soumis à des régimes de souveraineté limitée de plus en plus institutionnalisés via la mécanique des mémorandums. Quant à la force du vote « non » au référendum, elle vient de l’articulation de trois paramètres : la dimension de classe, la dimension générationnelle et la dimension nationale-populaire. Cette dernière explique pourquoi le « non » l’a emporté même dans les départements de tradition conservatrice. Je pense que pour devenir hégémonique, la gauche a besoin de tenir les deux bouts. D’abord, une identité de classe adaptée à l'ère du néolibéralisme, du capitalisme financier et des nouvelles contradictions qui en résultent — la question de la dette et des banques est un mode essentiel (mais non unique) sur lequel repose aujourd’hui l’antagonisme entre Travail et Capital. Par ailleurs, ces forces de classe doivent prendre la direction d’un bloc social plus large, capable d’orienter la formation sociale dans une nouvelle voie. Il devient ainsi bloc historique qui « se fait Nation » , autrement dit, qui assume une hégémonie nationale-populaire. Antonio Gramsci a beaucoup travaillé là-dessus, oui : articuler la dimension de classe et nationale-populaire.
Il s’agit d’une question complexe, qui se pose différemment selon chaque histoire nationale. En France, ou dans les nations anciennement coloniales et impérialistes, la notion nationale-populaire ne se pose pas de la même façon qu’en Grèce ; comme elle ne se pose de la même façon en Grèce qu’en Tunisie, ou dans un pays asiatique ou latino-américain. L’enjeu est d’analyser les contradictions propres des formations sociales. Ceci étant dit, la force de Syriza, et plus largement de la gauche radicale grecque (qui a un enracinement profond dans l’histoire contemporaine du pays et dans les luttes pour la libération nationale), est qu’elle combine la dimension de classe et la dimension nationale-populaire.
Le scénario grec a permis de dessiller les yeux des défenseurs de l’« autre Europe ». N’est-ce pas là le grand succès de Syriza : avoir révélé en quelques semaines la nature anti-démocratique des institutions européennes ? Par exemple, le dernier vote au Parlement grec a donné à voir un spectacle ahurissant : des députés qui doivent se prononcer sur un texte de 977 pages, reçu 24 heures plus tôt…
Il faut bien que les défaites servent à quelque chose ! Malheureusement, ce que je vois dominer, même maintenant, dans la gauche radicale, ce sont des réflexes d’auto-justification : malgré tout, il faut trouver des excuses à ce que fait Tsipras, tourner autour du pot, laisser croire qu’il ne s’agit que d’un mauvais moment à passer, etc. J’espère que ce n’est qu’un mécanisme psychologique transitoire face à l’étendue du désastre et que nous aurons rapidement le courage de regarder la réalité en face, le courage de réfléchir sur les raisons de ce désastre. Je ne sais pas, pour ma part, ce qu’il faut de plus comme démonstration éclatante de l’inanité de la position selon laquelle on peut rompre avec le néolibéralisme dans le cadre des institutions européennes ! L’un des aspects les plus choquants des développements qui font suite à la signature de l’accord est qu’on est revenu exactement à la situation de 2010-2012, en matière de démocratie, ou plutôt de sa négation ! À savoir que même les procédures formelles de la démocratie parlementaire – on voit d’ailleurs qu’elles ne sont pas que formelles au regard des efforts déployés pour les supprimer – ne sont pas respectées. Les députés n’ont eu que quelques heures pour prendre connaissance de pavés monstrueux qui changent de fond en comble le code de procédure civile : 800 pages, qui faciliteront la saisie des maisons ou renforcent la position juridique des banques en cas de litige avec des emprunteurs. En outre, on trouve dans ce même projet de loi la transposition d’une directive européenne sur l’intégration au système bancaire européen, qui permet, en cas de faillite des banques, de pratiquer ce qu’on appelle un « bail-in », c’est-à-dire un prélèvement sur les dépôts bancaires pour renflouer les banques. Le cas chypriote se généralise à l’échelle de l’Europe. Tout cela a été voté le 22 juillet par les mêmes procédures d’urgence que Syriza n’avait cessé de dénoncer durant toutes ces années, et qu’il est désormais obligé d’accepter puisqu’il a capitulé devant les créanciers. Le mot « capituler » est sans doute faible. J’ai vraiment des réactions de honte quand je vois un parti dont je suis toujours membre être au gouvernement et se livrer à ce type de pratiques, qui tournent en dérision les notions les plus élémentaires du fonctionnement démocratique des institutions.
Après le vote par le Parlement grec de l’accord d’austérité et desdites « réformes structurelles », comment se redéfinit l’échiquier politique grec ? Va-t-on vers une scission de Syriza ou, du moins, une recomposition des forces de gauche radicale ? D’autant que les grèves repartent et la place Syntagma se remplit de nouveau...
La recomposition est certaine et elle sera de grande ampleur. Il est peut-être trop tôt pour en avoir les contours exacts mais j’aimerais insister sur deux éléments. Le premier est la situation interne de Syriza. Il faut bien comprendre que les choix du gouvernement Tsipras n’ont pas de légitimité au sein du parti. La majorité des membres du Comité central a signé un texte commun, dans lequel l’accord est rejeté et considéré comme le produit d’un coup d’État contre le gouvernement grec. Une convocation immédiate du comité central est exigée — et elle s’est heurtée à une fin de non-recevoir de Tsipras, président du parti élu, lui-aussi, directement par le Congrès. La quasi-totalité des fédérations du parti et des sections locales votent des motions dans le même sens. On est devant une situation de blocage. Du côté des proches de Tsipras, le ton devient extrêmement agressif envers ceux qui sont en désaccord avec les choix qui ont été faits. Il est très choquant de voir que certains membres du parti reprennent mot pour mot les arguments propagés par les médias, jusqu’aux calomnies qui présentent les défenseurs de plans alternatifs, comme Varoufákis ou Lafazanis, comme des putschistes, des comploteurs de la drachme, des alignés sur le Grexit, façon Schäuble. Nous avons donc peu de raisons d’être optimistes quant à l’évolution de la situation interne de de Syriza.
Mais l’essentiel est ailleurs. La gauche de Syriza, dans ses diverses expressions (même si la Plateforme de gauche en constitue l’épine dorsale), se fixe à présent comme objectif la traduction et la représentation politique du peuple du « non » aux mémorandums et à l’austérité. La situation nouvelle créée est que le bloc social, avec ses trois dimensions – de classe, de génération et national-populaire –, se retrouve désormais orphelin de représentation politique. C’est à cette construction politique qu’il faut maintenant s’atteler. Il s’agit de rassembler, de façon très large, des forces politiques à l’intérieur et l’extérieur de Syriza. Les premiers signes qui nous parviennent sont positifs. Mais il est vital d’impliquer également dans ce nouveau projet des acteurs non strictement politiques, qui ont mené la bataille du « non » par en-bas, dans le mouvement social. C’est absolument extraordinaire : les initiatives, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les quartiers, ont littéralement fusé en l'espace de quelques jours ; d’autres se sont créées dans la foulée du référendum ou se constituent actuellement.
L’image que véhiculent les médias, selon laquelle « en Grèce, tout le monde est soulagé, Tsipras est très populaire », est très loin de la réalité. Il y a un très grand désarroi, de la confusion, une difficulté à admettre ce qui s’est passé. Un ami a utilisé le terme de « choc post-traumatique ». Cela signifie qu’une partie de l’électorat du « non » est dans un tel désarroi qu’elle ne sait plus sur quel pied danser et se dit qu’il n’y avait peut-être pas d’autre choix possible. Mais nombreux sont ceux, surtout parmi les secteurs sociaux les plus massivement engagés dans le « non » – à savoir les jeunes et les milieux populaires –, qui sont révoltés et disponibles pour participer ou soutenir un projet alternatif. La Plateforme de gauche tient son premier meeting public au grand air à Athènes, lundi prochain [27 juillet — aujourd'hui]. Le titre de cette manifestation sera : « Le non n’est pas vaincu. Nous continuons. » Il faut construire de façon nouvelle la voix du « non » de classe, démocratique et anti-Union européenne.
C’est la stratégie qu’aurait dû entreprendre la gauche radicale française suite à la victoire du « non » au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen en 2005, non ?
Exactement. Et au lieu de ça, elle a régressé et s’est empêtrée dans des luttes de boutique internes. Au lieu de pousser la critique de l’UE plus loin, à partir de l’acquis de la campagne du « non », elle est revenue en arrière et n’a cessé de rabâcher la litanie de « l’Europe sociale » et de la réforme des institutions européennes...
Le projet d’une plateforme commune des gauches radicales sud-européennes, afin d’établir un programme concerté de sortie de l’euro, est-il envisageable ?
Depuis 35 ans, j’essaie d’être un militant communiste. Ce qui m’intéresse est une stratégie anticapitaliste pour ici et maintenant, dans un pays européen et dans la conjoncture où nous vivons. Et je considère effectivement que cela serait la médiation nécessaire afin d'établir une stratégie anticapitaliste effective, non pas basée sur un propagandisme abstrait ou sur des velléités de répétition des schémas anciens dont on sait pertinemment qu’ils ne sont plus valides, mais sur les contradictions actuelles ; une stratégie qui tire les leçons des expériences politiques récentes, des luttes, des mouvements sociaux et qui essaie d’avancer dans ce sens, en posant la question du pouvoir et de la stratégie politique. Ce n’est donc pas simplement un projet prétendument « anti-européen », ce n’est d’ailleurs pas un projet limité à l’Europe du Sud, mais un projet authentiquement internationaliste — qui suppose en effet des formes de coordination plus avancées des forces d’opposition au système. Ce qu’il faut, c’est une nouvelle gauche anticapitaliste. Et l'une des conditions, non pas suffisante mais nécessaire pour y parvenir, est d’ouvrir un front résolu contre notre adversaire actuel, c’est-à-dire l’Union européenne et tout ce qu’elle représente.
Dans vos interviews, écrits et articles, vous avez pris l’habitude d’écrire systématiquement entre guillemets « la gauche de la gauche » ou « la gauche radicale ». Cette incapacité à se définir clairement – sans ambages ni guillemets – marque-t-elle le signe que les identités politiques héritées du XXe siècle sont, pour partie, devenues obsolètes ?
Le terme de « gauche radicale » est sans doute utile car il correspond à cette situation mouvante. On est dans un entre-deux et les formulations souples sont nécessaires, ou du moins inévitables, pour permettre aux processus de se déployer de façon nouvelle, en rupture avec des schémas préétablis. Ce qui caractérise Syriza sont ses racines très profondes dans le mouvement communiste et la gauche révolutionnaire grecque. En d’autres termes, Syriza est issu de la recomposition de mouvements dont le but commun était la remise en cause, non pas seulement des politiques d’austérité ou néolibérales, mais du capitalisme lui-même. Il y a donc d’un côté un aspect de radicalité réelle, mais de l’autre, on a vu que la stratégie choisie était profondément inadéquate et renvoyait à des faiblesses de fond et, par là même, à des contradictions dans la constitution de Syriza, qui n’a pas résisté à cette épreuve terrible du pouvoir gouvernemental. La contradiction a ainsi fini par éclater. Il s’agit à présent d’assumer ce fait et de passer à une étape suivante pour que cette expérience chèrement acquise par le peuple grec et les forces de la gauche de combat servent au moins à ouvrir une perspective d’avenir.
NOTES
1. Entretien accessible en ligne.
2. « Le courage du désespoir », accessible en ligne.
REBONDS
☰ Lire notre carnet de route (2), « Grèce : six mois pour rien ? », juillet 2015
☰ Lire notre carnet de route (1), « L’Europe agit comme si elle était en guerre contre les Grecs », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand, « Les peuples, contre les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015
☰ Lire notre entretien avec Sofia Tzitzikou, « La dignité du peuple grec vaut plus qu’une dette illégale, illégitime et odieuse », juillet 2015
☰ Lire notre traduction de l'entretien de Pablo Iglesias : « Faire pression sur Syriza, c’est faire pression sur Podemos, pour montrer qu’il n’y a pas d’alternative », mai 2015
☰ Lire notre traduction de l'article « Assassiner l'espoir », Slavoj Zizek, avril 2015
☰ Lire notre entretien avec Joëlle Fontaine, « Difficile pour la Grèce d’être souveraine suite aux menaces de l’Union européenne », février 2015source: revue-ballast.fr
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 29 Juillet 2015 à 08:32
 Cynisme : idéologie de la petite bourgeoisie grecque désespérée par la guerre du Péloponnèse. (Bolshaya Sovetskaya Entsiclopediya, éditions de 1952)
Cynisme : idéologie de la petite bourgeoisie grecque désespérée par la guerre du Péloponnèse. (Bolshaya Sovetskaya Entsiclopediya, éditions de 1952)La direction (CEN ou Comité Exécutif National) du PCF a produit, le 17 juillet, un document de travail à l’usage de ses cadres et militants sur les événements de Grèce. Ce document, plus et mieux que l’interview de Pierre Laurent, le secrétaire national, donne le ton de ce qu’est l’analyse politique que fait le PCF sur ses événements. Le rappel qui est fait des événements jusqu’au 5 juillet n’est pas faux, tout en passant sous silence l’existence de débats au sein de Syriza et en se refusant à prendre parti, voir simplement à décrire, les positions des uns et des autres. On baigne dans une image d’Epinal d’un Syriza uni autour de son chef. Mais, ce document retrace fidèlement les manœuvres de l’Eurogroupe et la tentative de coup d’état qui conduit au référendum du 5 juillet.
Par contre, sur la période du 5 au 13 juillet, ce document est bien plus succinct. Il ne tient pas compte de l’interview de Stathis Kouvelakis (membre de la plate-forme de gauche de Syriza) publiée le 15 juillet dans Jacobin[1], ni de la note postée sur le blog de Paul Mason, le correspondant de Channel 4 en Grèce, qui avait recueilli les confidences de Varoufakis et des autres membres de la gauche de Syriza[2], enfin, et surtout, aucune mention n’est faite de l’analyse de Yanis Varoufakis, l’ancien Ministre des finances, analyse publiée le 14 juillet sur son blog[3]. On pourrait multiplier les exemples. C’est donc un point de vue extrêmement orienté qui est donné dans ce document de travail, celui d’Alexis Tsipras. Pire, car l’on pourrait comprendre que politiquement on reprenne le point de vue de Tsipras. Le point de vue de l’opposition interne dans Syriza n’est nullement mentionné. Dans ces conditions, la description du vote de la nuit du 15 au 16 juillet est incompréhensible pour le lecteur, qui n’a pas les éléments nécessaires pour se faire une opinion. La référence à un sondage sur l’Euro, donnant 75% des grecs opposés à une sortie de l’Euro accentue le malaise, quant on sait la valeur très discutable des sondages qui, il faut le rappeler, donnaient le OUI vainqueur ou ne donnait qu’une très faible avance au NON, alors que celui-ci fut majoritaire à plus de 61%. Ici encore, on ne peut qu’aboutir à la conclusion que le document du CEN du PCF entend présenter la position d’Alexis Tsipras comme la seule possible. Autrement dit, le CEN du PCF nous rejoue l’antienne de Margaret Thatcher « there is no alternative » (TINA).
Il n’est pas dans mon intention d’analyser la totalité de ce document. Néanmoins, les analyses économiques de ce qu’aurait entraîné le « Grexit » présentent un intérêt, en ce qu’elle viennent conforter l’idée d’une présentation extrêmement orientée, au point même d’en être malhonnête, de la situation en Grèce.
Je me concentrerai sur le paragraphe « Concernant la sortie de la Grèce de la zone euro » qui commence fin de la page 4 et début de la page 5 du document émis par le CEN.
Les conséquences immédiates d’un GREXIT
Un « Grexit » signifierait une dévaluation estimée au minimum à 40 % et donc une perte de pouvoir d’achat de 40 % et une augmentation du coût de la dette de 40 %. Cela ne peut apporter aucun gain de compétitivité dans un pays où les salaires ont déjà baissé de 25 % et où l’appareil productif n’est pas capable de répondre à un surcroît de demande.
On ne sait vraiment pas comment les rédacteurs de cette note peuvent déterminer ainsi la dépréciation probable du taux de change de la Drachme en cas de « Grexit ». Compte tenu de la dévaluation interne déjà opérée depuis 2010, et du rétablissement de la balance courante de la Grèce, une dépréciation de l’ordre de 15% à 25% apparaît bien plus probable. Rien ne vient donc appuyer cette argumentation, si ce n’est la volonté de présenter une image « cataclysmique » d’un possible Grexit. En fait la situation de la balance courante actuelle de la Grèce laisse à penser que cette dévaluation serait nettement inférieure à 40%.
Il y a ensuite une erreur grossière dans le texte. Tellement grossière que l’on peut penser qu’elle est faite à dessein, pour provoquer un mouvement de recul sur la base d’un « effet d’évidence » c’est quand il est dit qu’une dépréciation de 40% entraînerait une baisse du pouvoir d’achat de 40%. Cela équivaut à prétendre que la totalité de la consommation en biens et services de la totalité de la population est réalisée en biens importés. Ce n’est évidemment pas le cas. Si l’on excepte les 10% les plus riches de la population, dont la part de consommation de biens importés peut atteindre 70%, pour le reste de la population on sait que cela se situé à moins de 50% et pour les personnes les plus pauvres (disons pour les 50% les moins riches), on sait que la part importée se situe autour de 20% voire de 15%. Cela veut donc dire qu’une dépréciation de 40%, que l’on considère par ailleurs comme une hypothèse excessive, aboutirait à une perte de pouvoir d’achat de -28% sur les plus riches mais de -8% voire -6% sur les plus pauvres. De fait, la perte de pouvoir d’achat porterait essentiellement sur les plus riches. En réalité, une dépréciation de la devise induit un changement au sein de la population, touchant bien plus fortement les catégories sociales qui sont largement importatrices. C’est, aussi, un mécanisme de justice sociale au sein d’une population.
Deuxième erreur grossière, le passage suivant : « Cela ne peut apporter aucun gain de compétitivité dans un pays où les salaires ont déjà baissé de 25 % et où l’appareil productif n’est pas capable de répondre à un surcroît de demande ». Tout d’abord le problème est bien plus celui des élasticités croisées import/export ; passons. Mais, la question de la compétitivité de l’économie grecque implique de connaître les secteurs exportateurs. Ceci montre que les rédacteurs du document n’ont aucune idée, ou n’ont pas cherché à en avoir, de la situation sur ce point de la Grèce. En effet, les ressources de la balance courante de la Grèce incluent quatre postes importants :
- Les recettes de l’industrie touristique (considérées comme des « exportations » du moment que des touristes non résidents viennent en Grèce). Or, il est évident, et corroboré par de nombreuses études, que l’industrie touristique bénéficierait massivement d’une dépréciation de la Drachme, en particulier en attirant des touristes hors-saison (cas des touristes britanniques et d’Europe du Nord) qui aujourd’hui vont en Croatie ou en Turquie.
- Les recettes de la construction et de la réparation navale. On sait que c’est un des secteurs « exportateurs » de l’économie grecque. Actuellement, ce secteur est en crise à cause de la concurrence faite par la Croatie et la Turquie (qui a déprécié sa monnaie dans des proportions importantes depuis 3 ans). Un retour de chiffre d’affaires au niveau de celui de 2010 est probable avec une dépréciation de la Drachme de -25%, du fait de la qualité reconnue de ce secteur.
- Les recettes de l’industrie grecque. L’industrie grecque est peu développée, mais elle a quelques secteurs d’excellence, secteurs qui sont très loin de travailler à pleine capacité des installations. En fait le taux d’utilisation des capacités semble se situer autour de 60-65%. Une montée vers 80% est possible en cas de dépréciation de la Drachme.
- Les recettes de l’agriculture grecque. L’agriculture grecque est largement exportatrice, que ce soit vers les Balkans, vers les pays arabes, ou vers les pays de l’Eurozone. Ses marges d’exportation sont limitées par le cours de l’Euro dans les deux premiers cas.
On voit qu’une dépréciation de la Drachme induirait un coup de fouet important sur l’économie grecque. Par ailleurs, il serait alors possible d’accroître les investissements en proportion du PIB. Le coup de fouet se transformerait alors en une pente vertueuse, des investissements plus importants améliorants la productivité dans les secteurs exportateurs, qui pourraient accroitre leurs parts de marché. L’économie grecque renouerait avec la croissance et le chômage, qui touche aujourd’hui plus de 26% de la population diminuerait rapidement.
On voit que les auteurs du texte du CEN n’ont pas présenté une image objective, et tout simplement honnête, des conséquences du GREXIT à leurs lecteurs.
Conséquences financières
« Cela aurait pour effet immédiat une hausse des prix importés donc plus d’austérité salariale, une dette privée plus chère, des difficultés accrues pour financer les investissements et, finalement, une soumission encore plus forte à la finance ».
En ce qui concerne la dette de la Grèce, il est clair qu’un GREXIT indurait un défaut souverain. Mais cela ne veut pas dire que la Grèce ne rembourserait rien. On sait qu’après un défaut, les créanciers et le pays endettés se mettent d’accord sur une forte dépréciation de la dette, qui peut aller jusqu’à 80% comme en Russie après le défaut de 1998. Si on admet que la dépréciation de la dette soit simplement de 66%., compte tenu d’une dépréciation de la devise de -25% cela donne :
Dette actuelle : 315 milliards d’Euros
Dette recalculée en Drachme, après dépréciation de la Drachme de -25% : 420 milliards de Drachmes
Dette après abattement de 66% : 138,6 milliards de Drachmes.
Si l’accord post-défaut inclut une perte de valeur faciale de 80% (comme dans le cas de la Russie) on aboutit à : 84 milliards de Drachmes.
Même dans le cas le moins avantageux, la dette grecque aurait été ramenée à 70% du PIB (200 milliards d’Euro = 200 milliards de Drachmes).
Quant à la hausse des prix, induite par la hausse des prix importés, une étude relayée par mon excellent confrère Alberto Bagnai (que je salue ici) montre qu’elle serait de 0,3 x montant de la dépréciation, soit de 7,5% étalés sur environ 3 ans. Ici encore, rien de catastrophique, et certainement rien de comparable avec les effets du 3ème mémorandum.
Quant à la question des investissements, je renvoie à ma note sur l’interview de Pierre Laurent, car j’ai montré qu’en réalité une dépréciation de la Drachme serait très favorable à l’investissement[4]. Une fois encore, on voit que les auteurs du document de travail de la CEN prennent des libertés inadmissibles avec la réalité, et que ceci ne peut s’expliquer que par la volonté idéologique de discréditer toute politique de sortie de l’Euro.
Conséquences à l’Europe
« Par ailleurs, un « grexit » déclencherait des assauts spéculatifs massifs pour faire sortir d’autres pays de la zone euro, à commencer par l’Italie (2.070 milliards d’euros de dette), l’Espagne (966 milliards d’euros), le Portugal (219 milliards d’euros) et, probablement, la France ensuite. On entrerait dans une course sans fin de chaque pays aux dévaluations compétitives, anti-salariales et déflationnistes renforçant encore la guerre économique pour prendre des parts de marché au détriment des partenaires européens ».
Le risque d’attaques spéculatives est réel, et il est probable qu’un GREXIT entraînerait un éclatement de la zone Euro. Mais, cet éclatement serait largement positif pour trois pays, l’Italie, la France et le Portugal. Si cet éclatement est anticipé (et pourquoi ne le serait-il pas ?), les gouvernement peuvent s’entendre sur une sortie collective, et fixer des limites à la dépréciation de leurs monnaies. En fait, cet éclatement de l’Euro ne pénalisera qu’un seul pays : l’Allemagne, qui verra sont excédent commercial se réduire très rapidement. Tout cela a été calculé de nombreuses fois et ces calculs ont montré que les conséquences d’un éclatement de l’Euro ne seraient, là non plus, pas « apocalyptique » comme l’écrivent les rédacteurs du document de la CEN. Ici, on voit bien l’idéologie européiste en action qui prétend que, hors de l’Euro, point de salut. Ce qui revient à dire que l’on est dans l’idéologie, et nul part ailleurs.
Un discours essentiellement idéologique
On voit la nature profonde du document du CEN dans l’extrait suivant : « Mais le grexit serait la meilleure façon de légitimer le discours nationaliste de l’extrême droite (Aube dorée en Grèce, FN en France…) ». Autrement dit, si Mme Marine le Pen dit qu’il fait soleil à Athènes en plein midi, nous devrions tous nous précipiter sur nos manteaux et nos parapluies et crier qu’il pleut et qu’il fait froid à Athènes. Tel est le niveau de raisonnement ou est tombé le Comité Exécutif National du PCF dans son document de travail. Cela en dit long sur la terreur qui semble avoir saisi ses rédacteurs, mais aussi très long sur jusqu’où les membres de la CEN sont prêt à aller pour induire les cadres et les militants de leur parti à emprunter une voie sans issue. Car, il faut le redire encore et encore, un GREXIT n’est nullement la propriété d’un parti mais une solution économique et politique, qui doit être traitée d’un point de vue économique et politique, et non idéologique.
Le Comité Exécutif National du PCF a donc commis un document qui est largement idéologique. Il en dit long sur le désarroi de la direction du PCF (ou d’une partie de celle-ci) confrontée à la réalité, une réalité qu’il n’hésite pas à tordre ou a dissimuler. Car, il y a suffisamment de personnes de valeurs au sein de ce parti pour que l’on puisse penser que ces distorsions de la réalité, et ces mensonges, ne sont pas le produit de l’ignorance mais bien celui d’une ligne politique.
Jacques Sapir
Notes
[1] https://www.jacobinmag.com/2015/07/tsipras-varoufakis-kouvelakis-syriza-euro-debt/
[2] http://blogs.channel4.com/paul-mason-blog/greece-crisis-austerity-deal-pointless/4197
[3] http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/14/on-the-euro-summits-statement-on-greece-first-thoughts/
[4] http://russeurope.hypotheses.org/4144
source: russeurope.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 28 Juillet 2015 à 22:00
 Après les monumentales cagades de la direction du PCF et du responsable du groupe communiste à l’Assemblée nationale appelant à voter pour le mémorandum applicable à la Grèce tout en félicitant la main gauche du capitalisme, F. Hollande, cette même direction cherche à rattraper le coup ! Rappelons tout de même que ce mémorandum est digne d’une démarche colonialiste : c’est la mise sous tutelle renforcée de la Grèce en vue de lui extirper ce qui lui reste de richesses, et surtout de faire un exemple pour les peuples de l’UE qui se risqueraient à regimber. C’est pourquoi la direction du PCF vient de bâcler un texte sur les évènements de Grèce appelé "Document de travail". Chiche ! Et bien nous allons travailler à donner quelques couleurs à cette position qui est empêtrée dans ses contradictions, à savoir prétendre combattre l’austérité tout en vénérant l’euro et l’UE et en idolâtrant la politique du social-démocrate Tsipras. En attendant que se mijote le propre texte du réseau "Faire vivre et renforcer le PCF", nous donnons à lire ce fameux document de travail.
Après les monumentales cagades de la direction du PCF et du responsable du groupe communiste à l’Assemblée nationale appelant à voter pour le mémorandum applicable à la Grèce tout en félicitant la main gauche du capitalisme, F. Hollande, cette même direction cherche à rattraper le coup ! Rappelons tout de même que ce mémorandum est digne d’une démarche colonialiste : c’est la mise sous tutelle renforcée de la Grèce en vue de lui extirper ce qui lui reste de richesses, et surtout de faire un exemple pour les peuples de l’UE qui se risqueraient à regimber. C’est pourquoi la direction du PCF vient de bâcler un texte sur les évènements de Grèce appelé "Document de travail". Chiche ! Et bien nous allons travailler à donner quelques couleurs à cette position qui est empêtrée dans ses contradictions, à savoir prétendre combattre l’austérité tout en vénérant l’euro et l’UE et en idolâtrant la politique du social-démocrate Tsipras. En attendant que se mijote le propre texte du réseau "Faire vivre et renforcer le PCF", nous donnons à lire ce fameux document de travail.PB
CEN 17 juillet 2015
Grèce : Document de travail du PCF
Ce texte est une première analyse, encore à chaud, de la situation. Tant sur l’analyse que sur les leçons à tirer, il faudra prendre le temps d’approfondir, avec le recul et en tenant compte des évolutions des semaines à venir. La situation reste très instable. Face à l’urgence, nous posons des questions et ouvrons des pistes pour nos luttes, avec comme ligne de mire la nécessaire élévation de notre bataille en France et en Europe.
***
La Grèce est en première ligne de la lutte des classes en Europe. Depuis la victoire de Syriza en Grèce le 25 janvier, et a fortiori à travers la dernière séquence politique des négociations dans la zone euro, a mis en lumière la violence avec laquelle une droite au service de la finance, s’appuyant sur l’extrême droite et bénéficiant du silence complice des autres, a pu piétiner la démocratie et punir un peuple, qui a osé dire non à l’austérité. Malgré le courage de Tsipras et la maturation politique qu’a permis son combat dans toute l’Europe, de lourdes questions sont posées pour les forces progressistes de nos pays, au premier rang desquels, le rôle que nous devons jouer pour élever assez haut le niveau de débat politique et de rapport de forces en Europe, pour desserrer l’étau sur le peuple grec et ne pas laisser isolé le seul gouvernement de gauche en Europe.I - Le gouvernement Tsipras : une lutte permanente contre le coup d’état financier et la déstabilisation politique
Dans une Europe dominée par le consensus libéral entre forces de droite et social-démocrates, dès le 25 janvier, jour de leur victoire électorale, le gouvernement Tsipras et Syriza sont devenus les ennemis de tous, l’expérience alternative à détruire.
25 janvier – 25 juin : 5 mois de luttes pour la sortie de l’austérité, la relance économique et l’assainissement de la vie publique grecque, sous asphyxie financière
Le 20 février, après de difficiles négociations, la Grèce signe l’accord-pont avec l’Eurogroup. Objectif : allonger le programme de financement précédent le temps de prendre les mesures urgentes et préparer un programme de financement durable à négocier en juin. Loi humanitaire, réintégration de fonctionnaires, réouverture ERT, droit du sol, lutte contre la corruption et commission vérité sur la dette : le gouvernement Tsipras inscrit sa politique à gauche. Pendant ce temps, les termes de l’accord ne sont pas respectés par les créanciers et aucun financement n’est versé. La BCE commence à multiplier les conditionnalités pour l’accès à ses financements : l’asphyxie financière a commencé dès la victoire de Syriza.La tentative de coup d’État financier, le référendum
Le mandat donné par le peuple grec « Sortir de l’austérité, rester dans l’euro » a conduit le gouvernement Tsipras a une démarche de négociations depuis son élection. Depuis, ni le mandat, ni la démarche n’ont changé jusqu’ici. Le 25 juin, alors qu’un accord était « à portée de main », le FMI rompt les négociations du plan de financement durable en faisant une contre proposition inacceptable. Tsipras décide alors de convoquer un référendum et appelle à voter NON à la proposition des créanciers. La réponse des forces néolibérales est celle de la pression politique et financière – une stratégie de la déstabilisation et de la peur – pour peser sur le référendum.
Quelques jours avant, Samaras (leader de l’opposition grecque) appelait à un gouvernement d’Union nationale et le Président de To Potami (un parti fondé par les anciens du Pasok et pro-austérité) était reçu en grandes pompes dans toutes les institutions européennes. L’eurogroup du 27 juin décide, sans le ministre grec des finances, Yanis Varoufakis, de terminer au 30 juin le programme financier en cours. Le lendemain, conséquence logique, la BCE annonçait la coupure des liquidités pour les banques grecques à la même date. Ce chantage financier a contraint le gouvernement grec à mettre en place une procédure de contrôle des capitaux et à fermer les banques, puis à faire défaut au remboursement du FMI. L’offensive médiatique et politique est coordonnée autour d’au moins deux axes : Tsipras est irresponsable, c’est lui qui a fait échouer les négociations / la question du referendum est pour ou contre la sortie de l’Euro. Le 5 juillet, le NON l’emporte avec 61 %. Tsipras est renforcé et compte toujours négocier. Il s’appuie sur le referendum pour inclure dans les négociations un rééchelonnement de la dette et un plan d’investissement pour la croissance issu du plan Juncker. Son objectif est un programme de financement durable pour stabiliser la Grèce et relancer l’économie.II - Le 13 juillet, un tournant historique
L’Europe est ébranlée par le tournant pris au sein de l’Eurozone ces dernières semaines.
Une méthode de « gangsters »
Le Grexit était l’option choisie par Angela Merkel et les droites dures d’Europe (ex : le gouvernement Finlandais de droite/extrême droite) dès le début et jusqu’au dernier moment. Le but déclaré des dirigeants allemands était la "suspension provisoire ", autrement dit l’expulsion de la Grèce de la zone euro, quitte à ouvrir, pour ce pays au bord de la banqueroute, une ère cauchemardesque, et d’entraîner l’Europe elle-même dans une aventure très périlleuse. Quant à la dette grecque, les dirigeants allemands ne voulaient plus en entendre parler. Ils n’entendaient pas davantage consentir de nouveaux prêts à un Etat dirigé par un gouvernement qui a osé le défier jusqu’à organiser un référendum au verdict humiliant pour ceux qui se voient comme les maîtres de l’Europe. La Banque centrale européenne devait continuer à servir d’instrument pour ce coup d’Etat financier. Tout au long du week-end ce « bloc des durs », n’a cessé de faire des propositions provocatrices, humiliantes et inacceptables pour le gouvernement Tsipras, cherchant à ce qu’il quitte la table des négociations.Un mauvais accord signé « le couteau sous la gorge »
Les mesures imposées dans ce contexte à Athènes sont socialement inhumaines, économiquement contre-productives et politiquement scandaleuses -incluant des violations extrêmement graves de la souveraineté du pays. Le paroxysme est, à cet égard, atteint avec la création d’un "fonds pour les privatisations" : visant à gager des actifs publics d’un montant démentiel -plus d’un quart du Produit Intérieur Brut de la Grèce !- et soustrait à la maîtrise du gouvernement pour la gestion des recettes attendues. Une mesure scélérate s’il en est. Le Grexit n’est pas écarté. Il reste le choix du gouvernement allemand et l’accord ne comporte aucune garantie de déblocage des financements, au contraire, il impose de nouvelles conditionnalités.
Le choix politique d’Alexis Tsipras : signer un mauvais accord pour éviter le désastre, stopper l’asphyxie financière du pays et la mort à petit feu, empêcher le grexit et la mort subite. Il a favorisé la survie financière du pays. Il a pris ses responsabilités de Premier ministre face aux exigences extravagantes des créanciers, à la possibilité d’un effondrement immédiat du système bancaire et la sortie de l’euro et la « sortie ordonnée » de l’euro préconisée par Schaüble, et même par certains à gauche. La Grèce n’est pas sortie de l’euro, conformément au souhait de 75 % de la population. Donc, pour l’instant, l’objectif de Schaüble n’est pas atteint. Le gouvernement Tsipras est toujours en place et bénéficie d’un très large soutien dans la population grecque. Le deuxième objectif de Schaüble n’est donc pas atteint. Le texte de l’accord a été adopté au Parlement grec dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le groupe de Syriza, la majorité a voté pour, 32 contre dont des personnalités « phares » (Konstantopoulou, Varoufakis), 6 abstentions et une absence. Le CC de Syriza appellait à voter contre. Nous devons être très vigilants à ne pas nous immiscer dans les débats internes de Syriza.Le vote des communistes au Parlement français
C’est principalement le contenu de cet accord qui a conduit nos députés et sénateurs à voter contre au Parlement Français. Il s’est agit également de marquer notre rejet de la brutalité de la méthode Schaüble et notre mécontentement que la France ait laissé faire. C’est aussi un vote de combat, un vote en soutien au peuple grec et à Tsipras. Pierre Laurent au Sénat « Notre vote est aujourd’hui un acte de lutte et de solidarité aux côtés du peuple grec, d’Alexis Tsipras et de nos camarades de Syriza. Nous sommes solidaires de leurs choix et assumons leur difficile et courageux combat. Nous sommes à leurs côtés pour dire non à l’expulsion de la Grèce. Mais nous disons d’un même mouvement, au nom de la France, que l’accord scandaleux imposé à Bruxelles n’est pas digne de l’Europe et qu’aucun maintien dans l’euro ne le peut légitimer ».
III - Perspectives de combats, de réflexion, d’initiatives politiques
Après les deux victoires du 25 janvier et du référendum, l’accord du 13 juillet est une défaite dans le combat pour imposer une solution viable et juste pour le peuple grec et les peuples européens. Mais la bataille continue. Le 13 juillet a été le paroxysme d’un aiguisement sans précédent de l’affrontement de classe en Europe. La lutte de Syriza et la résistance du gouvernement grec ont élevé le niveau d’affrontement, permis une maturation du combat et des consciences en Europe. Les 6 mois écoulés ont été une démonstration grandeur nature pour des millions d’Européens. A un peuple et un gouvernement qui refusent l’austérité, a répondu une violence inouïe du capital allemand et d’une partie des dirigeants européens. Ceux qui l’ont emporté cette fois peuvent le payer cher dans la durée, d’autant que l’accord s’avère sans issue pour le pays. Le PCF doit poursuivre le combat avec une intensité renouvelée dans ses initiatives de solidarité, mais aussi le recul nécessaire pour tirer les leçons de cette page sombre de l’histoire européenne, en dégager des perspectives de luttes.
Aider les Grecs dans l’immédiat
→ Continuer à contester sur le fond la stratégie du choc et le contenu de l’accord :
• Refuser l’austérité. Les Grecs, s’ils ont compris le dilemme auquel était confronté le gouvernement Tsipras, restent debouts contre l’austérité. Les gouvernements de la zone euro et la « troïka » n’ont pas réussi à neutraliser les effets du « non » au référendum en Grèce. En France, les sondages d’opinion montrent qu’une large majorité des Français rejettent ces politiques.
• Argumenter sur l’inefficacité économique. Plusieurs voix diverses s’élèvent pour dire que l’« accord » du 13 juillet, contraire à tout bon sens économique, est inapplicable.
• « Lever la punition ». L’inqualifiable mise sous tutelle d’un pays membre de la zone euro, le fond de privatisations, la méthode autoritaire employée font débat, y compris en Allemagne, et les humiliations produisent de l’indignation très très largement dans les sociétés européennes. Même dans des cercles conservateurs, l’inquiétude grandit. Le gouvernement allemand notamment, « serait peut-être allé trop loin ». Des ruptures s’opèrent au sein du consensus libéral, il faut les utiliser.
→ Déverrouiller les financements :
• Tout faire pour stopper l’asphyxie financière de la Grèce. La décision de l’Eurogroup « post-accord » a conduit la BCE à augmenter de 900 millions d’euros de l’aide d’urgence (ELA) aux banques grecques. Cela est non seulement insuffisant mais ne permet pas à la Grèce de voir venir au-delà d’une semaine. La BCE doit assurer la liquidité des banques grecques en augmentant suffisamment le plafond des liquidités d’urgence et en en diminuant le coût. Les banques grecques doivent pouvoir rouvrir pour les citoyens comme pour les PME.
• Argumenter sur la nécessaire restructuration de la dette. La dette grecque est non viable et l’accord, par ses conséquences récessives et les nouvelles recapitalisations des banques, peut la faire exploser à nouveau. La directrice générale du FMI, C. Lagarde vient de dire qu’elle devra être nécessairement restructurée. La BCE également.
• Agir pour que les financements de moyen terme, arrachés par la Grèce et destinés à la relance de l’économie, deviennent effectifs au plus vite. Plusieurs engagements figurent dans l’accord à la demande de la Grèce : un programme de refinancement de 82 à 85 milliards d’euros, un plan européen d’investissement pouvant aller jusqu’à 35 milliards d’euros.
• Créer un fonds de développement pour la Grèce, adossé à la BCE, pour que la création monétaire de la BCE soit utilisée pour l’économie grecque et non pour la spéculation financière. Ce fonds pourrait servir de modèle pour la création d’un fonds de même nature destiné à tous les pays européens.
• Débloquer les fonds structurels non utilisés, notamment pour aider la Grèce à accueillir les migrants. La République hellénique fait aujourd’hui face, avec l’Italie, à une situation humaine et sanitaire qu’elle ne peut régler seule, a fortiori dans les conditions de crise qu’elle connaît elle-même.
=> Le PCF fera signer cet été et jusqu’à la Fête de l’Humanité, une carte pétition. Les cartes pourraient être déposées dans un lieu symbolique.
Pousser la réflexion et le débat sur les solutions :
Nous avons toujours rejeté les fondements libéraux de l’Union européenne. Tout, depuis Maastricht, et en particulier depuis l’éclatement de la crise financière mondiale de 2008 et son utilisation par les dirigeants européens pour accélérer le processus de libéralisation et de démembrement des modèles sociaux de nos pays, et le tournant pris par la zone euro à travers l’accord du 13 juillet, nous conforte dans ce rejet. Après ce précédent ultra-violent, nous entrons dans un nouveau cycle. Il est maintenant évident que l’Europe ne peut continuer ainsi. Une lutte s’ouvre au grand jour entre les tenants de l’ultralibéralisme, prêts à pousser encore et toujours la mise à genoux des peuples pour servir les intérêts de la bourgeoisie, les forces d’extrême droite qui cherchent à tirer profit de la crise pour rendre crédible leur projet nationaliste et xénophobe, et une troisième option, la nôtre, celle de la refondation de l’Europe pour une coopération régionale, solidaire et démocratique. L’aiguisement des contradictions sème une confusion et parfois du désarroi. Cela doit nous conduire, à moyen terme, à des approfondissements et des clarifications. Ce combat ne peut être abandonné devant l’ampleur de la tâche. Voici, basées sur les travaux de la dernière Convention Europe du PCF, quelques réflexion et pistes d’initiatives soumises au débat des communistes pour les semaines à venir.
→ Concernant la sortie de la Grèce de la zone euro :
Devant la brutalité de cet accord, certains en viennent à penser que le grexit ne serait plus qu’un moindre mal. Quoi qu’il arrive, cette hypothèse ne peut qu’être une décision souveraine du peuple grec et nous rejetons toutes les tentatives de grexit forcé imposées par un ou plusieurs gouvernements européens, ainsi que par les créanciers. La Grèce ne peut, à nouveau, être le laboratoire d’expérimentation du pire. Cette hypothèse serait à ce stade une option extrêmement dangereuse pour plusieurs raisons :• Économiques et sociales : un « grexit » signifierait une dévaluation estimée au minimum à 40 % et donc une perte de pouvoir d’achat de 40 % et une augmentation du coût de la dette de 40 %. Cela ne peut apporter aucun gain de compétitivité dans un pays où les salaires ont déjà baissé de 25 % et où l’appareil productif n’est pas capable de répondre à un surcroît de demande. Cela aurait pour effet immédiat une hausse des prix importés donc plus d’austérité salariale, une dette privée plus chère, des difficultés accrues pour financer les investissements et, finalement, une soumission encore plus forte à la finance. Par ailleurs, un « grexit » déclencherait des assauts spéculatifs massifs pour faire sortir d’autres pays de la zone euro, à commencer par l’Italie (2.070 milliards d’euros de dette), l’Espagne (966 milliards d’euros), le Portugal (219 milliards d’euros) et, probablement, la France ensuite. On entrerait dans une course sans fin de chaque pays aux dévaluations compétitives, anti-salariales et déflationnistes renforçant encore la guerre économique pour prendre des parts de marché au détriment des partenaires européens.
• Politiques : l’humiliation et la soumission contenues dans l’accord vont déjà laisser des traces dans les esprits en Grèce et partout en Europe. Mais le grexit serait la meilleure façon de légitimer le discours nationaliste de l’extrême droite (Aube dorée en Grèce, FN en France...), qui se prépare en se frottant les mains au choc des nations, comme elle se nourrit des divisions dans nos pays.
• Géopolitique : une déstabilisation de la Grèce, port méditerranéen aux portes du Moyen-Orient et pays d’accueil des migrants qui fuient la guerre et la famine, est un risque d’aggravation de la situation pour toute la région.
• Stratégique : dans notre bataille européenne commune, notre position est plus forte avec un gouvernement qui mène le combat politique au sein de la zone euro. C’est la raison principale pour laquelle Schauble et Merkel souhaitent le grexit : ils ne veulent pas que puisse exister une voix alternative à leur ordo-libéralisme. C’est pour cette même raison que les forces nationalistes et xénophobes prônent le grexit : leur alternative de repli nationaliste doit être la seule alternative.
→ Concernant notre projet européen :
• La question de la refondation de l’Union européenne se pose plus que jamais
Beaucoup de propositions figurent dans le texte de la Convention Europe du PCF, d’autres – convergentes – émanent des textes du Parti de la gauche européenne et des débats du Forum européen des alternatives (une brochure est en cours de préparation). Nous pointons deux questions clés aujourd’hui.- Pour ceux qui, à gauche, nourrissaient encore des doutes à ce sujet : la souveraineté populaire ne compte pour rien, aux yeux du pouvoir européen actuel, dès lors que ses "règles" sont remises en cause et que ses intérêts de classe sont en jeu. La démocratie est bel et bien au coeur des ruptures à opérer avec les règles et les institutions actuelles pour qui veut s’engager dans le combat pour la refondation de la construction européenne.
- Un débat est ouvert, notamment par la France, sur le modèle d’intégration de la zone euro. François Hollande, dans un entretien accordé au JDD, prône un nouveau saut fédéraliste pour la zone euro qui devrait constituer une « avant garde » : « J’ai proposé de reprendre l’idée de Jacques Delors du gouvernement de la zone euro et d’y ajouter un budget spécifique ainsi qu’un parlement pour en assurer le contrôle démocratique ». Après le 13 juillet, nous considérons que la conclusion qu’il tire est l’exact contraire du bon sens. D’abord parce qu’elle créée une Europe à deux vitesses entre la zone euro, intégrée au plus haut niveau, et une périphérie totalement écartée des choix majeurs en matière économique. Mais surtout parce qu’elle constitue une grave fuite en avant, au moment même, où la zone euro, et l’UE entière, devraient se questionner sur leur capacité à intégrer les différences entre ses pays membres et les choix souverains des peuples. A cette vision centralisatrice, qui nous soumettrait un peu plus à la loi du plus fort, nous opposons notre conception d’une Europe à géométrie choisie. Toute initiative non basée sur le consentement est vouée à l’échec. Le temps doit être pris pour négocier, dans la transparence et en conformité, non pas avec les principes libéraux et la loi des marchés, mais avec les aspirations populaires et les choix souverains des pays membres. La zone euro devrait se doter d’un Fonds européen destiné au développement des services publics et de l’emploi dans les pays membres. Ce Fonds, institution financière publique, serait financé par la BCE comme l’y autorise le Traité de Lisbonne (article 123,2). Il émettrait des titres publics que la BCE achèterait avec une partie des 1.140 milliards d’euros qu’elle s’est engagée à créer, le 22 janvier dernier, pour stimuler l’économie européenne au taux de 0,05 %. Ce Fonds serait géré démocratiquement avec des critères explicites. Il pourrait être une première étape vers la réalisation de notre demande d’un Fonds européen pour le développement que réclame le Parti de la gauche européenne.
=> Une tâche clé du PCF pour les mois à venir est de préciser son projet européen, de le construire avec ses alliés de tous les pays. Nous proposons dès la rentrée une réunion de travail visant à préciser notre alternative tant sur l’usage de la monnaie unique que sur le modèle de coopération au sein de la zone euro.
• La politique européenne de la France pourrait être différente :
Si le Président de la République avait joué son rôle dès le début de l’affrontement entre les "institutions" et le gouvernement grec - à plus forte raison s’il avait tenu sa promesse d’agir pour "réorienter l’Europe" dès son élection en 2012 - le rapport de force aurait été bien différent dans le moment crucial que nous vivons aujourd’hui. La France a joué un rôle pour empêcher le grexit. Mais il a laissé Merkel dicter la liste des cruautés et des humiliations qui caractérisent le contenu de l’accord. Alors que son action a prouvé qu’elle pesait lourd dans les processus de négociation, elle a joué les rabatteurs sur les propositions des droites dures et des créanciers.La bataille contre l’austérité en France est une question clé. Pour créer un nouveau rapport de force en Europe, le rôle et la voix de notre pays sont essentiels. La France peut faire basculer les choses si elle s’engage elle-même dans la contestation de l’austérité. La crise grecque élargit les possibilités d’y parvenir car elle a élevé le niveau de confrontation ici aussi. Le rôle de la France n’est pas d’être collé à n’importe quel prix au couple franco-allemand mais de prendre part à un front anti-austérité en Europe.
=> Nous pouvons lier plus systématiquement nos combats anti-austérité (hôpitaux, services publics, dépenses publiques, dotations aux collectivités locales) à la demande d’une sortie du pacte budgétaire et à des mesures d’allègement de la dette (conférence européenne sur la dette)
=> Nous pouvons faire monter l’exigence d’initiatives de coopération de la France avec la Grèce, par exemple, pour que notre gouvernement débloque immédiatement sa contribution au plan européen d’investissement pour la Grèce et qu’une aide alimentaire (qui existe dans le cadre européen actuel) soit constituée avec les producteurs français de viande et de lait qui connaissent une crise sans précédent de débouchés et de prix.
• Tout pays qui veut appliquer une politique de gauche devra élever le niveau du rapport de force européen :
La « crise grecque » a mis en évidence combien l’échelle européenne est une échelle pertinente de la lutte des classes, et combien elle est difficile dans le cadre du consensus libéral qui unit droite et social-démocratie européenne, même avec un rapport de forces qui a évolué avec l’élection d’un premier gouvernement de gauche. L’enjeu est crucial pour nous-mêmes. Nous avons collectivement marqué des points dans la crédibilité et la visibilité de la gauche européenne. Un petit pays et un gouvernement isolé ont réussi à ouvrir une brèche et occuper le débat public pendant des semaines. Mais nous avons en face de nous un système de pouvoirs prêt à nous écraser. Nous pouvons, si nos adversaires parviennent à leurs fins, sortir affaiblis, voire rayés de la carte ; et l’espoir de millions d’Européens avec. Le gouvernement de Syriza reste un rempart, il n’a pas rendu les armes. Nos amis grecs nous l’ont toujours dit : la victoire du 25 janvier élève le niveau d’ambitions, de luttes et de solidarités à construire au niveau européen et dans nos pays. Nous ne pouvons pas faiblir sur la solidarité avec le peuple grec, avec Syriza et avec le gouvernement Tsipras. La bataille ne fait que commencer et le PCF entend bien s’engager dans cette lutte, comme il a toujours su le faire. Nous avons, de part notre histoire et notre pratique du rassemblement, un rôle particulier à jouer pour l’unification des forces qui peuvent, et doivent, entrer en mouvement.Il faut, à gauche, se poser collectivement la question : avons-nous jusqu’ici fait vivre la solidarité politique avec le peuple grec au niveau exigé par l’enjeu stratégique que représente le premier affrontement entre un pays membre de la zone euro et l’implacable coalition des tenants du système en place ? L’honnêteté doit nous conduire à répondre non à cette question et à travailler ensemble à un rehaussement qualitatif de notre engagement - aussi nécessaire pour aider le peuple grec à sortir par le haut de l’impasse actuelle qu’indispensable pour ouvrir une perspective de gauche dans notre propre pays. Il ne suffit pas qu’un gouvernement isolé décide de "désobéir à Bruxelles" pour ouvrir la voie aux ruptures fondamentales rendant possible les changements attendus. L’Union européenne n’est pas un "château de cartes" dont il suffirait de menacer de retirer une pièce pour briser la coalition impitoyable des pouvoirs en place. Refonder l’Europe est un combat de classe de haute intensité. La construction sans relâche de convergences entre forces progressistes européennes et la recherche permanente de l’éventail le plus large possible d’alliés dans différents pays pour atteindre ensemble des objectifs partiels mais rassembleurs constituent des impératifs catégoriques pour donner à un peuple et à son gouvernement -qui en ait la volonté politique- la force nécessaire pour changer la donne. Par-delà la Grèce, cette leçon concerne chacun de nos pays, y compris la France. Elle interpelle le "peuple de gauche" dans toute sa diversité, ainsi que chaque force politique ou sociale qui s’en réclame.
Quelques pistes :
=> Rendre possible une progression des forces anti-austérité, une « contagion » dans plusieurs autres pays en appuyant de toutes nos forces nos partis et mouvements alliés dans les pays qui ont des échéances électorales (Espagne, Portugal, Irlande) et placer les régionales en France comme une étape de la percée politique nécessaire en France pour changer le rapport de force européen (avec dans nos projets régionaux, des propositions concrètes de solidarités : programmes de co-développement, politiques de solidarité, de jumelage...). Nous envisageons une rencontre politique de haut niveau de tous les partis politiques impliqués pour discuter des modalités de cette solidarité active.
=> Élargir l’alliance contre l’austérité au niveau européen : Le Forum européen des alternatives que nous avons tenu à Paris les 30 et 31 mai derniers à l’initiative du PGE, a permis le dialogue et un début de construction commune entre forces politiques, mouvements sociaux, intellectuels critiques. La situation rend urgente une deuxième édition. La fête de l’Humanité devra être un temps fort de mise en évidence de la bataille européenne.
=> Élargir le rassemblement en France pour la solidarité avec la Grèce. Le spectre des forces « indignées » de la mise à genoux de la Grèce est très large. L’impact, dans les esprits, de la négation du Non au référendum aura des conséquences contradictoires. Il faut que cette indignation ne tourne pas à la résignation. L’opinion publique française évolue pour le moment dans le bon sens mais nous devons être vigilants car, une fois de plus, le système médiatique est mobilisé pour faire peur, désinformer, empêcher les Français de voir ce qui les unit aux autres peuples européens. La stratégie de la division est en marche. Nous devons saisir la question grecque pour faire le lien en permanence avec les politiques d’austérité menées en France, la dette de notre pays, le nécessaire redressement productif pour lutter contre le chômage. Ce qui n’est pas bon pour les Grecs, n’est pas bon pour les Français.
=> Matérialiser nos solidarités avec la création d’une association de coopération solidaire France-Grèce : jumelages des villes communistes, tourisme social, solidarités concrètes impliquant des organismes institutionnels (en prenant soin de ne pas empiéter sur les initiatives citoyennes déjà existantes et en incitant les camarades à prendre part à celles-ci).
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 28 Juillet 2015 à 20:33
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, vient de donner le samedi 25 juillet une interview à Marianne[1]. Il justifie sa position au sujet de la Grèce et son soutien à la capitulation consentie par Alexis Tsipras. C’est son droit. Mais, pour se faire, il prend un certain nombre de libertés avec les faits. Et cela est beaucoup plus condamnable. Cette interview est une excellente illustration des illusions d’une partie de la « Gauche Radicale », illusions sur l’Euro et sur l’Europe, dont il semble désormais que le Parti de Gauche commence à se dégager[2].
Un petit florilège des citations de Pierre Laurent permet de voir qu’il entretient de sérieuses illusions, et même qu’il adopte un point de vue « européiste » qui n’est pas éloigné de celui du Parti dit « socialiste ». Mais, il faut aussi savoir que les prises de position de Pierre Laurent sont aujourd’hui fortement critiquées dans de larges fractions de la base comme de l’appareil du PCF. Ces prises de position reflètent bien plus les errances d’un homme et d’un groupe de direction du PCF qu’une position largement défendue au sein du Parti.
Une analyse tendancieuse du 13 juillet
Tout d’abord, quand il entend justifier la capitulation de Tsipras, Pierre Laurent dit au journaliste la chose suivante :
« Ils ont enfermé la Grèce et ses dirigeants dans une alternative qui était soit le Grexit — souhaité par les Allemands de manière ouverte, Wolfgang Schaüble, le ministre des Finances allemand, a plaidé jusqu’au dernier moment auprès des Grecs pour une sortie ordonnée —, soit le plan d’austérité qui a finalement été imposé. Le choix qu’a fait Tsipras est un choix qui évite la banqueroute bancaire de son pays, une situation qui aurait été terrible pour les Grecs. Je crois qu’il n’avait pas d’autres alternatives »[3].
Si je suis d’accord qu’un effondrement des banques est une catastrophe, je signale à Pierre Laurent que ce que Tsipras a refusé c’est la proposition de Varoufakis de (1) réquisitionner les banques et (2) de réquisitionner la Banque de Grèce. Ce faisant, le gouvernement aurait eu accès aux réserves (sous contrôle de la BCE avant la réquisition) déposées à la Banque de Grèce mais aussi dans les banques commerciales. La réquisition est un mécanisme qui permet à tout gouvernement de la zone Euro de s’affranchir de la tutelle de la BCE. Dire, dans ces conditions, que le choix de Tsipras était entre la banqueroute et la capitulation est faux. La décision de Tsipras a été politique, et non économique. C’était un choix entre s’engager sur une voie, celle que proposait son Ministre des finances Yanis Varoufakis, voie pouvant le conduire à sortir de l’Euro, ou bien d’accepter l’austérité. Présenter cela comme une décision économique est un mensonge éhonté[4]. Les choses sont désormais publiques, et il est triste de voir Pierre Laurent s’enferrer dans le mensonge.
Pierre Laurent révolutionne la science économique
Commentant un possible Grexit, Pierre Laurent ajoute alors :
« Et une sortie de la zone euro laisserait n’importe quel pays qui la pratiquerait devant la même pression des marchés financiers, voire une pression décuplée et une dévaluation nationale plus grave encore ».
Il semble ici que Pierre Laurent, qui a pourtant fait des études d’économie à Paris 1, ignore qu’il existe des moyens réglementaires permettant à un pays de faire fortement baisser la pression exercée par les marchés financiers. Cela s’appelle le contrôle des capitaux. Non pas le « contrôle des capitaux » imposé par la BCE à la Grèce, et qui aboutit à empêcher les entreprises grecques de faire des opérations sur l’étranger via les comptes Target2 (et qui s’apparente en réalité à un contrôle des changes), mais les contrôles sur les mouvements de capitaux à court terme non liés à des opérations matérielles. Ces mouvements représentent entre 90% et 95% des flux de capitaux, et sont essentiellement des mouvements spéculatifs. Bien entendu, pour les mettre en œuvre, il faut recouvrer le contrôle sur la Banque Centrale. Ici, soit Pierre Laurent fait la preuve de sa méconnaissance des mécanismes économiques de base, soit il les connaît, et en ce cas il ment en toute connaissance de cause. Je laisse le lecteur libre de son choix.
Pierre Laurent est un grand logicien
Pierre Laurent assène alors un argument qui lui apparaît imparable pour écarter une sortie de l’Euro. Cet argument, le voici :
« Il y a d’ailleurs des pays aujourd’hui qui, en dehors de la zone euro, sont également frappés par des politiques d’austérité. Car la pression des marchés s’exerce partout et sur tous les pays ».
On reste sidéré par ce que ce paragraphe implique comme méconnaissance des liens logiques qui relient plusieurs éléments. Bien sûr, il existe des pays qui ont des politiques d’austérité sans appartenir à l’Euro. Nul ne l’a nié. Mais, connaît-on un pays de la zone Euro qui n’applique pas une politique d’austérité ? En fait, on peut montrer que la zone Euro induit un cadre dépressif pour les économies qui y participent[5]. Donc, cet argument ignore ce qu’en logique on appelle des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. La sortie de l’Euro est une condition nécessaire à une rupture avec une politique d’austérité, mais ne constitue nullement une condition suffisante. Par contre, par sa méconnaissance de la logique la plus élémentaire, Pierre Laurent nous montre qu’il est suffisant mais pas nécessaire.
Pierre Laurent révolutionne la science économique (bis)
On revient à un argument en apparence plus économique avec la citation suivante, qui se révèle, à nouveau, tout à fait catastrophique :
« Oui, mais aujourd’hui, la différence est que tous les avoirs détenus par les Grecs sont en euros. Et le transfert de ces avoirs dans une monnaie nationale qui serait dévaluée par les marchés financiers conduirait, dans un premier temps, à un affaiblissement considérable du potentiel de ressources des Grecs. Alors que pour reconstruire leur pays, ils ont besoin d’un niveau d’investissement important ».
Notons tout d’abord que ce ne sont pas les « marchés financiers » qui transfèrent les avoirs qui sont détenus par les grecs. C’est en réalité le système bancaire, s’il s’agit d’avoirs détenus en Grèce. Pierre Laurent, à l’évidence soit ne connaît pas les règles de fonctionnement de l’économie, soit cherche à nous mener en bateau. Ces avoirs en Euros seront automatiquement re-dénominés en Drachmes. Mais cette redénomination touchera toutes les valeurs de l’économie grecque. Donc, le potentiel d’investissement sur la base de l’épargne (oui, cette chose que l’on apprend en fin de première année d’économie, l’égalité entre l’épargne et l’investissement) sera inchangé par rapport aux valeurs de l’économie grecque. Mais, une partie de ces avoirs ne sont pas détenus en Grèce. Donc, ils resteront en Euros (ou dans une autre monnaie, que ce soit le Dollar ou, peut être, le Mark allemand…). Si la Drachme est dévalué, disons de 25%, cela signifie que ces avoirs seront réévalués de 33%. Donc, le potentiel d’investissement, sur la base des avoirs grecs détenus à l’étranger, sera largement augmenté. Ce qui veut dire que les grecs ayant mis leurs avoirs à l’étranger pourraient les rapatrier avec un effet bien plus positif sur les investissements que si la Drachme n’avait pas été dévaluée. Notons encore que ceci s’applique aussi à l’ensemble des investisseurs étrangers. En fait, une sortie de l’Euro et une dévaluation de 25% de la Drachme constituent la condition pour qu’un flux d’investissement important en drachmes se reconstitue en Grèce.
Mais, il est peu probable que Pierre Laurent ignore à ce point les mécanismes de base de l’économie, ou alors il faut s’interroger sur les conséquences délétères sur le cerveau humain d’années de travail au journal l’Humanité. Il est bien plus probable que Pierre Laurent, ici encore, mente, et qu’il mente avec l’aplomb d’un arracheur de dents.
Quand Pierre Laurent joue au prestidigitateur
Reprenons le cours du raisonnement. Pierre Laurent nous offre une magnifique perle avec la citation suivante :
« Puisque les solutions apportées par Tsipras étaient totalement viables et elles restent praticables dans la zone euro. Ce n’est pas la zone euro qui les empêche mais la décision politique prise par les dirigeants allemands et un certain nombre d’autres dirigeants européens de rendre impossible l’expérience politique de Syriza ».
Ici, Pierre Laurent fait mine de croire que les dirigeants allemands et européens ont été conduits uniquement par leur haine politique de Syriza. Que ces dirigeants n’aient pas apprécié Syriza est certain. Mais, quand bien même l’auraient-ils apprécié, accepter les solutions proposées par Tsipras impliquait, à relativement court terme, faire basculer la zone Euro vers ce que l’on appelle une « union de transfert ». Or, les montants nécessaires pour faire fonctionner la zone Euro sans les politiques d’austérité ont été évalués, et on trouvera l’une de ces évaluations d’ailleurs dans ce carnet. Pour faire court, il faudrait que l’Allemagne consacre entre 8% et 10% de son PIB tous les ans pendant environ dix ans à ces transferts. Il est clair que cela n’est pas possible, sauf à vouloir détruire l’économie allemande. La véritable cause du rejet des options de Syriza se trouve là. Affirmer que « les solutions apportées par Tsipras étaient totalement viables et elles restent praticables dans la zone euro » est un nouveau mensonge. Les solutions proposées par Tsipras impliquaient une refonte totale de la zone Euro, et cette refonte aboutissait à faire peser un poids excessif sur l’Allemagne. Telle est la vérité. Mais, cette vérité gêne Pierre Laurent, qui préfère la faire passer sous le tapis pour sauver l’illusion de la possibilité d’une zone Euro qui ne soit pas austéritaire. Pierre Laurent doit donc mentir quant aux conditions de viabilité de la zone Euro, mais, nous l’avons vu, il n’est pas à un mensonge près.
Le dernier mensonge
Il ne reste donc à Pierre Laurent qu’un argument : le point Godwin ou la réduction du dilemme grec à un affrontement avec le Front National. Il suffit de regarder le paragraphe suivant pour s’en convaincre :
« Il y a aujourd’hui trois options en débat. L’option d’une Europe de l’ordre libérale, celle qui existe aujourd’hui. Il y a l’option d’une destruction de l’Europe et d’un retour à la compétition, voire au choc des nations dans la crise que traverse l’Europe, c’est l’option du Front national et des forces qui l’appuient. Et il y a l’option qui est la nôtre, celle de Tsipras, la mienne, celle que nous défendons, qui est l’option de la reconstruction d’une Europe de coopération, de solidarité, d’une Europe de souveraineté qui doit laisser plus de place aux pouvoirs de chaque nation de négocier démocratiquement son insertion dans cette Europe de solidarité. Nous parlons d’une Europe à géométrie choisie… ».
Passons sur le fait que proclamer que l’on vivrait mieux dans le monde des bisounours, la troisième option, na jamais fait avancer le débat. Mais, une sortie de la Grèce de l’Euro, et à terme, une dissolution de l’Euro, entraineraient-ils ce cataclysme que prévoit Pierre Laurent ? En fait, de nombreux économistes soutiennent aujourd’hui qu’une sortie de l’Euro était préférable, certains conservateurs comme Henkel[6], d’autres progressistes comme Kevin O’Rourke[7] ou Stefano Fassina[8], ancien ministre du PD en Italie, et parmi eux des assistants de Varoufakis[9]. C’est donc un nouveau mensonge de Pierre Laurent que de prétendre que l’option d’une sortie de l’Euro serait le fait du seul Front National. Un mensonge de plus dira-t-on. Espérons, en tous les cas, qu’il soit le dernier.
Jacques SAPIR
source: russeurope.hypotheses.org
[1] Pierre Laurent : “Une sortie de la zone euro n’empêche pas la pression des marchés”, entretien avec Bruno Rieth, Marianne, 25 juillet 2015, http://www.marianne.net/pierre-laurent-sortie-zone-euro-n-empeche-pas-pression-marches-100235637.html
[2] Voir le blog de Guillaume Etievant, responsable économique du PG, le 24 juillet 2015, http://guillaumeetievant.com/2015/07/24/soyons-prets-a-sortir-de-leuro/
[3] Pierre Laurent : “Une sortie de la zone euro n’empêche pas la pression des marchés”, op.cit..
[4] Je renvoie à l’article de Jamie Galbraith, qui a travaillé avec Varoufakis publié dans Harper’s, http://harpers.org/blog/2015/07/greece-europe-and-the-united-states/ ainsi qu’aux explications données par Yannis Varoufakis lui-même sur son blog : http://yanisvaroufakis.eu/2015/07/14/on-the-euro-summits-statement-on-greece-first-thoughts/
[5] Voir Bibow, J., et A. Terzi (eds.), Euroland and the World Economy—Global Player or Global Drag? Londres, Palgrave, 2007.
[6] http://www.conservativehome.com/platform/2015/07/hans-olaf-henkel-mep-greece-must-leave-the-eurozone-for-the-good-of-us-all.html
[7] http://www.socialeurope.eu/2015/07/moving-on-from-the-euro/
[8] http://www.stefanofassina.it/lavoroeliberta/2015/07/19/sono-daccordo-con-schouble-una-grexit-assistita-unica-soluzione/
[9] Munevar D., « Why I’ve Changed My Mind About Grexit », in SocialEurope, 23 juillet 2015, http://www.socialeurope.eu/2015/07/why-ive-changed-my-mind-about-grexit/
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par L-HERMINE ROUGE le 23 Juillet 2015 à 23:52
Les manifestations du PAME
le 22 juillet 2015 dans toute la Grèce
Manifestation PAME à Athènes-22 juillet 2015
Manifestation PAME à Thessalonique-22 juillet 2015
source: fr.kke.gr/en/
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
le blog franchement communiste du finistère-morbihan