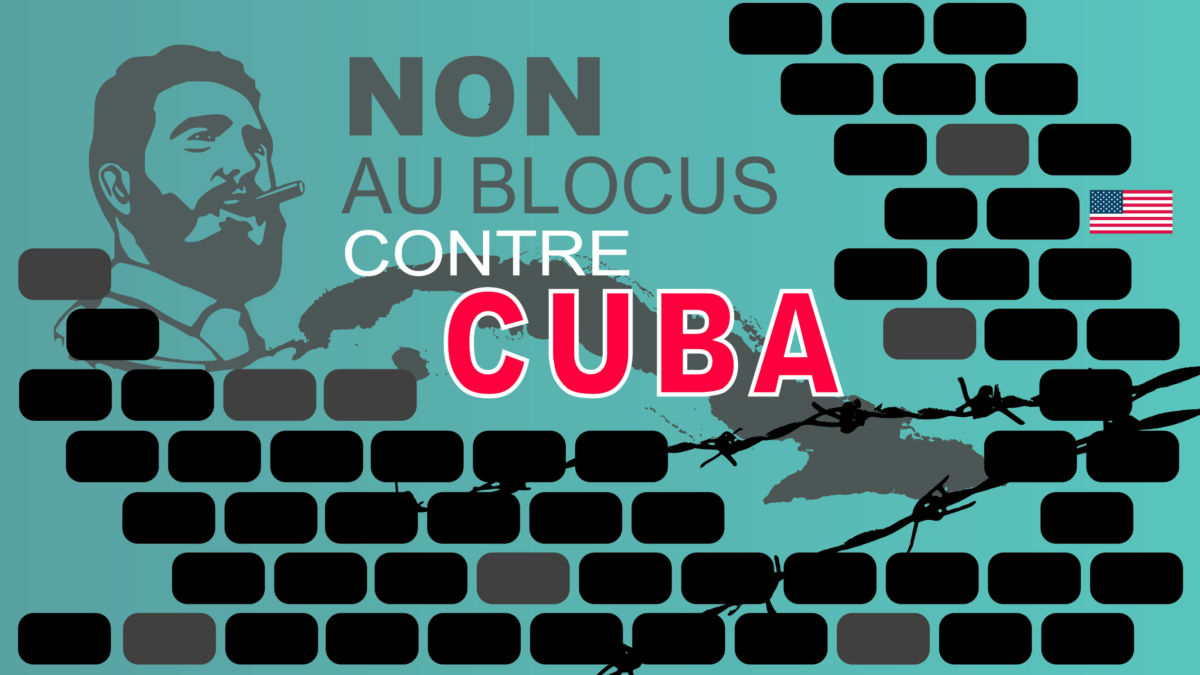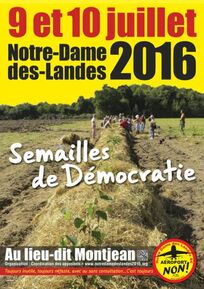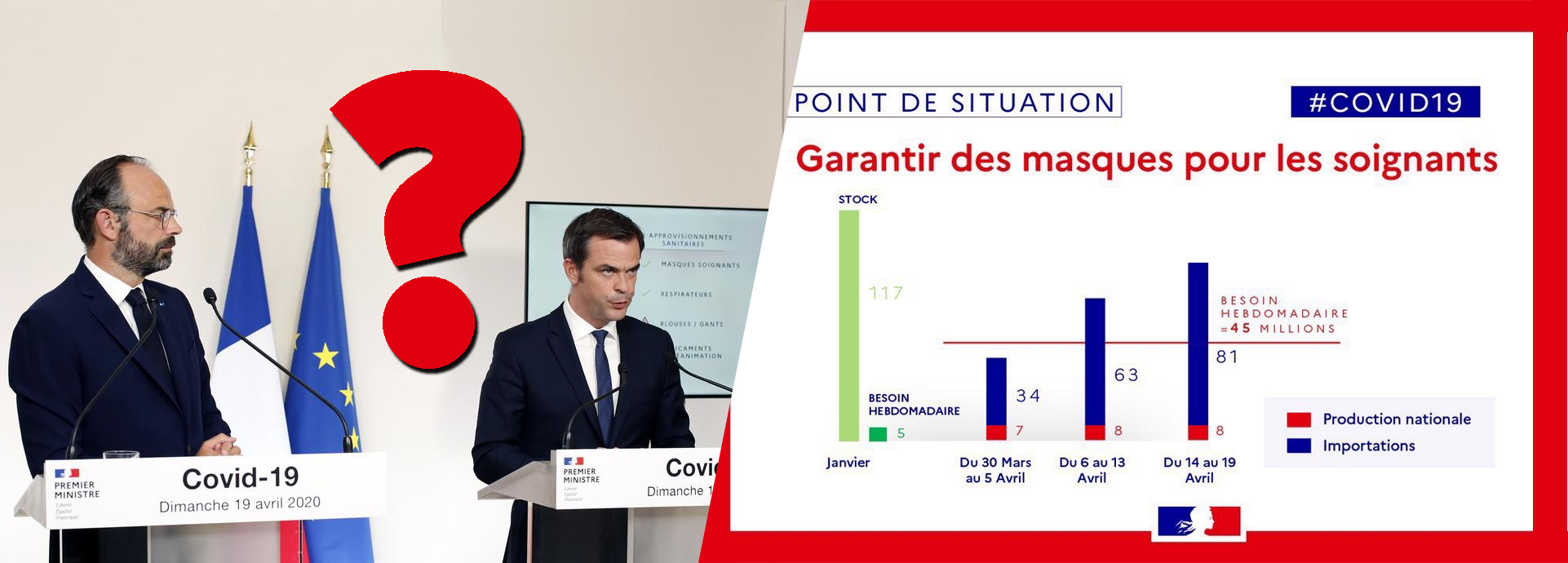"Pour eux, on est un peu comme des pions sur un jeu de Monopoly." Antoine* est un "ancien" de l’usine de Plaintel, dans les Côtes-d’Armor. Depuis les années 90, il a vu passer plusieurs repreneurs de l’usine bretonne spécialisée dans la fabrication des masques respiratoires, notamment les fameux masques FFP2 indispensables au personnel médical. Il a connu le boom de l’entreprise au moment de la grippe H1N1, en 2009, lorsque l’usine fonctionnait "vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept" avec "huit machines, dont cinq supplémentaires". Une capacité de production multipliée par cinq et 300 employés pour fabriquer des masques pour la France entière.
"En 2005, j’avais signé un protocole d’accord avec le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, explique Roland Fangeat, ancien président de la division respiratoire du groupe Bacou-Dalloz, propriétaire de l’usine de Plaintel à l’époque. Nous nous engagions à garantir une production d’au moins 180 millions de masques par an. Le groupe a investi près de neuf millions d’euros sur le site de Plaintel pour financer notamment une extension. Nous avions une capacité de production de 220 millions de masques par an, quatre millions par semaine, en cas de crise."
L’État s’engage, avant de se retirer
Dans ce protocole d’accord, dont la cellule investigation de Radio France révèle l’existence, "l’État s’engage à commander à l’entreprise" plusieurs millions de masques chaque année. "L’État assurera le renouvellement de son stock arrivé à préemption", prévoit l’article 11 de cet accord. Une ligne de conduite alors suivie par l’État, malgré certains retards dans les commandes, comme le montre ce courrier du 14 juin 2006 de Dominique de Villepin : "Je tiens à vous assurer que l’État continuera à respecter ses engagements, en termes de quantité comme de calendrier", écrit le Premier ministre de Jacques Chirac.
"De janvier 2009 à septembre 2010, nous avons livré 160 millions de masques FFP2 à l’État, se souvient Roland Fangeat. Et puis il y a eu un désengagement de l’État. La chute des commandes a été catastrophique pour l’usine de Plaintel."
En 2010, le géant américain Honeywell rachète le groupe Sperian (le nouveau nom de Bacou-Dalloz) alors propriétaire de l’usine de Plaintel qui compte encore 140 salariés. Le début de la fin. "Lorsque les Américains arrivent à Plaintel, ils nous expliquent qu’Honeywell est une chance pour nous et que nous allons 'intégrer' un groupe mondial avec des 'valeurs' et une force de frappe commerciale importante", témoigne Damien*. Pourtant, dès 2011, le groupe annonce 43 suppressions d’emplois. Les plans de licenciement s’enchainent, le chômage partiel devient la règle : à l’été 2018, les 38 derniers salariés de l’entreprise sont finalement licenciés pour des motifs "économiques".
 Des salariés de l'usine Sperian basée a Plaintel se réunissent le 5 janvier 2011, avant l'annonce d'un plan social.
Des salariés de l'usine Sperian basée a Plaintel se réunissent le 5 janvier 2011, avant l'annonce d'un plan social.
La production de masques est délocalisée sur un site déjà existant (créé dans les années 90) à Nabeul, en Tunisie. En septembre 2018, l’usine de Plaintel ferme ses portes. Un mois plus tard, les chaines de production sont détruites. Alexandre* se souvient : "Lorsque je suis sorti pour ma pause-déjeuner, j’ai vu un semi-remorque embarquer un morceau de nos lignes de production qui mesuraient entre 50 et 60 mètres de long. Tout est parti chez le ferrailleur pour être détruit. J’étais vraiment choqué. J’avais l’impression de voir un corbillard chercher le corps d’un mort. C’est un peu à l’image de ce qui nous est arrivé au sein de l’entreprise. Dès qu’Honeywell a repris l’usine, nous étions comme des cancéreux en soins palliatif : on savait qu’on allait mourir, mais on ne savait pas quand ça se produirait."
Lors de sa fermeture, l’entreprise ne produisait plus que huit millions de masques par an.
A lire aussi: Pénurie de masques : les raisons d'un "scandale d'Etat"
Le silence de l’État
À l’été 2018, les élus du personnel, à la demande des salariés, tentent d’interpeller par mail le président de la République. Il explique au chef de l’État que l’usine de Plaintel est "une entreprise d’utilité publique" dont l’actionnaire américain a tout fait pour la rendre "largement déficitaire" tout en "absorbant massivement les deniers publics." "Nous sollicitons votre aide pour intercéder en notre faveur auprès des dirigeants du groupe" concernant "des indemnités de licenciement dont le niveau se situe très largement au deçà de ce qui se pratique habituellement chez Honeywell, en Europe de l’Ouest", peut-on encore lire dans ce courrier adressé à l’Élysée.
Le 24 juillet 2018, le chef de cabinet de l’Élysée lui répond qu’il prend "bonne note" de ce courrier qu’il transmet au ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Lemaire. Le 7 août 2018, le chef de cabinet de Bruno Lemaire répond à son tour que "le ministre a pris bonne note des éléments (…) communiqués et a demandé à la délégation interministérielle aux restructurations d’entreprise et à la direction générale des entreprises de faire le point sur ce dossier. Vous serez directement informé de la suite qui pourra lui être réservé", explique le ministère de l’Économie. "Je n’ai eu aucune nouvelle…", témoigne auprès de la cellule investigation de Radio France l'un des salariés à l’origine de l’envoi de ce courrier.
Contactée, la présidence de la République ne fait aucun commentaire. "C’est le temps de l’unité, pas de la polémique", souffle un proche de l’Élysée. Du côté du ministère de l’Économie, on assure "ne pas avoir eu les moyens d’empêcher une fermeture d’usine dans un secteur qui n’était pas alors considéré comme stratégique." "Cette entreprise avait beaucoup de difficultés, elle avait perdu beaucoup de commandes, explique un conseiller ministériel. Ses effectifs ne permettaient pas à l’outil industriel de bien fonctionner." "Ce n’est pas l’entreprise qui est en cause mais plutôt l’État qui a arrêté de stocker des masques, ajoute ce conseiller de Bruno Le Maire. Sans commande du ministère de la Santé entre 2010 et 2017, le site a été utilisé très en dessous de sa capacité. Si Honeywell avait eu une commande régulière de masques pour le compte de l’État, l’usine n’aurait pas fermé."
 Le ministère de l'Économie et des Finances (Paris, 2014)
Le ministère de l'Économie et des Finances (Paris, 2014)
"Ce message des salariés n’était pas une interpellation du chef de l’État demandant à conserver le site, souligne encore Bercy. Il s’agissait essentiellement d’une demande portant sur le niveau des indemnités de départ. Nous avons donc transmis à la Direccte [direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi] en lien avec le ministère du Travail."
"À l’époque, la fermeture de l’usine a été considérée comme un non-évènement, s’indigne Serge Le Quéau, militant au syndicat Solidaires des Côtes-d’Armor. Jamais la question de l’utilité sociale de cette production de masques n’a été abordée. C’est la logique du marché qui a prévalu. Fabriquer des masques à un moindre coût en Chine ou en Tunisie paraissait sensé pour nos responsables politiques et économiques. On voit bien aujourd’hui que c’est totalement absurde !"
"Personne n’a rien fait lorsque notre usine a fermé, témoigne encore Coralie*, l’une des 38 personnes licenciées. C’est révoltant. On a eu l’impression qu’on nous laissait tomber. Quand je vois ce qui se passe en ce moment avec l’épidémie de coronavirus, je me dis : 'Je devrais être en train de fabriquer des masques…' "
De l’artisanat à la mondialisation
"C’est une belle histoire industrielle qui se termine par un beau gâchis" commente, un brin désabusé, l’ancien maire de Plaintel, Joseph Le Vée.
Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à 1964, lorsque le Français Louis Giffard reprend l’activité de fabrication de chapeaux pour dames de son père. Le secteur est alors en déclin. Un an plus tard, Louis Giffard se lance donc dans la production de masques anti-poussières. En 1971, il crée une société anonyme à Saint Brieuc (baptisée FILGIF puis GIFFARD) et tente de s’inspirer de ce qui se passe aux États-Unis avec la société 3M qui écrase le marché. Dans les années 80, Louis Giffard quitte ses locaux à Saint Brieuc pour s’installer à Plaintel.
"C’est l’époque où on commence à s’occuper plus sérieusement de la santé des salariés, explique l’ancien directeur général du site de Plaintel, Jean-Jacques Fuan. Il y a un essor important de ce qu’on a appelé les EPI, les équipements de protection individuelle. Mais la manière de produire des masques de Louis Giffard est assez artisanale. Elle entraine jusqu’à 30 % de rebut." Après la mort de Louis Giffard, l’entreprise est vendue au groupe suédois Bilsom, en 1986. Elle est rachetée par le groupe français Dalloz en 1993 qui devient le groupe Bacou-Dalloz en 2001 (rebaptisé Sperian en 2003).
La production s’automatise et les normes se développent. "Nous vendions des masques dans le monde entier, se souvient Jean-Jacques Fuan, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, à Taïwan, au Japon, en Amérique du Sud, aux États-Unis… Lorsque je suis devenu directeur industriel du groupe en 2003, j’ai été chargé d’harmoniser les pratiques des 48 sites de production en Europe et en Afrique. Mon rôle a consisté à rationaliser les fabrications du groupe pour faire des économies d’échelle." Jean-Jacques Fuan quitte le groupe Sperian, alors propriétaire de l’usine de Plaintel, en 2006.
Mais en Bretagne, on ne ressent pas encore l’effet des réductions des coûts. "Pour moi, ces années correspondent à une modernisation de l’entreprise, se souvient Alexandre*. C’est en 2010 avec Honeywell que tout bascule."
Un licenciement économique "infondé"
La fermeture de l’usine de Plaintel était-elle vraiment inéluctable ? Les éléments recueillis par la cellule investigation de Radio France permettent d’établir que la reprise de l’usine bretonne par Honeywell en 2010 s’apparente plutôt à une opération financière sans réelle volonté de développer l’outil de production. C’est ce que montre notamment un rapport d’audit financier confidentiel réalisé en 2018, peu avant la fermeture de l’entreprise bretonne. Selon les conclusions de ce document, jamais révélé, jusqu’ici "le motif économique du plan de licenciement collectif est infondé".
"La fermeture du site apparaît relever de motifs financiers et stratégiques bien plus qu’économiques parce que le résultat net est construit artificiellement, analyse le document. Dire que le site de HSP (Honeywell Safety Products) Armor devrait fermer pour cause économique est techniquement infondé… à moins de considérer que fournir un dividende par action et une valorisation boursière 2017 record (et supérieur à la moyenne des 500 entreprises cotées les plus représentatives du marché boursier américain) est un motif économique. Ce qui est plus que discutable. Il est évident que la fermeture du site de Plaintel ne permettra pas d’augmenter le dividende par action de 9 % comme annoncé par le nouveau CEO (Chief Executive Officer) du groupe, mais cela participe bien à la stratégie économique et financière globale du groupe."
Ce rapport d’audit note "un changement de stratégie qui marginalise les masques au sein d’Honeywell Safety Products", la division de l’entreprise dont dépend l’usine de Plaintel. Honeywell "souhaite désormais se concentrer sur des activités davantage rentables, où il est leader et en avance dans la course technologique face à ses concurrents, explique le document. La priorité est de pousser l’offre sur les solutions connectées, à forte profitabilité. La priorité de la direction est de rationaliser la gamme et de se concentrer sur les marchés en forte croissance que sont l’Inde et la Chine."
 Le groupe américain Honeywell a racheté l'usine de masques de Plaintel en 2010.
Le groupe américain Honeywell a racheté l'usine de masques de Plaintel en 2010.
"Le groupe Honeywell n’a finalement jamais investi dans le site de Plaintel, constate encore le rapport d’audit. [...] Les investissements en machines et outils de production ont été plus que limités depuis la reprise du site de Plaintel par Honeywell. (…) La conséquence directe est que l’usine fonctionne depuis lors avec un outil vieillissant et aujourd’hui loin des performances des machines plus modernes. L’investissement incorporel (brevets notamment) a été inexistant et les dépenses de R & D [recherche et développement] n’ont pas concerné de réelles innovations mais presque exclusivement des homologations. Elles ont été largement financées par le Crédit impôt recherche. Ces éléments viennent étayer le fait que le site de Plaintel n’a jamais été une entité stratégique pour le groupe, insiste le rapport, mais bien un complément non core [non essentiel] de sa gamme d’EPI [équipement de protection individuelle] et une source potentielle de revenus élevés en cas de pandémie. Cela correspond tout à fait à la stratégie du groupe. Il n’investit que dans des marchés à forte croissance et à forte profitabilité puis accompagne ses activités matures sans investir jusqu’à arrêt ou cession de l’activité."
"Le marché du masque jetable reste en croissance et reste rentable à condition d’investir régulièrement dans ses outils de production et ses produits, ajoute le rapport d’audit. Honeywell Safety Products n’a investi, ni dans de nouveaux produits, ni dans de nouvelles capacités de production, ni même dans le simple renouvellement de l’outil productif. Le choix est fait de délocaliser la production vers un pays à faibles coûts de production, le site de Nabeul, en Tunisie."
Dans les coulisses du "système Honeywell"
Ce désinvestissement du groupe Honeywell est confirmé par les témoignages d’anciens salariés que nous avons recueillis. "Il y avait une stratégie claire de fermeture de l’entreprise, assure Damien*. Pour un groupe américain comme Honeywell, l’investissement doit forcément être remboursé par les bénéfices en six mois, c’est impossible ! Les investissements étaient donc interdits. Si on voulait lancer des nouveaux produits, c’était à nous de nous débrouiller, il n’y avait pas de crédit pour la recherche-développement. À l’époque de l’ancien propriétaire, le groupe Sperian, un nouveau masque sortait tous les quatre ans, j’en ai vu défiler trois. Avec Honeywell, aucun nouveau masque n’a été développé sur le site de Plaintel en huit ans. En fait, on cherche à faire mourir l’entreprise."
"La période précédente a correspondu à une modernisation de l’entreprise, confirme Coralie*. Beaucoup d’innovations, la création d’un laboratoire et le renforcement du service recherche-développement. Avec Honeywell, notre travail a perdu tout son sens. Le groupe était obsédé par la fourniture d’indicateurs chiffrés. Nous étions constamment sous pression."
"Nous avons découvert le système Honeywell, témoigne Antoine*. Ils appellent ça le 'Honeywell operating system', ce qui correspond en fait au lean management, c’est-à-dire : l’usine maigre. Le but est de supprimer tous les gaspillages à travers une multitude de procédures souvent ubuesques. Réfléchir, c’était déjà commencer à désobéir. Il fallait appliquer les standards… même complètement idiots. Il y avait un système baptisé '5 S' qui établissait toute une série de règles pour un rangement poussé à l’extrême : chaque poubelle, téléphone ou même revue devait avoir une place bien déterminée. C’était du grand n’importe quoi. Honeywell appliquait également la technique du gemba, un mot japonais qui veut dire 'sur le terrain'. Le but était de faire venir les managers en force au sein de l’usine, ce qui stressait énormément les salariés."
"Honeywell surveillait constamment les stocks de matières premières, ajoute Damien*. Il ne fallait pas dépasser un certain niveau pour ne pas perdre de l’argent… parce qu’un stock, c’est de l’argent immobilisé. Et donc ce stock baissait régulièrement. Sauf que lorsqu’il fallait fournir des quantités importantes pour répondre à la demande d’un client, nous n’avions plus la capacité de le faire. Le client devait attendre trois mois. Du coup, il allait voir ailleurs. C’était un cercle vicieux : faute de commandes notre production baissait, donc notre stock diminuait… ce qui faisait à nouveau diminuer la production."
"Pourtant, nous avions potentiellement une forte capacité de production pour le secteur hospitalier, témoigne Antoine*. Nous avons pressé la direction du siège français d’envoyer des commerciaux auprès du monde médical pour nous ramener un chiffre d’affaires. Mais on nous a répondu que ce n’était pas possible, que notre cible était l’industrie… pas le secteur hospitalier."
Une stratégie parfaitement assumée par le groupe américain. Ainsi, les catalogues de la firme américaine ne contiennent pas la gamme de masques Easyfit qui correspond aux masques utilisés en cas de pandémie. C’est ce qu’on constate dans le catalogue 2014-2015 ou 2016-2017 du groupe.
"Le fait qu’Honeywell n’essayait pas de vendre la totalité des produits que l’usine de Plaintel était en capacité de produire montre bien que le groupe voulait fermer le site, c’est tout, ajoute Antoine*. D’ailleurs, ils encourageaient les salariés à partir. Dès que l’effectif est descendu sous la barre des 50 personnes, ils ont lancé le go pour la fermeture."
Contactée, la direction de la communication d’Honeywell explique que "le site n'a pas reçu de commandes suffisantes lui permettant de retrouver sa rentabilité et a accumulé des pertes financières importantes". Elle ajoute que "la société n'a pas pu identifier d'acheteurs externes potentiels pour le site de Plaintel, et après un examen minutieux approfondi, il a été déterminé qu'il n'y avait pas d'autre option viable que de fermer nos installations".
Des choix financiers contestables
Pourtant, les conclusions de ce rapport d’audit confidentiel de 2018 que la cellule investigation de Radio France a pu consulter montrent que le site de Plaintel était tout à fait être rentable. "L’activité d’Honewell de masques respiratoires jetables en Europe, dont celle de HSP (Honeywell Safety Products) Armor, est une activité rentable", peut-on lire dans ce document.
"Les comptes sociaux de HSP Armor n’en témoigne que partiellement dans la mesure où :
- Une partie (non négligeable) de la marge est captée par HSP Europe, l’entité de commercialisation du groupe pour ces produits.
- Les frais généraux intègrent des coûts de management, de services centraux, de top management, de commercialisation et de reporting bien supérieurs à ce que peut supporter une entité de moins de 5 millions de chiffre d’affaires et de moins de 50 personnes."
Autrement dit : ce sont les choix financiers opérés par le groupe qui place l’usine de Plaintel sous tension. Malgré cela, l’usine continue d’être profitable à Honeywell, constate encore le rapport d’audit. La "rentabilité économique [de l’usine] est avérée, peut-on lire dans le document, mais trop faible pour les standards du groupe" Honeywell.
"Une mort programmée"
"Ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’usine de Plaintel n’avait pas accès directement au marché, explique Antoine*. Elle avait un unique client… c’était le groupe Honeywell. C’était lui qui fixait le prix d’achat des masques, donc si on ne rapportait pas assez d’argent, c’était de leur fait. Nous étions une goutte d’eau dans leur chiffre d’affaire."
"Le groupe a construit une rentabilité très faible du site de Plaintel, estime l’avocat Laurent Beziz qui défend plusieurs salariés licenciés. Le groupe fixait les prix très faibles auxquels étaient vendus les articles [c’est ce qu’on appelle les prix de cession ou prix de transfert] tout en effectuant des refacturations importantes de frais. Résultat : la rentabilité était forcément insuffisante."
"Tout ça était planifié, il s’agit d’une construction économique. La mort de l’usine de Plaintel était programmée." Laurent Beziz, avocat.
Ce point est également confirmé par l’audit réalisé en 2018 au sein de l’entreprise. "Avec une construction différente du compte de résultat, et notamment des prix de transfert, l’activité de HSPA aurait pu être bien plus profitable et dégager des résultats significatifs", conclut le rapport d’audit.
"Il y a eu un abus de l’employeur dans l’exercice de son droit de cesser son activité", estime encore l’avocat Laurent Beziz. C’est la raison pour laquelle plusieurs salariés contestent leur licenciement devant le tribunal administratif et le conseil de prud’hommes. Parmi eux se trouvent cinq salariés "protégés" (délégués du personnel et représentants syndicaux) dont le licenciement a été refusé par l’inspection du travail.
Quand le ministère du Travail déjuge l’inspection du Travail
Dans une lettre datée du 22 janvier 2019 que la cellule investigation a pu consulter, l’inspecteur du travail de Saint-Brieuc estime que "le motif économique invoqué à l’appui de la demande de licenciement n’est pas avéré" estimant que "la seule volonté de majorer le profit de l’entreprise n’entre pas dans la définition des difficultés économiques."
Le 17 juillet 2019, la direction générale du travail désavoue l’inspection du travail, validant ainsi le licenciement économique de cinq salariés protégés de Plaintel. "Si une partie des moyens de production ont été déménagés en Tunisie afin d’être réutilisés par une autre entité du groupe, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une entité juridique distincte de l’entreprise HSAP (Honeywell Safety Products Armor), estime la direction générale du travail. De fait, la cause économique invoquée par l’employeur, à savoir la cessation totale et définitive de l’entreprise, doit s’apprécier au niveau de l’entreprise. Il est constant que la cessation totale et définitive de l’entreprise constitue une cause économique autonome sans qu’il n’appartienne à l’autorité administrative d’examiner la réalité d’éventuelles difficultés économiques rencontrées par l’entreprise en amont de la décision de cesser son activité."
Autrement dit : l’État n’a pas à interférer dans la décision, souveraine, d’Honeywell. "Nous contestons l’analyse du ministère du Travail, commente l’avocat des salariés, Me Beziz, il s’agit bien d’une délocalisation." Contacté, le ministère du Travail n’a pas souhaité réagir. Quant à l’avocat d’Honeywell, Philippe Gautier, il n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.
Faire revivre l’usine de Plaintel ?
"Avec cette crise du coronavirus, les vieux logiciels de compréhension doivent être modifiés", estime Serge le Quéau du syndicat Solidaires des Côtes-d’Armor. Il faut que l’État et surtout les citoyens et les salariés se réapproprient collectivement certains moyens de production essentiels à l’intérêt de la nation." Avec d’autres, comme l’ancien directeur général du site de Plaintel, Jean-Jacques Fuan, Serge Le Quéau plaide pour une reprise de l’activité de l’usine à travers une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
L’idée avait été portée en 2001 par l’ancien secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire du gouvernement Jospin, Guy Hascoët. Ce dernier est désormais en contact direct avec la présidence de la région Bretagne. "Ça va être la guerre sur les tarmacs d’aéroport autour des masques, estime Guy Hascoët. Alors que nous avons besoin de 40 millions de masques par semaine et que nous ne sommes même pas à dix en production hexagonale, il faut pousser le plus vite possible toutes les capacités pour se prémunir des épisodes à venir. Dans une situation d’extrême urgence, la Société coopérative d’intérêt collectif est le seul mécanisme qui permet à tous les bretons de prendre des parts sociales au capital de l’usine devenant 'leur' projet tout en échappant à la loi de la concurrence du marché. Si on a la possibilité de faire sortir un million de masques par jour d’ici six mois, il ne faut pas se poser de question. Cette compétition mondiale va être cruelle."
"Il n’y a plus ni l’outil, ni le bâtiment, ni les machines, commente l’ancien maire de Plaintel, Joseph Le Vée. Donc ça ne va pas repartir d’un coup de baguette magique." Le site de l’usine de masques de Plaintel a été réoccupé par l’entreprise BiArmor, "spécialisée dans les produits naturels pour la nutrition, l’hygiène et l’environnement de l’élevage".
 Une salariée de l'usine de masques Bacou-Dalloz de Plaintel (Côtes-d'Armor), en 2005.
Une salariée de l'usine de masques Bacou-Dalloz de Plaintel (Côtes-d'Armor), en 2005.
"Il y a des friches industrielles et des locaux disponibles dans la région pour relancer l’activité de l’usine, estime de son côté Serge Le Quéau. Les machines ont été détruites mais elles ont été fabriquées par une entreprise bretonne. Si de l’argent se débloque, on peut les reconstruire. Beaucoup d’anciens de Plaintel n’ont pas retrouvé de travail. Le savoir-faire est toujours là." "Après la crise, il faudra mettre au grand jour l’histoire de cette société et pointer les manques et les très mauvais choix qui ont été faits mais aussi désigner les responsables", estime le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé.
Ces derniers jours, le groupe américain Honeywell a annoncé qu’il ouvrait une usine à Rhodes Island pour faire face à la demande de masques aux États-Unis. "Une information assez dérangeante", commente l’ancien président de Plaintel, Roland Fangeat.
*Les prénoms ont été modifiés