Une semaine avant les élections de janvier 2015, le politicien de droite Makis Voridis [actuel ministre de l’Intérieur] prenait la parole lors d’une petite réunion locale de soutien au parti de droite Nouvelle Démocratie. Il a alors déclaré : « Nous ne céderons jamais le pays à la gauche […] Ce que nos grands-pères ont défendu avec leurs fusils [une référence à la guerre civile de 1946-1949, lorsque les armées nationalistes ont imposé un régime de terreur blanche contre les guérillas du Parti communiste], nous le défendrons avec nos votes dimanche prochain. Ne vous faites pas d’illusions. Dimanche prochain, il ne s’agit pas simplement de choisir un parti, ni de choisir un programme économique. Il s’agit d’une énorme confrontation idéologique entre deux mondes différents. »
Son camp a perdu cette bataille à l’époque et SYRIZA a fini par former un gouvernement [premier gouvernement entré en fonction le 27 janvier 2015]. La suite est connue. L’effort de recherche d’un compromis avec la troïka [FMI, BCE et Commission européenne] et la classe dirigeante grecque a conduit à la capitulation d’Alexis Tsipras et à la signature du troisième mémorandum d’austérité. La défaite démoralisante de 2015 [Tsipras accepte les conditions de la troïka, malgré la victoire du non, à plus de 61 %, lors du référendum du 5 juillet 2015] a ouvert la voie au retour de la droite au pouvoir.
Lors des élections de 2019, Nouvelle Démocratie a remporté une importante victoire électorale, qui était aussi une victoire politique. Les sondages suggéraient une dérive droitière de l’opinion publique. La capitulation de SYRIZA et le changement idéologique qui s’en est suivi pour tenter de justifier cette trahison et défendre les politiques d’austérité que le gouvernement Tsipras a mises en œuvre ont renforcé la doctrine TINA (There Is No Alternative). Le néolibéralisme (alias « créer un environnement favorable aux investisseurs ») a été réhabilité comme étant la seule façon de sortir de la crise, tandis que Nouvelle Démocratie avait stimulé les sentiments de conservatisme social comme moyen de renforcer sa position alors qu’elle était dans l’opposition.
Makis Voridis était désormais d’humeur revancharde : « Nous ferons toutes les interventions nécessaires pour nous assurer que la gauche ne reviendra plus jamais au pouvoir. » Il n’était pas si inquiet des perspectives électorales de SYRIZA. Comme il l’a dit en 2015, « il ne s’agit pas d’un parti ». Voridis est l’un des représentants les plus élaborés de l’extrême-droite contemporaine en Grèce. Il a passé sa jeunesse dans des groupes néofascistes, utilisant des armes contre des manifestants antifascistes dans les rues d’Athènes. Il a ensuite intégré le parti d’extrême droite plus « parlementaire » LAOS (Alerte populaire orthodoxe), avant de rejoindre Nouvelle Démocratie. Il aime mentionner Antonio Gramsci et le concept d’« hégémonie » dans ses interventions, afin d’expliquer son projet à long terme consistant à « imposer une défaite stratégique aux idées de la gauche – quelque chose de plus grand qu’un pourcentage électoral donné, quelque chose qui existe dans les universités, dans les arts, dans les syndicats, dans l’esprit des gens ».
Bien sûr, tout en mettant l’accent sur « l’hégémonie » et les « idées », Voridis connaît aussi l’importance de la force et de la violence pour gouverner. Mais ses jours de combattant armé de droite sont révolus. Et nous le trouvons aujourd’hui amoureux de « notre démocratie libérale ». Il défendra les forces répressives de « notre démocratie libérale » contre les grèves syndicales, contre les mobilisations de la gauche, contre les squats anarchistes, contre les protestataires qui bloquent les rues. On pourrait dire que pendant que Voridis s’éloignait de ses tactiques néofascistes extrêmes passées, « notre démocratie libérale » allait dans sa direction, ils se sont donc rencontrés à mi-chemin. Depuis janvier 2021, Makis Voridis est le ministre de l’Intérieur. Et la « guerre contre la gauche » qu’il a menée pendant des décennies est désormais le véritable projet de l’actuel gouvernement de droite dirigé par le prétendu « centriste » Kyriakos Mitsotakis.
Kyriakos Mitsotsakis espérait utiliser la défaite politique de la gauche afin d’imposer une défaite stratégique. La démoralisation après 2015 semblait être une occasion en or de matérialiser le slogan des gouvernements successifs au cours des dernières décennies : « Nous devrions en finir avec Metapolitefsi ». « Metapolitefsi » signifie littéralement « changement de régime politique » et décrit la transition vers la démocratie après la chute de la dictature militaire en 1974. Mais c’est un terme politiquement chargé, qui est utilisé pour faire référence aux traditions militantes des années 1970, aux conquêtes du mouvement ouvrier et à « l’hégémonie de la gauche » qui hante les pensées de Voridis.
Très tôt, le gouvernement de Kyriakos Mitsotsakis passe à l’offensive, visant à mettre en œuvre des politiques ultra-néolibérales et à bouleverser l’équilibre des forces entre travailleurs et employeurs. Il s’est appuyé sur les précédents tragiques établis par le gouvernement SYRIZA et a tenté d’accentuer cette orientation, sans l’accompagner des « réserves idéologiques » propres au parti d’Alexis Tsipras au cours de ses mutations.
***
Depuis mars dernier, l’apparition de la pandémie constitue un facteur nouveau. D’une part, la gestion de la pandémie a été un désastre. Le gouvernement a refusé de mettre en œuvre toute politique susceptible d’aider à gérer la situation. Les bars et les restaurants peuvent être fermés pendant des mois, tandis que le commerce de détail s’ouvre et se ferme, mais il n’y a jamais eu de véritable arrêt dans les principaux secteurs de l’économie (usines, construction, bureaux, etc.), ni aucun effort pour imposer des mesures de sécurité sanitaire aux employeurs. Le système national de santé (NHS), qui était déjà en ruine, a dû partir à la guerre sans nouveaux soldats (médecins) ni nouvelles armes (unités de soins intensifs, capacités d’analyse massives, etc.). Le système de transport en commun, lui aussi en mauvais état, n’a pas été renforcé afin d’éviter les cohues aux heures de pointe. En effet, la plupart des salarié·e·s sont toujours obligés de se rendre au travail comme d’habitude et de supporter ensuite des couvre-feux et des restrictions qui frappent leur « temps libre ». La demande des élèves pour des classes plus petites qui permettraient une réouverture des écoles en toute sécurité est restée sans réponse, car cela impliquerait d’engager plus d’enseignants et/ou de construire plus d’écoles.
Tout effort pour traiter ces problèmes signifierait une rupture avec l’orientation néolibérale. De nouveaux médecins, de nouvelles unités hospitalières et de nouveaux lits pour le NHS, de nouveaux chauffeurs et une nouvelle flotte de véhicules pour les transports publics, de nouveaux enseignants et de nouvelles écoles, un nouveau personnel pour l’inspection du travail pourraient être des solutions « permanentes » et donc rester en place après la pandémie, ce que les néolibéraux ne peuvent tolérer.
Ces éléments ont contribué à l’échec de la lutte contre la pandémie. Alors que diverses restrictions de déplacement et des couvre-feux nocturnes sont en place sans interruption depuis novembre dernier, les cas d’infection continuent d’augmenter [233 000 cas et 7361 morts]. A l’heure actuelle, les unités de soins intensifs à Athènes sont pleines, et les médecins affirment que les hôpitaux de la capitale grecque sont sur le point de faire face à une situation « à la Bergame » (choisir quels patients sauver, comme ce fut le cas dans la ville italienne).
Pendant ce temps, le soutien financier aux travailleurs des secteurs qui sont fermés ou qui ont été les plus touchés par le ralentissement de l’activité est le strict minimum. La plupart des fonds publics sont utilisés pour « soutenir » les propriétaires, tandis que des miettes sont laissées pour les employés.
***
Le gouvernement n’a pas simplement échoué à gérer la crise sanitaire et économique. Il a instrumentalisé la pandémie pour approfondir son option néolibérale. Alors que les manifestations, les réunions syndicales, les assemblées d’étudiants et toutes sortes d’activités étaient rendues plus difficiles ou impossibles à cause de la pandémie, le gouvernement a refusé de renoncer à de nouvelles attaques. Il a commencé à voter une loi après l’autre au parlement, dans l’espoir de contourner la résistance sociale. Il a également instrumentalisé la pandémie afin de renforcer la répression. Une partie de l’État a bénéficié d’une augmentation des dépenses publiques, pour du nouveau personnel et des équipements de pointe : la police.
Après l’incroyable rassemblement antifasciste d’octobre dernier [voir à ce propos l’article publié sur ce site le 10 octobre 2020], pendant le procès d’Aube dorée, le gouvernement a lancé une contre-offensive préventive. L’article 11, qui protège le droit de manifester, a été suspendu deux fois, par un décret du chef de la police (!), afin d’interdire les rassemblements de masse du 17 novembre (anniversaire du soulèvement étudiant contre la junte militaire en 1973) et du 6 décembre (anniversaire du meurtre d’Alexis Grigoropoulos, âgé de 15 ans, par la police, qui a provoqué la révolte des jeunes en décembre 2008). Par la suite, une douzaine de militantes féministes de gauche ont été arrêtées pour avoir simplement brandi une banderole sur la place Syntagma afin de protester contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. La loi votée l’été dernier, visant à « réglementer » les manifestations, donne le feu vert à la police pour décider arbitrairement de « l’ampleur de la menace estimée » et interdire ou réduire les rassemblements publics.
Pendant ce temps, la peur de la pandémie elle-même et la répression de l’État nous ont contraints à organiser une sorte de « résistance déléguée ». De petites activités symboliques organisées dans un environnement « semi-clandestin » par des minorités militantes, exprimant les sentiments d’une couche plus large de la population qui ne voulait ou ne pouvait pas descendre dans la rue.
Compte tenu de la faiblesse des mouvements sociaux, nous avons estimé que la nouvelle loi et l’utilisation disproportionnée des forces de police contre les petites mobilisations symboliques avait un caractère préventif. Le gouvernement, comprenant que la colère bouillonne sous la surface et que l’impact de la crise économique va s’aggraver avec le temps, a tenté d’imposer une « nouvelle normalité », où les manifestations sont un endroit dangereux, où les minorités militantes seront isolées et feront face à une répression sévère avant qu’elles puissent faire appel et parvenir à mobiliser une plus grande partie de la population.
***
Le principal problème de Nouvelle Démocratie est qu’un pilier de sa « contre-révolution » a été brisé. Le néolibéralisme est en état de crise permanente depuis 2007. Mitsotakis souhaitait suivre les traces de son idole, Margaret Thatcher, oubliant que la « Dame de fer » s’est affirmée à une époque où le néolibéralisme était en plein essor et où la croissance économique pouvait soutenir la fausse promesse des « effets de ruissellement » pendant un certain temps.
Dans la Grèce contemporaine, le secteur privé glorifié a été fortement touché pendant la pandémie. La crise économique a durement frappé même une partie de l’électorat du gouvernement : les propriétaires de petites entreprises et certains professionnels ; une partie de la petite bourgeoisie qui espérait qu’un gouvernement « favorable aux entreprises » serait la solution à leurs problèmes et qui est maintenant confrontée à un désastre. Les salarié·e·s sont soumis à une pression extrême depuis 2010 (sans compter que même le « bon vieux temps » d’avant la crise n’était pas si bon pour beaucoup d’entre eux). La restauration de l’orthodoxie néolibérale en tant que « bon sens » et la transformation de la société grecque en un environnement « favorable aux entreprises » se sont heurtées à des obstacles, entre autres des luttes de salarié·e·s. Le gouvernement a donc renforcé le deuxième pilier de sa « guerre contre la gauche » : l’autoritarisme et le conservatisme. Pendant que la police réprime, une offensive idéologique tente de discréditer la gauche radicale en la présentant comme « l’ennemi intérieur » qui mérite d’être brutalisé. La « loi et l’ordre » sont devenus le seul discours que Nouvelle Démocratie avait à offrir à sa base de soutien conservatrice, qui craquait sous le poids de la crise financière.
***
Cette mentalité guide le gouvernement depuis lors. En voici un petit exemple, mais parlant. En plein milieu d’une version grecque de #MeToo, où des femmes, principalement dans le domaine des arts et des sports, brisent leur silence et racontent leurs histoires de harcèlement sexuel, il a été révélé que Dimitris Lignadis, nommé par le gouvernement au poste de directeur artistique du Théâtre national, avait systématiquement violé des adolescents. Après l’échec des premiers efforts pour le couvrir, il a finalement été sacrifié. Mais la ministre de la Culture, Lina Mendoni, elle, est restée à sa place, malgré les nombreux appels à sa démission. Normalement, la remplacer aurait été un geste facile et bon marché pour « limiter les dégâts ». Mais c’est là que la mentalité d’un « cabinet de guerre » a prévalu. Mitsotakis a protégé sa ministre. Elle a été présentée par les médias de droite comme une victime de la propagande de gauche qui la prend pour cible pour avoir promu des politiques « favorables aux investissements » dans le domaine de la culture. L’avocat de Lignadis a décidé de s’appuyer sur ce récit, en essayant de présenter son client comme la victime d’une sorte de conspiration de gauche. Il paierait le prix pour avoir essayé de reconnecter le Théâtre national avec « l’esprit grec ancien traditionnel » et d’éliminer « l’influence gauchiste décadente dans les arts »…
***
C’est dans cette situation que le prisonnier Dimitris Koufontinas, ancien membre du groupe armé dissous « 17 novembre » (17N), a entamé une grève de la faim pour protester contre un (énième) traitement injuste. Koufontinas a été traité avec dureté pendant tout le temps qu’il a passé en prison, les bureaucraties de l’État lui refusant constamment des droits qui sont accordés à tous les autres prisonniers condamnés à des peines similaires. Tant Nouvelle Démocratie que l’ambassade américaine se sont traditionnellement montrées très fermes dans leur opposition à tout traitement humain du prisonnier de 63 ans. Le dernier exemple en date est scandaleux. Le gouvernement a voté une loi qui interdit à une certaine catégorie de prisonniers d’être transférés dans des prisons rurales. Elle a de plus un effet rétroactif. Le seul prisonnier correspondant au profil de cette nouvelle disposition et qui se trouvait déjà dans une prison rurale était Koufontinas, de sorte qu’il s’agissait essentiellement d’une loi conçue spécifiquement pour l’en retirer. La loi prévoyait que les détenus devaient être transférés dans la prison où ils se trouvaient auparavant. Mais le gouvernement a contourné sa propre loi et a transféré Koufontinas à la prison de haute sécurité de Domokos [Grèce centrale], et non à la prison de Korydallos [district du Pirée], où il avait passé la majeure partie de sa peine (et où il aurait été plus facile pour sa famille de lui rendre visite). Dimitris Koufontinas a été contraint d’entamer, le 8 janvier, une grève de la faim pour exiger l’application… correcte d’une loi punitive qui avait été votée contre lui en premier lieu !
Le gouvernement a traité la grève de la faim avec un cynisme sauvage. La vengeance contre Koufontinas était combinée avec la « mentalité de guerre » de la Nouvelle Démocratie. Mitsotakis a clairement indiqué que le gouvernement ne reculerait pas et était prêt à mener Koufontinas à la mort. C’était une nouvelle imitation de Margaret Thatcher, qui avait laissé Bobby Sands et ses camarades mourir en prison [en mai 1981], afin de prouver que « la dame n’est pas faite pour tourner ». La vengeance était également porteuse d’un fort symbolisme. Dimitris Koufontinas s’est forgé pendant les années militantes qui ont suivi la junte militaire, et « 17N » est un produit de cette époque. Le fait d’afficher une tolérance zéro et de refuser les droits minimums de ce prisonnier particulier s’inscrivait dans la logique du slogan « achevons l’esprit de Metapolitefsi ».
Pour certains analystes, il s’agissait d’une imitation de la « stratégie de la tension ». La stratégie originale a été mise en œuvre en Italie dans les années 1970, à une époque où il existait des groupes armés de gauche. En l’absence de tels groupes, la version grecque contemporaine a fait surgir le spectre de la « violence armée », 20 ans après la dissolution de 17N et la clôture de ce cycle, par un effort scandaleux pour changer le récit : une question de droits de l’homme et de démocratie a été dépeinte comme une « lutte contre le terrorisme ». Dès lors, tous ceux qui ont soutenu la grève de la faim et exigé le respect des droits de Koufontinas ont été dépeints comme des « sympathisants du terrorisme ». Les médias ont agi comme si la question concernait les actions passées de Koufontinas (pour lesquelles il était en prison depuis 17 ans) et non son traitement en tant que prisonnier. Les commentateurs de droite ont laissé entendre que ce « tueur en série qui n’a aucun remords » ne devrait jouir d’aucun droit (ou même qu’il est normal de le laisser mourir). Les messages Facebook soutenant ces revendications ont été supprimés et les profils des utilisateurs ont été retirés pour « soutien aux actions d’un groupe terroriste » !
La police a établi une nouvelle norme en matière de répression. Les tentatives de rassemblements de quelques dizaines de personnes en soutien au gréviste de la faim ont été violemment dispersées par des unités de police antiémeute, avant même qu’elles n’aient eu le temps minimum de se rassembler et de lever leurs pancartes.
La gestion cynique de la grève de la faim, qui incluait la tolérance de la mort potentielle de Koufontinas, a été le point culminant de la campagne visant à détruire la gauche radicale, tout en faisant appel aux instincts de « loi et d’ordre » des conservateurs et en les radicalisant à un niveau supérieur (celui de s’accommoder de l’idée d’imposer une condamnation à mort à un « extrémiste » et de brutaliser toute personne qui s’y oppose comme sympathisant terroriste). Cette stratégie visait à créer un précédent pour toutes les luttes futures. La vision de cette stratégie pourrait être décrite grossièrement comme suit : une infime minorité qui insiste sur la résistance active subira une répression brutale, tandis qu’une partie de la population a trop peur pour se mobiliser et que l’autre applaudit la police pour s’être occupée des « extrémistes » détestés.
***
Mais les choses ont changé. Au cours du mois de janvier, les étudiants universitaires ont organisé une résistance massive contre la nouvelle loi qui accélère la transformation néolibérale de l’enseignement supérieur et établit la présence permanente des forces de police à l’intérieur du campus. Les manifestations hebdomadaires contre cette nouvelle loi ont rassemblé des milliers d’étudiants et ont ainsi marqué la fin de la période de « résistance déléguée ».
L’« affaire Koufontinas » prend une autre tournure. Semaine après semaine, sa santé se détériorait et il devenait évident que la Grèce était sur le point de devenir le pays où un gréviste de la faim était mort, pour la première fois en Europe depuis 1981. Universitaires, artistes, médecins, avocats, membres du Parlement européen ont appelé au respect de ses droits. L’Ombudsman grec, la section grecque d’Amnesty International, l’Association grecque pour les droits de l’homme et du citoyen, et même l’Association des juges et des avocats ont rejeté la faute sur le gouvernement. Toute l’opposition parlementaire (à l’exception de l’extrême droite) a demandé son transfert à Korydallos. Les manifestations de soutien à la grève de la faim deviennent quotidiennes et prennent de l’ampleur. Une partie importante de la société, dont les opinions sur Koufontinas varient (de la sympathie à l’hostilité et tout ce qui se trouve entre les deux), exprime son rejet du comportement brutal de l’État à son égard. La seule intervention publique soutenant clairement le gouvernement a été celle de responsables de l’État américain, lui qui est responsable de la prison de Guantanamo et des centres de détention secrets de la CIA dans le monde entier…
Pendant ce temps, quelque chose de différent bouillonnait sous la surface. La police ne brutalisait pas seulement les manifestants. Chargés d’imposer les couvre-feux et les restrictions de déplacements, éduqués à considérer la « jeunesse indisciplinée » comme un ennemi, gonflés par la stratégie gouvernementale de « loi et ordre », les flics se sont déchaînés dans les quartiers, les parcs et les places publiques d’Athènes. Les gens ont accumulé des expériences amères de rencontres quotidiennes avec une force de police qui opérait avec l’arrogance et la brutalité d’une « armée d’occupation ».
À un niveau souterrain, le « paradoxe de la répression » apparaissait. Selon ce schéma, la répression est constamment utilisée comme un moyen de pacifier une population qui ne peut être gagnée par la persuasion. Mais à un moment donné, le recours constant à la répression cesse de terrifier la population et finit par l’exaspérer davantage. Les événements de Nea Smyrni, une municipalité de l’Attique, ont servi de catalyseur.

Sur la place publique de Nea Smyrni, des policiers ont menacé une famille qui était assise sur un banc (et qui ne faisait donc pas d’« exercice actif », ce qui est la raison officiellement autorisée pour aller se promener). Les jeunes du quartier ont soutenu la famille et bientôt des renforts de police sont arrivés pour « pacifier la foule hostile ». Un jeune a été brutalisé, mais cette scène a été enregistrée par d’autres citoyens avec leurs smartphones et a fait le tour d’internet. La version initiale de la police qui a été volontiers reproduite par tous les grands médias (les policiers faisaient face à une « embuscade violente », etc.) a été ridiculisée par les habitants qui ont décrit ce qui s’est réellement passé. Le même soir, plus d’un millier d’habitants ont défilé de la place jusqu’au poste de police local, où ils ont été attaqués au gaz lacrymogène et dispersés.
La vidéo a été diffusée partout, et le cri du jeune homme « J’ai mal ! » pendant qu’il était battu est devenu un cri de guerre pour des milliers de personnes, semblable à l’impact du « I can’t breathe » de George Floyd sur la société américaine. Même les médias ont été contraints de changer de discours le temps d’une journée, de montrer un peu de sympathie aux victimes de la violence policière et d’exercer une certaine pression sur les représentants de la police qui ont soutenu sans vergogne leur collègue, qui a « commis une erreur », qui « a malheureusement été filmée » (!). Ces images « ne devraient pas être utilisées pour discréditer la vaillante force de police par les habituelles personnes soupçonnées de sentiment anti-police ».
Le lendemain, ce fut le tremblement de terre. Plus de 10 000 personnes se sont rassemblées sur la place centrale de Nea Smyrni. Dans les moments difficiles que nous avons traversés, une manifestation de cette taille serait célébrée comme un grand succès, même s’il s’agissait d’une mobilisation centrale pour tous les citoyens d’Athènes sur la place Syntagma. Mais ce n’était qu’une manifestation locale. Tout le monde était là. Des syndicats affiliés au Parti communiste, des forces de la gauche radicale, des collectifs anarchistes, des habitants qui n’avaient jamais manifesté auparavant, même des supporters de football ont décidé de mettre de côté leurs différences pour une journée et de marcher ensemble contre la brutalité policière.
Plus tard dans la journée, des escarmouches ont éclaté entre certains manifestants et la police. Une unité de police motorisée – notoirement connue pour sa brutalité et sa tactique permanente consistant à charger avec leurs motos les manifestants – a attaqué. Cela s’est produit à de nombreuses reprises par le passé, mais cette fois-ci, certains manifestants ont riposté et un membre de l’unité a été battu et s’est retrouvé à l’hôpital.
C’est alors qu’une contre-attaque idéologique s’est déclenchée. Les médias ont immédiatement déplacé le débat sur la brutalité policière vers celui « de voyous violents qui ont presque assassiné un policier ». Le premier ministre est intervenu lors d’une émission spéciale, pour dénoncer l’incident (sans jamais mentionner la victime de la brutalité policière). Tout d’un coup, tout le monde était censé oublier tout ce qui avait conduit à cette explosion de rage et sympathiser avec la police. Pendant ce temps, dans les rues de Nea Smyrni, la police cherchait à se venger. Toute une municipalité a souffert de leur activité frénétique cette nuit-là, dans les rues avoisinantes, à l’intérieur des magasins et des immeubles d’habitation. Une vidéo a été publiée qui résume leur état d’esprit après l’attaque de leur collègue. Son unité a été filmée en train de crier « Ils sont finis ! On va les tuer ! On va les baiser ! » De nombreux incidents de violence policière ont été enregistrés par des résidents locaux et mis en ligne.

C’était comme deux univers parallèles. Pour les médias grand public, l’« histoire du jour » était le drame du policier blessé, tandis que les médias sociaux étaient envahis par diverses vidéos de violences policières sauvages dans les rues environnantes de Nea Smyrni et par des habitants criant depuis leur balcon « Dégagez d’ici ! » ou « Laissez les enfants tranquilles ! ». La distance entre la réalité et la couverture médiatique a été un autre facteur qui a enragé les gens – comme on avait pu le constater à l’occasion du référendum de 2015, lorsque les médias de masse ont été fortement discrédités pour leur rôle dans le soutien du « Oui » aux mesures de la troïka. Kyriakos Mitsotakis n’a pas conforté sa position lorsqu’il a averti les jeunes que « les médias sociaux sont une menace pour la démocratie car ils fournissent une vision déformée de la réalité », cela à une époque où ce sont les médias « respectables » qui déforment constamment la réalité pour protéger le gouvernement et la police.
La contre-offensive idéologique a échoué lamentablement. Le premier sondage national sur la question a montré qu’une majorité des personnes sondées avait une opinion négative de la police (excessivement violente) et qu’ils étaient responsables de la petite émeute de Nea Smyrni. Mais ce qui est bien plus important que les sondages d’opinion, ce sont les rues. Le week-end suivant les événements de Nea Smyrni, tous les quartiers d’Athènes et de nombreuses villes de Grèce étaient remplis de manifestants. Il est difficile d’en estimer le nombre total. Mais de nombreuses municipalités ou districts ont connu les plus grandes manifestations locales depuis de nombreuses années. Des dizaines de manifestations locales simultanées ont rassemblé quelques milliers de personnes chacune. La « décentralisation » de la protestation était une stratégie discutée dans la gauche radicale comme moyen de faire face au double problème de la pandémie et des interdictions de l’État. Certains groupes avaient tenté une telle tactique le 6 décembre 2020, avec de nombreux événements locaux commémorant Alexis Grigoropoulos et la révolte de 2008, au lieu d’essayer de se rassembler une fois de plus au point de rendez-vous traditionnel du centre-ville d’Athènes où des dizaines d’unités de police nous « attendaient » déjà. Ce fut un succès, mais loin d’être comparable à ce qui s’est passé les 13 et 14 mars. Cette fois-ci, la stratégie de « décentralisation » a rencontré le besoin réel d’une masse critique de personnes de protester dans leurs quartiers, de réclamer leur droit à l’espace public face à la police. La police ne s’est même pas montrée pour essayer d’arrêter ce qui peut être décrit comme une « révolte pacifique » composée de multiples manifestations de type « guérilla ».
Les protestations locales étaient diverses. Des groupes anarchistes locaux, des organisations de gauche, certains syndicats de travailleurs, des collectifs actifs dans la solidarité sociale les ont organisées, en fonction de leur force dans chaque district ou quartier.

Ils étaient remplis de colère. Contre la police, contre la gestion de la pandémie, contre les priorités des dépenses publiques, etc. Un seul cri rassemblait toutes les doléances : « Mitsotakis, salaud ! » C’était un écho du passé : ce slogan avait été lancé en 1965 contre le père de l’actuel premier ministre, Konstantinos Mitsotakis, pendant les « Iouliana » (les « événements de juillet »), une révolte contre la monarchie déclenchée lorsque le Palais a renversé un gouvernement centriste avec l’aide de Mitsotakis, qui avait orchestré la défection d’un nombre crucial de députés centristes. Le slogan redevient populaire en 2021, pour exprimer le dédain envers le fils de l’une des familles les plus puissantes de la politique grecque. Michalis Chryssochoidis, le ministre en charge de la police [un ministère baptisé ministère de la protection des citoyens], a été une autre cible des chants des manifestants. Cet ancien social-démocrate [membre du Pasok dès 1974, passé à Nouvelle Démocratie en 2019], qui est devenu le favori de la CIA et l’enfant-vedette de l’« antiterrorisme » après le démantèlement de la « 17N » [en 2002], est maintenant le « shérif » largement méprisé et ridiculisé pour sa déclaration antérieure selon laquelle « les habitants des quartiers défavorisés applaudissent lorsqu’ils voient nos forces de police défiler dans leurs rues ».
La jeunesse constituait le gros des manifestations locales. Bien sûr, des gens de tous âges sont venus, mais la présence massive des jeunes était significative. C’est une évolution intéressante. Il y a des générations de personnes dont la brève existence a été marquée par deux crises économiques majeures et une pandémie, jusqu’à aujourd’hui. Ils sont confrontés à de sombres perspectives sur le marché du travail, leur vie sociale est soumise à une pression constante, ce sont eux qui subissent habituellement le harcèlement quotidien de la police sur les places et dans les parcs publics et ce sont eux que le Premier ministre désigne constamment pour leur faire la morale. Mais ils sont aussi ceux qui n’ont pas vécu la défaite de 2015 de la même manière que ressentie par les générations précédentes qui ont lutté pendant de nombreuses années avant l’arrivée de SYRIZA au gouvernement et se sont ressenties épuisées et démoralisées après la trahison.
***
Ce sentiment de défiance irrigue aussi d’autres luttes. La même semaine que la manifestation à Nea Smyrni et les manifestations locales, nous avons également assisté à : la grève féministe du 8 mars, à une marche étudiante contre la nouvelle loi sur les universités, à une manifestation centrale qui combinait la solidarité avec Dimitris Koufontinas et la lutte d’ensemble contre l’autoritarisme et la répression. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ces mobilisations. Les jours suivants, nous avons eu les mobilisations des acteurs des divers milieux culturels, combinant leurs griefs pour le manque de soutien financier pendant le confinement, leur rejet des efforts pour imposer la censure dans les arts en utilisant la législation « antiterroriste » (similaire à celle qui a récemment conduit le rappeur catalan Pablo Hasel en prison) et la colère déclenchée par le #MeToo grec dans les arts. Puis, le 17 mars, une mobilisation du personnel de santé a été accompagnée de manière solidaire par de nombreuses personnes. En résumé, un gouvernement qui s’est lancé dans une campagne visant à diminuer sérieusement les protestations publiques fait face ces derniers temps à des mobilisations presque quotidiennes.
Cette évolution de la situation a eu un autre effet secondaire. On dit que les grévistes de la faim déterminés et désespérés ont besoin de quelque chose à espérer pour changer d’avis et ne pas se sacrifier. Alors que Nouvelle Démocratie a refusé d’accorder à Dimitris Koufontinas ses droits jusqu’au bout, se contentant ou même voulant le voir mourir, le bref « printemps » de la résistance sociale a donné à Koufontinas des raisons d’espérer en l’avenir. Il a finalement mis fin à sa grève de la faim, déclarant que « ce qui se passe là-bas est bien plus important que la question qui l’a déclenchée » et que l’existence de forces sociales dynamiques qui résistent à l’autoritarisme « est un nouvel espoir ». Si le mouvement de masse n’a pas forcé le gouvernement à faire marche arrière, il a permis d’éviter la sombre perspective d’une mort tragique.
Le gouvernement est sous pression et les jours de confiance arrogante en soi qui ont défini les débuts de son mandat sont derrière lui. Mais son avenir est loin d’être déterminé. La « guerre contre la gauche » peut s’avérer fructueuse en « accrochant les wagons » de l’électorat conservateur, qui s’est radicalisé. Le principal parti d’opposition, SYRIZA, n’est guère une « opposition », choisissant le langage conciliant de la politique respectable, de l’unité nationale, etc. La gauche anticapitaliste est encore fragmentée, confuse et/ou panse ses plaies de 2015. Les syndicats ont été sévèrement affaiblis et les « nouveaux mouvements » manquent de fondations critiques pour le moment.
Mais il semble que nous entrons sur un nouveau terrain, avec des possibilités de contrecarrer, de manière tout à fait initiale, les effets de la défaite politique de 2015. L’énergie vibrante des jeunes générations, combinée à une réactivation possible d’un secteur de militants politiques disposant d’une expérience de luttes peut constituer un élément favorable à une nouvelle phase politique.
Ces jours-ci, les chroniqueurs des médias grand public ont tendance à évoquer la révolte des jeunes de 2008 et le « mouvement des places » de 2011. Les optimistes rassurent leur public en disant que « cela ne se reproduira pas ». Les plus prudents préviennent que « nous devons nous assurer que cela ne se reproduira pas ». En tout cas, il est révélateur que les fantômes des luttes passées reviennent les hanter… (Texte envoyé par l’auteur le 19 mars 2021 ; traduction rédaction A l’Encontre )













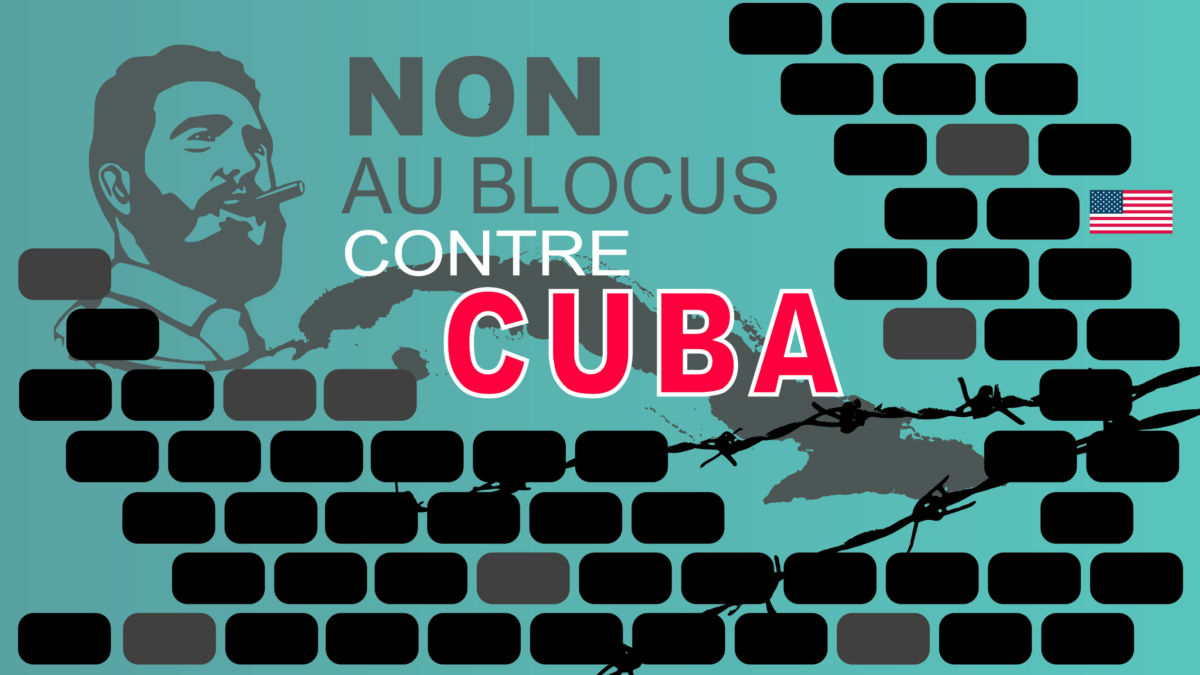










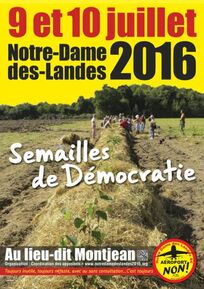





















 Entrée du siège de la Banque de France, à Paris.
Entrée du siège de la Banque de France, à Paris.








